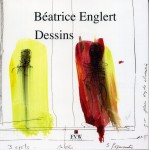25/12/2009
Balise 55-
« Il est temps en effet de le préciser: Noli me tangere ne dit pas simplement « ne me touche pas », mais plus littéralement « ne veuille pas me toucher ». Le verbe nolo est le négatif de volo: il signifie a ne pas vouloir ». En cela aussi la traduction latine déplace le grec mè mou haptou (dont la transposition littérale eût été non me tange). Noli: ne le veuille pas, n'y pense pas. Non seulement ne le fais pas, mais même si tu le fais (et peut-être Marie-Madeleine le fait-elle, peut-être sa main s'est-elle déjà posée sur la main de celui qu'elle aime, ou sur son vêtement, ou sur la peau de son corps nu), oublie-le aussitôt. Tu ne tiens rien, tu ne peux rien tenir ni retenir, et voilà ce qu'il te faut aimer et savoir. Voilà ce qu'il en est d'un savoir d'amour. Aime ce qui t'échappe, aime celui qui s'en va. Aime qu'il s'en aille. »
Jean –luc Nancy
15:36 Publié dans Balises | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, philosophie
Raphaël Monticelli & Martine Orsoni, La légende fleurie, L'Amourier éditions
 Les éditions de l'Amourier - voir leur site amourier.com - viennent de faire paraître La légende fleurie! 30 vies de saints/saintes rédigées d'une plume
Les éditions de l'Amourier - voir leur site amourier.com - viennent de faire paraître La légende fleurie! 30 vies de saints/saintes rédigées d'une plume  allègre et leste par Raphaël Monticelli. Chacun étant accompagné de dessins de Martine Orsoni. tous empreints de sensualité et de cette douce ironie.
allègre et leste par Raphaël Monticelli. Chacun étant accompagné de dessins de Martine Orsoni. tous empreints de sensualité et de cette douce ironie.
Oui, Michel Séonnet a raison: "ce livre se savoure comme un lait d'émerveillement"!
J'aurais pu - j'avais même très envie! - de choisir Sainte Rita ou Sainte Réparate, pour leur ancrage niçois, mais en écho à la balise 55, j'ai préféré choisir celle de Marie Madeleine. Merci à Jean Princivalle et Bernadette Griot des éditions de l'Amourier, Raphaël Monticelli et Martine Orsoni de nous avoir autorisé à publier ces lignes!
Sainte Marie-Madeleine
Certains prétendent que Marie, la sœur de Marthe et Lazare chez qui Jésus séjournait volontiers, était bien Marie de Magdala dont Notre Seigneur avait chassé sept démons et que c'était cette même femme que saint Luc nous présente, sans la nommer, en larmes aux pieds de Jésus Christ alors qu'il était reçu par Simon le Pharisien. On assure même que cette Marie était de noble origine, er qu'elle tirait son nom de "Magdala" d'un château qui lui était échu en partage. La vanité de cette tradition oublie qu'il échut à Marie-Madeleine bien plus qu'une noble origine et un château, toutes choses mondaines et vouées à périr, mais la suprême douceur de Notre Seigneur Jésus Christ, qui abîma son cœur non dans le repentir, comme on le dit très perfidement parfois, mais dans l'amour absolu qui ne demande ni n'attend rien.
La seule chose dont tu puisses être sûre, c'est que, passant en Galilée, dans la ville de Naïn, Jésus fut reçu par Simon le pharisien, et qu'une femme, du nom de Marie, poussée par la curiosité et le doute, s'introduisit dans la réception. On la disait originaire des bords du lac de Gennésareth, de Magdala sans doute, et elle était connue pour gagner sa vie du commerce qu'elle faisait de son propre corps.
La chaleur était étouffante et le soleil délogeait les due des coins d'ombre qu'il rétrécissait sans cesse; dans la cour où le Pharisien recevait Jésus, un treillage soutenait des pampres lourds, borné par un figuier à l'ombre verre er odorante; du puits central on hissait régulièrement des seaux d'eau dont aspergeait le sol. Marie de Magdala était une de ces lucioles au teint mat; le regard que, petite fille, elle avait vif et rieur, lui était venu, avec la vie, ardent et triste. Cette tristesse du regard était masquée sous la lourdeur des parures, la richesse pénétrante et subtile des parfums et une science assurée du maquillage. C'est ainsi qu'elle présentait aux yeux du monde une apparence arrogante d'éclat et de luxe; et c'est ainsi qu'elle apparut chez Simon, jusqu'à ce que ses yeux rencontrent ceux de Jésus.
Marie savait peser le regard des hommes et y reconnaître la charge de trouble et de désir qu'elle était experte à allumer en eux. Au moment où elle glissait son oeillade entre ses cils, elle vit Notre Seigneur la regarder avec une douceur et une bienveillance infinies, et elle sut qu'elle voyait pour la première fois ce qu'elle s'ingéniait à imiter; elle sut aussi que toute la sincérité de tous les regards d'amour était le reflet de ce regard-là.
Tant de douceur la terrassa; les vannes de son cœur s'ouvrirent et elle fut incapable de retenir les pleurs qui surgissaient du fond d'elle avec la violence innocente et douce des torrents de
mai. Sanglotante et éperdue, elle abîma son visage dans ses cheveux, aux pieds de Jésus qui considérait maintenant Simon avec une curiosité amusée.
15:31 Publié dans Mes ami(e)s, mes invité(e)s | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, saints, saintes, monticelli, orsoni
05/12/2009
Balise 54-
Pour nous qui vivons de plus en plus entourés de masques et de schémas intellectuels, et qui étouffons dans la prison qu’ils élèvent autour de nous, le regard du poète est le bélier qui renverse ces murs et nous rend, ne serait-ce qu’un instant, le réel ; et avec le réel, une chance de vie.
Philippe Jaccottet
23:13 Publié dans Balises | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, jaccottet
03/12/2009
Turbulence 40 - Prenons soin de nos moulins!
Je relaie bien volontiers et m'associe à ce message de mon ami peintre et graveur, Henri Baviera:
"Pour ceux qui ne le savent pas, les Moulins de la Larroque viennent de subir le plus gros outrage, après des années de travail, c’est à dire une mise en liquidation judiciaire, ceci après avoir perdu l’un des deux entièrement dans un incendie.
Je suis artiste peintre et graveur, client des moulins depuis une vingtaine d’années pour la qualité particulière de ses papiers entièrement fait à la main. Au cours de ces années il est entré dans l’édition de mes gravures par centaine de kilos. Une grande partie de ma production en dépend comme c’est le cas de nombreux de mes collègues. Ses papiers sont connus et appréciés dans le monde entier. Si vous êtes artiste c’est peut-être aussi votre cas.
Aujourd’hui le moulin est en danger d’expropriation par des gens qui ont profit et intérêt à le mettre en faillite et à se l’approprier.
Si cette pratique est hélas, d’un usage courant à notre époque, le cas présent mérite une attention particulière.
Il s’agit de défendre un patrimoine culturel de la plus grande importance, non seulement parce que celui-ci date de 1497, mais parce qu’aujourd’hui il demeure un pôle de savoir faire et de traditions qui sont en danger de disparition si l’on n’y prend garde.
Je veux attirer l’attention de tous les défenseurs de la culture, des artistes, des élus, des pouvoirs publics, des médias, sur ce drame scandaleux qui se déroule sous nos yeux.
Il est encore temps d’agir, pour sauver le moulin de cet acharnement aveugle et destructeur.
Il faut savoir que sans le papier nous en serions encore à écrire sur des peaux de bête et l’imprimerie n’aurait pu exister et à sa suite ni la culture et le savoir d ‘aujourd’hui.
Un moulin à papier n’est pas un bâtiment comme les autres, actuellement il n’en existe plus que trois ou quatre en France, il ne faut pas les laisser disparaître !!
D’une part pour la valeur patrimoniale qu’ils représentent, mais aussi comme fournisseurs incontournables des artistes, graveurs et éditeurs d’art, qui à leur tour subissent un grave préjudice si ces papiers disparaissent.
Pour terminer il y a lieu de dénoncer le niveau moral déplorable et l’extrême cruauté qui s’exercent au dépends de la famille Duchène exploitante des moulins depuis 1972 qui n'ont jamais compté leurs efforts depuis cette date.
Cette situation devrait faire l’objet d’une pétition au niveau national, d’une note au ministre de la Culture et à la Défense du Patrimoine.
Par cette lettre j’apporte personnellement tout mon soutien de citoyen à Monsieur et Madame Sanchez ainsi qu’à la famille Duchène .
J’invite tous les amis de la culture et des arts, à manifester leur soutien, en donnant leurs idées et à faire suivre ce message autour de vous.
Si vous êtes d'accord pour donner votre soutien il suffit de renvoyer cette lettre (en copier-coller)
en mettant vos commentaires et votre nom à la fin à
Fabienne et Louis Sanchez
moulindelarroque@free.fr"
09:25 Publié dans Dans les turbulences | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, papier, moulinsq de larroque
19/11/2009
Turbulence 39 - Vous avez dit livre? Encore?
Un ministre, ça signe! ça termine les boulots commencés. Hier, Hadopi. Aujourd'hui, la direction du livre et de la culture. Supprimée. Par décret. C'était dans l'air! Abattu, le mauvais oiseau!
Nous protégeons la création, ils ont dit ça, non? Nous avons le souci des créateurs, ils ont dit ça, non? Aussi ça, non? Quand ils parlent d'artistes et de culture, c'est d'"industrie culturelle" -voir Adorno et Horkheimer - qu'ils parlent et de tout ce qui va avec de l'uniformisation des modes de vie aux profits!
Hadopi, c'était cela! Aujourd'hui, c'est la direction du livre et de la culture qui est supprimée. Après quid du CNL, de sa commission qui attribue aides aux éditeurs et bourses aux auteurs? Et pourquoi pas la loi sur le prix unique du livre...J'en passe en attendant des meilleures, par exemple l'action éducative via les DRAC...
Voyez Survivance des Lucioles de Georges Didi-Huberman (ed de Minuit): Ils veulent la luce, la lumière du pouvoir, que tout soit clair, enfin! Que l'on baillonne ceux qui pensent dans les mots. À la réserve! Que disparaisent les lucciola, leurs lueurs intermittentes, erratiques, mineures, menues, petites, lueurs de résistance. Plein feu et qu'on en finissent avec tous ces contre-feux, ils disent, ils veulent ça! Détruire les lucioles et leurs signaux désirants, amoureux dont l'enjeu n'est rien de moins que de l'humain en formation, ils veulent ça!
Les lucioles ne disparaîtront pas! Beaucoup mourront. Meurent déjà. Mais faire un pas de côté, c'est se jeter dans le "présent de leur survivance", c'est les "voir danser vivantes au coeur de la nuit, cette nuit fût-elle balayée par quelques féroces projecteurs".
18:47 Publié dans Dans les turbulences | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, poésie, livre
17/11/2009
Cécile Mainardi - L'immaculée conceptuelle (extrait)
 Cécile Mainardi est née et a grandi dans la région parisienne, un oeil néanmoins tourné vers le sud, l'horizon italien. Après des années d'exploration poétique, qui commencent avec un premier recueil Grièvement, se poursuivent avec un autre livre l'Armature de Phèdre, elle garde une prédilection pour le lyrisme, mais accorde de plus en plus de prix à l'inventivité. Si la question du rapport aux lecteurs se confirme comme axe essentiel à son écriture (La Forêt de Porphyre, Je suis une grande Actriste), ses derniers livres tentent surtout chacun à leur manière la restitution de l'unité de l'émotion (la Blondeur, l’Eau Super-liquide). Hésitant toujours entre trouver/révéler/générer de la poésie dans sa propre vie, et susciter de la vie dans sa poésie, elle recharge ou crispe/aère chacune tour à tour de cette hésitation.
Cécile Mainardi est née et a grandi dans la région parisienne, un oeil néanmoins tourné vers le sud, l'horizon italien. Après des années d'exploration poétique, qui commencent avec un premier recueil Grièvement, se poursuivent avec un autre livre l'Armature de Phèdre, elle garde une prédilection pour le lyrisme, mais accorde de plus en plus de prix à l'inventivité. Si la question du rapport aux lecteurs se confirme comme axe essentiel à son écriture (La Forêt de Porphyre, Je suis une grande Actriste), ses derniers livres tentent surtout chacun à leur manière la restitution de l'unité de l'émotion (la Blondeur, l’Eau Super-liquide). Hésitant toujours entre trouver/révéler/générer de la poésie dans sa propre vie, et susciter de la vie dans sa poésie, elle recharge ou crispe/aère chacune tour à tour de cette hésitation.
cette nuit j’ai passé si longtemps à chercher la durée du poème, que le poème a fini par abandonner tout ce dont il parlait pour ne plus rien dire d’autre que sa durée. C’est la seule chose qu’il puisse maintenant vous offrir, mais si vous acceptez de le lire jusqu’au bout, il vous l’offre entièrement et sans détour, quelque soit l’endroit où il s’arrête de lui-même comme par enchantement – puisque il m’est autant impossible qu’à vous de savoir quand- A défaut de figures, il vous donnera au moins cela, le sentiment d’avoir duré tant de temps, et il faudra juste faire en sorte d’être particulièrement sensible au moment où, étant encore en train de lire, vous ne lirez plus, pour que le sentiment de sa durée vous arrive, sans effort, sans vous concentrer spécialement sur la notion de durée, comme l’éclosion d’un nénuphar de silence. Et si vous êtes surpris autant que je peux l’être en l’entendant s’arrêter, alors peut-être avons-nous réellement une chance de nous rencontrer là. Mais peut-être nous connaissons-nous déjà.
18:53 Publié dans Mes ami(e)s, mes invité(e)s | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, poésie
Balise 53-
"Tous les emblèmes, toutes les images, tous les miroirs évoquent l'insaisissable, et l'homme interroge l'insaisissable. Nous fabriquons ce que, dans un tableau célèbre, Magritte appelle La lunette d'approche.
Une fenêtre est à demi-ouverte. Le battant qui s'ouvre emporte avec lui le paysage, un ciel et des nuages. La lunette d'approche découvre ce qu'il y a derrière les emblèmes, les images, les miroirs: un vide, le gouffre, l'Abîme de l'existence humaine.
C'est cet Abîme qu'il nous faut habiter. La raison de vivre commence là."
Pierre Legendre
18:46 Publié dans Balises | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, pierre legendre
Vient de paraître - Charles Gardou: Au nom de la fragilité
 Charles Gardou avec le soutien de Tahar Ben Jelloul a réuni trente écrivains, trente voix pour dire dans la plus grande diversité à
Charles Gardou avec le soutien de Tahar Ben Jelloul a réuni trente écrivains, trente voix pour dire dans la plus grande diversité à  ceux que la vie malmène qu'ils ne sont pas seuls. "Votre fragilité est la nôtre" écrit Charles Gardou, porteur de ce beau projet auquel les éditions érès viennent de donner corps.
ceux que la vie malmène qu'ils ne sont pas seuls. "Votre fragilité est la nôtre" écrit Charles Gardou, porteur de ce beau projet auquel les éditions érès viennent de donner corps.
On peut se procurer cet ouvrage en écrivant aux éditions érès,33 rueMarcel-Dassault, 31500 Toulouse ou par mel: eres@editions-eres.com. Prix de vente:20 euros.
On peut consulter le site des éditions érès à l'adresse WWW.editions-eres.com
18:21 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, fragilité, handicap
Martin Miguel: 40 ans de travail
Martin Miguel vient d'ouvrir son site: www.martin-miguel.fr/
Martin Miguel, c'est 40 ans de travail autour d'une question concernant la peinture et ses constituants. C'est cela que rend visible ce site: l'évolution de ce questionnement à propos de la relation entre espace plastique et espace physique qui à partir de l'année 1986 le voit mettre en oeuvre de façon simultané le béton et la couleur, histoire de centrer encore plus son propos sur les relations entre peinture et mur.
18:04 Publié dans Mes ami(e)s, mes invité(e)s | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : miguel, peinture, mur, béton, bois
16/11/2009
Turbulence 38- Henri Michaux et le style
À méditer par tous ceux qui croient que "le style, c'est l'homme" et par nous autres qui sommes engagés sur les chemins de l'écriture, cet extrait de Poteaux d'angle d'Henri Michaux:
"Le style, cette commodité à se camper et à camper le monde, serait l’homme? Cette suspecte acquisition dont, à l’écrivain qui se réjouit, on fait compliment? Son prétendu don va coller à lui, le sclérosant sourdement. Style : signe (mauvais) de la distance inchangée (mais qui eût pu, eût dû changer), la distance où à tort il demeure et se maintient vis-à-vis de son être et des choses et des personnes. Bloqué! Il s’était précipité dans son style (ou l’avait cherché laborieusement). Pour une vie d’emprunt, il a lâché sa totalité, sa possibilité de changement, de mutation. Pas de quoi être fier. Style qui deviendra manque de courage, manque d’ouverture, de réouverture : en somme une infirmité.
Tâche d’en sortir. Va suffisamment loin en toi pour que ton style ne puisse plus suivre."
19:32 Publié dans Dans les turbulences | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, style, michaux
23/10/2009
Balise 52-
10:35 Publié dans Balises | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, poésie
22/10/2009
In memoriam Jean-Max Tixier
 L'homme qui nous a quitté était né né en 1935 à Marseille. Après des études de sciences et de lettres, une thèse de IIIè cycle : "Poésie et Mathématique" il s'intéressa toujours à l'écriture sous tous ses aspects et aux rapports entre la littérature et les sciences.Après avoir animé la revue "Sud", il était membre du comité de rédaction de la revue "Autre Sud". Il était resté fidèle à la revue de Michel Cosem, "Encres Vives".
L'homme qui nous a quitté était né né en 1935 à Marseille. Après des études de sciences et de lettres, une thèse de IIIè cycle : "Poésie et Mathématique" il s'intéressa toujours à l'écriture sous tous ses aspects et aux rapports entre la littérature et les sciences.Après avoir animé la revue "Sud", il était membre du comité de rédaction de la revue "Autre Sud". Il était resté fidèle à la revue de Michel Cosem, "Encres Vives".
Poète, critique, romancier, il est l'auteur de plus de 70 ouvrages dans des genres divers (certains en collaboration ou sous pseudonymes), dont une quinzaine de recueils de poèmes.Grand prix Littéraire de Provence en 1994 pour l'ensemble de son oeuvre, il venait de recevoir le prix Mallarmé. Il aura publié son dernier livre Parabole des nuées aux  éditions Tipaza (82 rue du petit Juas, 06400 Cannes) avec des aquarelles de Fumika Sato . Voici ce qu'il écrivait en préambule:
éditions Tipaza (82 rue du petit Juas, 06400 Cannes) avec des aquarelles de Fumika Sato . Voici ce qu'il écrivait en préambule:
"J'habite un pays bleu où le ciel s 'ouvre toujours plus grand que le désir. Toutes les nuances s'avivent ou s'abolissent selon que prévaut la sécheresse ou l"humidité. La lumière ne connaît pas de limite. Elle taille des formes aux contours nets, des arêtes dures, tranchantes. Ni l'esprit ni le coeur ne peuvent ruser. Arbres. roches, maisons, posent dans la distance des choses une évidence au-delà de quoi il n'y a rien. Pas même l'espoir. Regarder le ciel est impossible parce que le regard se perd dans l'expérience toujours inachevée de l'infîni. Non pas celui de la métaphysique - il ramènerait à l'échelle humaine - mais la réalité physique qui s 'impose à l'entendement sans interrogations possibles.
Face à l’azur, on ne cherche pas. On constate. Voilà pourquoi l'homme du sud côtoie quotidiennement le néant. Il vit dans la familiarité de la perte. D'où son sens de la fatalité, la distance ironique, la dérision. Refuser de se laisser abuser par l'apparence est une manière de dominer le désespoir. Quand la nature montre à vif ses os et ses tendons, l'homme entretient un autre commerce avec la mort. Il sait que la pierre en lui sera dénudée, que le temps l'usera jusqu 'à l'âpreté qui le tient droit. Alors seulement, dans la fraîcheur des mots recouvrée, viendront les nuages..."
*
Histoire de faire un signe de parole à Jean-Max Tixier et à Michel Flayeux, je reprends ici une notule écrite lors de la sortie de Profils de chute et autres partitions de Jean-Max Tixier, publié par Michel Flayeux dans ses éditions Telo Martius.
Depuis Toulon, le poète Michel Flayeux , fondateur des éditions Telo Martius, lance sa collection Calypso, livres de poésie au format de poche et au prix modique de 5 euros. Avec l’ouvrage de Jean-Max Tixier nous voilà en pays de connaissance. Dès les premières pages, on reconnaît cette écriture heurtée qui caractérise sa poésie. Sa capacité à briser le mot parce qu’il y « sentait battre (des) ailes ». Sa pratique du poème en prose, son rythme qui sait contenir le lyrisme – Ponctuer, pour lui, c’est mettre le pied sur la gorge de sa propre chanson, comme aimait à le dire Maïakovski – son travail sur la langue, à contre-temps, « pour ne pas voir l’abîme pour que les mots ne retournent pas à la nuit ».
Tixier et son « ardeur à maintenir vivant » montre combien le feu de poésie peut prendre dans la langue et combien sa lumière et sa chaleur nous sont nécessaires.
(j’écrivais cette note en 2005 et elle paraissait dans la RLEL (Revue Littéraire En Ligne) Sans papier du CRDP de l'académie de Nice en 2006.)
Jean-Max Tixier, Profils de chute et autres partitions, (extraits)
« Tu écris pour ne pas voir l'abîme. Pour que les mots ne retournent pas à la nuit. Droit devant. Lucide sans lumière. Tu construis un pont sur le vide. I.'arche du désir qui te soutient. La pierre d'angle est la plus éloignée du mensonge.
La mélopée s'élève d'un campement parmi les ruines. Les voix tissent le fil depuis le premier son. Le souvenir des pluies relie le songe à deschants plus anciens. Quoi d'autre ? La clartévacillante aux lèvres du conteur. Cette terrible ardeur à maintenir vivant. »
16:46 Publié dans Inédits, Mes ami(e)s, mes invité(e)s | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, poésie