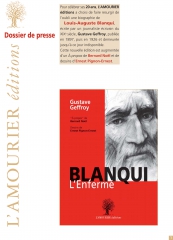19/09/2015
Lu 115- Le Requiem et autres poèmes, Anna Akhmatova
 Avec ce livre Le Requiem & autres poèmes choisis dans lequel Henri Deluy nous donne un choix anthologique des poèmes d’Anna Akhmatova allant de «Le soir » (1912) à ce « Septième livre », qui regroupe des textes de 1936 à 1964, augmenté de « poèmes non repris en livres et poèmes retrouvés », il poursuit son action poétique de traducteur, de passeur d’une langue l’autre – notamment les poètes russes de ce XXème siècle. Juste avant celui-ci en 2014, c’était Voronej, chez le même éditeur, qui regroupe un choix de poèmes extraits des Cahiers de Voronej d’Ossip Mandelstam, écrits en 1935 en exil dans cette ville sur le Don jusqu’en 37 ; en 2013, c’était un choix de poèmes de Boris Pasternak, Quand s’approche l’orage publié par Le temps des cerises ; en 2011, on se souvient de L’amour, la poésie, la révolution, poèmes de Maïakovski avec des collages d’Alexandre Rodtchenko toujours au Temps des cerises ; dans cette remontée du temps, je m ‘arrêterai à L’offense lyrique et autres poèmes de Marina Tsétaïeva, paru chez Fourbis en 2004. Je noterai toutefois deux choses : d’abord qu’à chaque fois, Henri Deluy mêle à sa présentation une chronologie précise et précieuse, ; ensuite, qu’il n’hésite pas à joindre – c’est le cas pour Pasternak, Mandelstam, Akhmatova – les poèmes qu’ils écrivirent à Staline comme en son temps François Villon écrivit sa Ballade de l’appel !
Avec ce livre Le Requiem & autres poèmes choisis dans lequel Henri Deluy nous donne un choix anthologique des poèmes d’Anna Akhmatova allant de «Le soir » (1912) à ce « Septième livre », qui regroupe des textes de 1936 à 1964, augmenté de « poèmes non repris en livres et poèmes retrouvés », il poursuit son action poétique de traducteur, de passeur d’une langue l’autre – notamment les poètes russes de ce XXème siècle. Juste avant celui-ci en 2014, c’était Voronej, chez le même éditeur, qui regroupe un choix de poèmes extraits des Cahiers de Voronej d’Ossip Mandelstam, écrits en 1935 en exil dans cette ville sur le Don jusqu’en 37 ; en 2013, c’était un choix de poèmes de Boris Pasternak, Quand s’approche l’orage publié par Le temps des cerises ; en 2011, on se souvient de L’amour, la poésie, la révolution, poèmes de Maïakovski avec des collages d’Alexandre Rodtchenko toujours au Temps des cerises ; dans cette remontée du temps, je m ‘arrêterai à L’offense lyrique et autres poèmes de Marina Tsétaïeva, paru chez Fourbis en 2004. Je noterai toutefois deux choses : d’abord qu’à chaque fois, Henri Deluy mêle à sa présentation une chronologie précise et précieuse, ; ensuite, qu’il n’hésite pas à joindre – c’est le cas pour Pasternak, Mandelstam, Akhmatova – les poèmes qu’ils écrivirent à Staline comme en son temps François Villon écrivit sa Ballade de l’appel !
Anna Akhmatova ! Vous l’entendez ce nom ce nom de poète – elle s’appelait Anna Garenko – le poète Joseph Brodsky déclare à son propos : « les 5 A d’Anna Akhmatova eurent un effet hypnotique et placèrent la titulaire de ce nom en tête de l’alphabet de la poésie russe », c’est que son « engagement lyrique » fut tel qu’elle ne se sépara jamais malgré les épreuves, les calomnies, les persécutions qui rythmèrent sa vie ni de la poésie, ni de son peuple. De ce lyrisme toujours limpide, précis et retenu – « Il faut que dans le vers, écrivait-elle, chaque mot soit à la place, comme s’il y était déjà depuis mille ans, mais que le lecteur l’entende pour la première fois. » - ce livre en donne pleinement la mesure. Et comme Henri Deluy a eu raison de reprendre ce « Requiem » - « l’un des grands poèmes du XXème siècle » - de 1957, Anna Akhmatova y pose et affronte la question importante entre toutes : celle de l’irreprésentable de la douleur, de l’infigurable d’une situation, de l’impossible compte-rendu d’une réalité. Ainsi à la question qui ouvre le « Requiem », celle de « la femme aux lèvres bleuies » qui attendait devant le prison de Leningrad durant les terribles 17 mois du pouvoir de Iéjov en 1937-1938: « et ça vous pouvez le décrire ? », Anna Akhmatova ose l’impossible de cette réponse : « oui, je peux » pour la chance « d’un sourire sur ce qui autrefois avait été son visage ». Un sourire. De l’humain. Tel est le pouvoir de la poésie. Oui, dans son « Requiem » Anna Akhmatova arrive à nous montrer l’horreur de ces journées dans une image et même si c’est un pas-tout, si l’ampleur du noir ne sera jamais totalement éclaircie, les poèmes d’Anna Akhmatova allument des lampes sur ce moment du temps et sur nous-mêmes. Oui, René Char a raison : « certains jours, il ne faut pas craindre de nommer les choses impossibles à décrire ».
20:04 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anna akhmatova, le requiem
Gustave Geffroy - Blanqui, L'Enfermé, L'Amourier éditions
20:00 Publié dans Mes ami(e)s, mes invité(e)s | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : blanqui, gustave geffroy, l'e, fermé
Turbulence 72- Des migrants
« Tu regardes les yeux pleins de larmes ces pauvres émigrants (…) Une famille transporte un édredon rouge comme vous transportez votre cœur »
Apollinaire, Zone
19:45 Publié dans Dans les turbulences | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : apollinaire
Turbulence 71- De la misère
Hier, 22 février, j’allais à la Chambre des Pairs. Il faisait beau et très froid, malgré le soleil de midi. Je vis venir rue de Tournon un homme que deux soldats emmenaient. Cet homme était blond, pâle, maigre, hagard ; trente ans à peu près, un pantalon de grosse toile, les pieds nus et écorchés dans des sabots avec des linges sanglants roulés autour des chevilles pour tenir lieu de bas ; une blouse courte, souillée de boue derrière le dos, ce qui indiquait qu’il couchait habituellement sur le pavé ; la tête nue et hérissée. Il avait sous le bras un pain (…) Le regard de l’homme fixé sur cette voiture attira le mien. Il y avait dans la voiture une femme en chapeau rose, en robe de velours noir, fraîche, blanche, belle, éblouissante, qui riait et jouait avec un charmant petit enfant de seize mois enfoui dans les rubans, les dentelles et les fourrures. Cette femme ne voyait pas l’homme terrible qui la regardait. Je demeurai pensif.
Cet homme n’était plus pour moi un homme, c’était le spectre de la misère, c’était l’apparition, difforme, lugubre, en plein jour, en plein soleil, d’une révolution encore plongée dans les ténèbres, mais qui vient . Autrefois, le pauvre coudoyait le riche, ce spectre rencontrait cette gloire ; mais on ne se regardait pas. On passait. Cela pouvait durer ainsi longtemps. Du moment où cet homme s’aperçoit que cette femme existe, tandis que cette femme ne s’aperçoit pas que cet homme est là, la catastrophe est inévitable.
VICTOR HUGO -Choses vues - 1846
19:42 Publié dans Dans les turbulences | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : victor hugo
Lu 114- Daniel Biga, Bienvenu à l'Athanée, L'Amourier éditions
 Daniel Biga, c’est Nice. C’est un amour douloureux de Nice. Et même s’il en a souffert et souffre encore bien des colères par manque d’air, caractéristique essentielle de toutes les erreurs, les catastrophes, voulues ou pas, fruits des incompétences parfois et de l’avidité de quelques-uns toujours, il en aime toujours la beauté doublée de cette fragilité qui la rend si précieuse et si poignante. Et la langue qui erre, aujourd’hui, fantomatique sur les lèvres de quelques ombres. Qui toujours plus s’effacent.
Daniel Biga, c’est Nice. C’est un amour douloureux de Nice. Et même s’il en a souffert et souffre encore bien des colères par manque d’air, caractéristique essentielle de toutes les erreurs, les catastrophes, voulues ou pas, fruits des incompétences parfois et de l’avidité de quelques-uns toujours, il en aime toujours la beauté doublée de cette fragilité qui la rend si précieuse et si poignante. Et la langue qui erre, aujourd’hui, fantomatique sur les lèvres de quelques ombres. Qui toujours plus s’effacent.
Daniel Biga, c’est une vie artistique exemplaire que deux sources alimentent : les arts plastiques d’une part – on oublie souvent sa participation, au début du moins, à ce que l’on a fini par appeler L’école de Nice – et la poésie, la littérature d’autre part – je pense à sa participation dès 1962 à la revue Identités de Marcel Alocco, Jean-Pierre Charles, Régine Lauro…Là, la modernité se trouvait convoquée et interrogée. La pratique du cut-up – héritée des poètes de la Beat Generation – et du collage a toujours correspondu pour lui à la rumeur de fond du monde, à la multiplicité des voix, au tohu-bohu des images. Dans son œuvre : tons, idées, accents, langues se mêlent, s’entremêlent pour favoriser l’émergence d’un drôle de millefeuilles, produit d’une écriture épaisse, crémeuse et craquante à la fois, une écriture en volume que l’on trouve d’une part dans ce fronton que lui consacre la revue Friches dans son n° de février 2013 ( ) comme dans ce Bienvenue à l’Athanée qui vient de paraître dans le Fonds poésie des éditions de l’Amourier (2012, 13 euros).
Outre ce titre à l’humour noir dévastateur, l’originalité de ce livre est qu’il est précédé de deux autres textes plus anciens et aujourd’hui épuisés : des extraits d’Histoire de l’air paru en 1984 et Sept anges paru en 1997. Or entre ces trois textes, aux écritures pourtant bien différentes comme s’il s’agissait des traces que laisserait la pointe d’un sismographe qu’on aurait placé en prise directe sur différents moments de ton existence, ça circule et ce qui circule, c’est une figure : celle de l’ange, cet étrange messager qui n’est pas que la pure figure d’ un pur esprit mais au contraire le compagnon quotidien, l’intermédiaire entre l’homme et le Tout Autre – le Rien ou le Tout, Daniel Biga s’en moque ! Pour lui, l’ange est du côté « des ombres, des fusains, des plantes, des miroitements, des eaux légères, des reflets, des parfums, des effleurements, des ondes, des caresses imperceptibles ». Il est moins le secret que ses abords multiples.
Il ya dans la poésie de Daniel Biga l’affirmation d’une forte présence au monde jusque dans ce qu’il a de plus âpre : la solitude, la perte, le déclin, la mort. Aimer le monde, c’est aussi arriver à pouvoir dire oui à l’inacceptable et pourtant totalement invitable, celui de toute mort.
A l’Athanée, on nous attend ! La Poévie de Daniel Biga – Il a inventé ce mot-valise pour signifier cette fusion, cette relation d’infusant/infusé entre la poésie et la vie/la vie et la poésie –force les passages, va de l’avant contre toutes les aliénations que notre monde secrète à l’envie. Cette force d’insoumission, Daniel Biga ll’installe au cœur de la langue, il la jazze. Dans Bienvenue à l’Athanée, on a ce tissage/métissage de tons, de sons, de langue (l’anglais y côtoie le Nissart !) ; ces ruptures de syntaxe, ces jeux de mots, ces collages/citations. Daniel Biga coupe, ravaude, crie, harmonise soudain, fait silence. Ça « mezcle » pour donner cours à une figure de la poésie.
Il est urgent de lire Daniel Biga pour son amour de la saveur mortelle du monde, son goût de l’intériorité, son sens tout particulier de la recherche spirituelle, sa pratique singulièrement jouissive de l’écriture poétique qui ouvre le poème sur émotions et vie nouvelle.
Bienvenue à l’Athanée, ce dernier saloon où l’on cause Poévie est aussi un salut aux vivants que nous sommes !
*
Signalons trois autres parutions : Séparation aux éditions GrosTextes, la revue Friches Le Gravier de Glandon, 87500 Saint-Yrieix) de février 2013 qui lui consacre un dossier et le Réédition au cherche Midi de l’Amour d’Amirat, Né nu, Killroy was here et Oiseaux mohicans.
19:18 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : daniel biga, l'amourier
Lu 113- Rienzi Crusz, L'amour là où les nuits sont vertes, L'Amourier éditions
Rienzi Crusz ? ça ne vous dit rien, n’est-ce pas ? Et pour cause. Le voilà édité pour la première fois en France traduit par Isabelle Metral de cet anglais que l’on parle au Canada et dont elle a su capter les vibrations jusqu’à les faire résonner dans notre langue. Rienzi Crusz est né à Galle à Ceylan (maintenant Sri Lanka)en 1925. Il s’est établi depuis 1965 au Canada où il réside actuellement.
Sa poésie sent la route – là où est l’âme disait Deleuze à la suite de Kerouac – l’errance, les changements de direction, les carrefours où l’on s’arrête le nez dans les parfums et les yeux loin devant dans les couleurs quand c’est « l’heure de la surprise », quand « le divin (prend) chair », « (fait) jouer les humeurs prodigues / des hommes, le pot-pourri du monde / en une neuve symphonie » et fait signe vers « le pays immigré / sans saison contraire », le « vert pays » !
Là où les nuits sont vertes , là est l’amour, cet amour dont Rimbaud qui avait rêvé des « nuits vertes aux neiges éblouies » disait qu’il « (était) à réinventer ».
Ah ! Le vert ! Il est bien la couleur dominante de ce recueil de Rienzi Crusz ! C’est que « le paradis des amours enfantines » était vert lui aussi déjà chez Baudelaire – vous vous souvenez de ces « violons vibrant derrière les collines ». Du côté de Ceylan, de l’enfance de Rienzi Crusz, il y eut de tels violons. Leurs vibrations passaient au vert ces fragments de paysage, ces recoins d’enfance, ces gestes qui reviennent dans les poèmes témoigner de cette traversée nocturne, de ce travail de terrassier et de carrier qu’est l’écriture poétique quand elle cherche à déboucher à l’air libre. Cet air dont nous avons tous besoin, vous le trouverez dans L’Amour là où les nuits sont vertes, il souffle entre les poèmes, entre les vers de Rienzi Crusz.
19:15 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : rienzi crusz, l'amourier