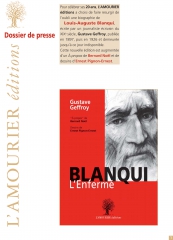03/04/2017
Michel Ménaché à propos de Michel Butor, Commémoration pour le drapeau noir, Rencontres littéraires de Haute Provence, Editions Au coin de la rue de l'enfer
Poèmes du grand âge, Michel Butor se souvient, et prolonge sa rêverie existentielle, dans un élégant recueil dont la couverture a été dessinée par Youl Criner, concepteur de nombreux livres d’artiste. Dans A travers les trous du calendrier, l’amour des livres le dispute aux élans révolutionnaires. Epoque des discussions qui n’en finissent pas de remodeler le monde. La foule de mai 68 « a secoué les grilles » du passé mais l’avènement « du temps qu’on aurait le temps » s’est perdu dans les chausse-trappes du théâtre des illusions. Le poème intitulé A dessein évoque l’épopée de l’écriture : des graffiti des cavernes aux « livres machines » d’aujourd’hui. Décalage permanent entre les progrès des sciences appliquées et la nostalgie des pratiques archaïques, le but suprême de toute impression des langages, quel que soit le support, aura été de nous fournir « la clef des champs » ! Le poète vieillissant évoque le jeune écolier qu’il fut et son chemin de vie. Commémoration pour le drapeau noir revient sur les espérances révolutionnaires déçues. Le drapeau rouge a noirci. Les repus ont repris le dessus face aux damnés : « sur le deuil des forêts le réquisitoire fragile égrène son glas. » Enigmatique fête galante, Les demoiselles du pont noir se baignent nues, dans les remous des fantasmes tandis que s’estompent les fantômes du temps perdu. Dédié à feu Pierre Leloup, compagnon de route et complice des nombreux livres d’artiste qu’ils ont réalisés ensemble, Le thrène des pneus, plus qu’une lamentation funèbre, salue toutes les formes d’invitation au voyage et s’ouvre sur une méditation teintée de regret quant à la transformation des engins rutilants en épaves… Enfin, après avoir évoqué les maux de la vieillesse dans le poème Santé, Butor, dans Ultrasensible, rend hommage à nos cinq sens pour célébrer, défiant l’échéance du dernier souffle, son art de vivre…
Le même éditeur publie un élégant cahier constituant les actes des « Rencontres littéraires en Haute Provence » qui se sont tenues à Forcalquier le 8 juillet 2012, autour de Michel Butor. Mireille Calle-Gruber, directrice de l’édition des Oeuvres (provisoirement) complètes*, ouvre la journée en présentant les intervenants. On retiendra tout particulièrement l’exposé d’Alain Freixe sur Butor d’abord révélé comme poète grâce à sa relation de partage avec les peintres : « Poésie. Le mot chez Butor […] dépasse les oppositions de genre, aussi traditionnelles que figées. » Poésie qui aide l’homme à se construire et à maintenir : « Maintenir l’homme comme chance. » Colette Lambrichs se souvient de ses 13 ans, quand Butor, couronné par le Renaudot pour La Modification, vient dîner à Bruxelles chez son père, frère de Georges. Le fameux roman a joué dans sa vie « le rôle annoncé par le titre. » Vahé Godel s’exprime en ami, en voisin et en familier des rencontres rituelles autour de Butor : avec André Clavel, Jean-Charles Gateau, Nicolas Bouvier, etc. Si, avec Butor la relation était littéraire et pédagogique, c’était aussi « la fête ! » La comédienne Monique Dorsel, le philosophe Eberhard Gruber, Marie Minssieux et Jean-Luc Parant ont également participé à cet événement fraternel sur le thème : Des expériences du livre, avec Michel Butor
Michel MÉNACHÉ
*Michel Butor, Œuvres complètes en 12 volumes, éd. De la Différence (à paraître dans CCP, revue en ligne, janvier 2016)
18:07 Publié dans Mes ami(e)s, mes invité(e)s | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : micjel menassé; michel butor
19/09/2015
Gustave Geffroy - Blanqui, L'Enfermé, L'Amourier éditions
20:00 Publié dans Mes ami(e)s, mes invité(e)s | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : blanqui, gustave geffroy, l'e, fermé
07/08/2015
Marc Delouze – Extrait de C’est le monde qui parle, édition Verdier, 2007
"Le cœur me serre au souvenir de l’église de la Multiplication des pains, que des extrémistes juifs viennent de brûler, sur le bord du lac Tibériade.
J’évoquais la magie de ce lieu dans ce texte paru dans mon récit C’est le monde qui parle, paru en 2007 aux éditions Verdier, écrit Marc Delouze, en partager le souvenir est une manière de le faire perdurer…"
Et bien voilà...
(…) oubliant la moderne laideur de la ville de Tibériade je contourne le Mont des Béatitudes, évitant du même coup la puanteur ronronnante des autocars qui expectorent leur haleine de fuel sur les oliviers chétifs et millénaires, et les lentes cohortes de pèlerins à casquettes de base-ball dont les visières démesurées ont dévoré les yeux, zigzagant entre les cabanes de bergers abandonnées aux détritus et aux excréments
Heureux les doux car ils posséderont la terre
je traverse les vapeurs bleues d’oxyde de carbone de la plaine de Génésareth, dépasse Magdala, arrive enfin sur le parvis de la toute neuve basilique de la Multiplication des Pains
Tabgha, Khfar Nahum
où une ovation confuse de milliers d’oiseaux m’accueille, à l’intérieur de l’édifice pas plus grand qu’une grande chapelle la pureté des lignes appelle à la prière des simples, avançant de quelques pas vers le chœur sous la protection des dix robustes colonnes dont les chapiteaux corinthiens supportent les murs épais qui eux-mêmes supportent la nef de bois, je m’aperçois que mes pieds flottent sur des mosaïques d’eau
comme des tapis précieux tendus sur le sol de l’église. Elles forment dans la nef centrale une fine résille à losanges dans les petites pierres de laquelle sont incrustées de menues rosettes cruciformes. Elles montrent un monde végétal luxuriant et vingt-deux espèces d’oiseaux divers représentés tantôt seuls et tantôt par paires, les unes vis-à-vis des autres, par exemple un flamand et un serpent, et, tout à côté un couple de canards qui, tous deux posés sur un calice de fleurs, se bécotent amoureusement
je m’assois sur un banc de bois blanc, un peu à l’écart de la dizaine de retraitants disséminés dans les travées, une bouffée de rires me fait soudain me retourner, une troupe de jeunes religieuses vietnamiennes vient de franchir le porche et, pouffant en silence, remonte le long de la nef jusqu’au premier rang où elle s’assoie dans un froissement de tissu empesé, à ce moment s’ouvre une petite porte dérobée située derrière l’abside, des Dominicains allemands entrent en file indienne et se déploient en une mouvante couronne de cierges autour de l’autel sous lequel je découvre un énorme cailloux sortant du sol
la pierre sur laquelle Jésus posa les cinq pains et les deux poissons dont il nourrit cinq mille hommes et femmes venus l’écouter en son désert, son érémos
les cloches annonçant les vêpres je me lève, me glisse dans l’ombre d’un pilier, regarde, écoute les cantiques qui emplissent l’espace, saisi de stupeur face à la beauté du monde qui pour moi ne porte pas le nom de Dieu
(mais celui d’un poème intime plié dans ma mémoire)
je ferme les yeux, quand les chants ont cessé de creuser leur sillon sacré dans la glaise du silence, je sors et vais m’asseoir sur la pierre blanche et tiède du Bassin aux Sept Poissons situé au centre d’un cloître minuscule qui me paraît propice à la méditation des athées, persuadé que toute parole prendrait immédiatement la forme d’un chardon coincé entre ma langue et mon palais
(gare à qui ose saigner)
une méduse de silence flotte autour de ma bouche, le jour libère ses fragrances d’orangers, de lauriers, de rosiers, appuyant mon corps sur la terre, je pétris une pâte faite de feuilles, de fleurs, d’insectes, je deviens terre, ma tête devient ciel, mes doigts sont des petits cailloux froids et durs, saisi par une soif absolue, buvant aux sept sources du ciel, j’offre mes lèvres à la lune qui me tend son bol de lait (…)
* Marc Delouze – Extrait de C’est le monde qui parle, édition Verdier, 2007
Marc Delouze
Les Parvis Poétiques
01 42 54 48 70
www.parvispoetiques.fr
19:44 Publié dans Mes ami(e)s, mes invité(e)s | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : marc delouze
Michel Ménaché a lu Zócalo d'Adonis, (traduit de l’arabe par Vénus Khoury-Ghata) paru au Mercure de France
Poète arabe majeur, originaire de Syrie, Adonis est le chantre de la migration et de l’unité des civilisations humaines considérées dans leur singularité respective. Son dernier recueil, Zócalo, inspiré par un voyage récent à Mexico illustre parfaitement cette aspiration à faire dialoguer les cultures et les mythes, quelle que soit la distance géographique qui les sépare.
Zócalo - le socle (sans statue ni colonne !) - est le nom donné à la célèbre place de la Constitution, au centre de Mexico, lieu où sont célébrés ou improvisés les événements marquants de l’histoire mexicaine. Mais c’est d’abord aux Mayas que le poète rend hommage, en 96 proses émaillées de courts fragments en vers libres. Une anaphore lumineuse ouvre, traverse et clôt tout le recueil : « Le soleil aime le chemin des Mayas. »
Plusieurs tragédies historiques sont évoquées, en particulier les hérétiques suppliciés aux temps obscurs de l’Inquisition, Trotzky assassiné sur ordre de Staline, par Ramon Mercader del Rio : « Le spectre de la révolution sur mes épaules, je suis entré dans la maison où il fut tué et enterré auprès de sa femme, Natalia Sedova. Le soleil soufflait ses poussières dans tous les angles. » Les variations sur ce destin tragique constituent une méditation métaphorique d’une grande force expressive : « Couvrez le corps du nord avec la robe du sud. Déchirez le fer de l’occident avec la soie de l’orient. Ce soir j’allumerai une bougie et crierai : toute prophétie est crépuscule, Trotzky, l’homme est l’aurore de l’univers. » L’espérance révolutionnaire anéantie, celle de toute une génération, laisse sur une terrible impression de gâchis humain : « que de sang versé pour célébrer ton arrivée, Avenir, et tu n’es pas venu. Le soleil est un lézard rouge. » Sentiment de trahison, aussi : « des couteaux à avaler. » Un éclat de dérision interroge les poussières de l’Histoire : « Etait-ce pour se souvenir des loups de la révolution que Trotzky éleva des lapins les dernières années de sa vie ? »
La mythologie habite cette poésie de la rencontre féconde. La visite du Musée anthropologique de Mexico gonfle le chant d’images bariolées. Adonis s’abouche au « Dieu-soleil », se lance sur les traces du « singe-araignée. » Tout le bestiaire maya s’anime. Le Quetzal, oiseau sacré, est célébré par le poète avec une touche d’humour. La comédie sociale se mesure à l’aune des plumes de l’habit : « Je t’envie, oiseau sacré, et envie les gouverneurs parés des plumes de ta longue queue. / On dit : à tes vêtements, homme, on sait qui tu es, et à quelle classe sociale tu appartiens. / L’habit est un miroir. / L’habit est une échelle. / L’habit coud celui qui le porte. / L’apparence révèle l’essence. / Sois béni, coton, magie des simples. // Donnez-nous des coquillages pour écrire et dater l’Histoire. »
Le poète se veut passeur de culture, porteur d’eau des origines : « Qui nous expliquera la trace de nos pas, où l’invisible devance son frère le visible, buvant l’eau de Sumer dans la jarre des Mayas ? » Faire entrer le monde dans un poème, tel est son pari : « Caverne donne tes seins à cette chauve-souris / La terre entière : maison d’une même famille. »
Le poète, enfin, dans les dernières proses du recueil, intitulées chants (de 1 à 19), s’inquiète du massacre des langues et de la perte des héritages culturels : « Aujourd’hui, on tue l’alphabet, lettre après lettre. Où trouver les mots qui disent les choses qui viennent de naître ou qui naîtront demain ? Des mots lavent leur corps dans d’étranges bassines, loin de la maison du dictionnaire. » Une fantaisie ludique perce toutefois dans une des dernières pièces du recueil avec la vision d’une bacchanale universelle : « Le ciel s’est-il jamais soûlé qu’avec les paroles d’une terre amoureuse ? »
Des chemins des Mayas, aux carrefours de l’improbable, Adonis amène le lecteur de la place emblématique de Zócalo, à travers le tourbillon des mythes locaux et universels, jusque dans les bouleversements du monde réel. Il faut saluer ici le rôle singulier de Vénus Khoury-Ghata qui a su traduire la luxuriance solaire des images, la palette des couleurs, la puissance évocatrice de cette échappée belle en terre maya d’hier avec un regard d’aujourd’hui…
EUROPE n° 1017-1018 (janvier-février 2013)
19:34 Publié dans Mes ami(e)s, mes invité(e)s | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ménaché, adonis, mercure de france
10/10/2014
In memoriam Charles Dobzinski - II - Texte d'André Velter lu à la Maison de la poésie de Paris le 18 juin 2012
CHARLES DOBZYNSKI,
AUX BASQUES DU DESTIN
Voilà qui est très rare, cette force d’évidence,
ces mots si simples qui sortent d’une si longue nuit,
ce tempo intime sans effet aucun, sans autre écho que celui
qui traîne de naissance et à vie aux basques du destin.
Être qui, être quoi, et moins que rien, et plus que tout, ce Juif qui se cherche ?
Comment devenir ce qui est imposé et donné hors de soi, malgré soi ?
Impossible de jouer avec ce Je là qui n’est pas un double ni un hétéronyme
mais un legs arraché aux exils, aux exodes, aux pogroms par les mains d’une mère.
Charles Dobzynski n’a pas à décliner une identité vraie ou fausse,
il est par les lieux et les errances, par les convois et les commotions de l’Histoire
toujours à se déprendre d’une partie prenante,
toujours à casser les dogmes, à soigner son humour, à se défier de Dieu.
Avec ce livre d’une tenue qui tient du miracle,
il se révèle témoin majuscule du siècle des utopies sanglantes,
irréductible et juste voix de cette poésie vécue
qui engage l’être tout entier sans renoncer jamais à son pouvoir d’effraction.
Depuis les Feuillets d’Hypnos ou La Rose de personne,
Je est un Juif* est une œuvre décisive comme il y en a peu
dans le champ de la conscience et de la parole salvatrice,
surtout par temps de mise aux normes et d’amnésie programmée.
En fait, et tout uniment, Je est un Juif est un chef-d’œuvre.
* Charles Dobzynski / Je est un Juif / Éditions Orizons
09:56 Publié dans Mes ami(e)s, mes invité(e)s | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charles dobzynski, andré velter
01/10/2014
In memoriam Charles Dobzynski - I -
 Charles Dobzynski, poète, traducteur, animateur infatigable de la revue Europe, après avoir collaboré à Ce soir, Action poétique,aux Lettres françaises et à Aujourd'hui poème, est mort le 26 septembre à quatre-vingt-cinq ans. Il laisse le souvenir d’un homme engagé et une oeuvre considérable. La bourse Goncourt de la poésie lui a été attribuée pour l’ensemble de son œuvre en 2005.
Charles Dobzynski, poète, traducteur, animateur infatigable de la revue Europe, après avoir collaboré à Ce soir, Action poétique,aux Lettres françaises et à Aujourd'hui poème, est mort le 26 septembre à quatre-vingt-cinq ans. Il laisse le souvenir d’un homme engagé et une oeuvre considérable. La bourse Goncourt de la poésie lui a été attribuée pour l’ensemble de son œuvre en 2005.
Aux éditions de l'Amourier, il avait confié 3 titres: Le Réel d'à côté , L'Escalier des questions et La mort, à vif
En hommage à celui qui disait que sa conception du poétique était "un horizon qui tourne et que nous devons essayer de capturer dans nos recherches", j'aimerais reprendre ici un fragment de l'entretien qu'il m'avait accordé en 2006 lors de la réédition de son "Escalier des questions" et dont vous trouverez l'intégralité sur le site amourier.com, rubrique Basilic. Il s'agit du N°10 que vous pouvez télécharger).
Alain Freixe : Dans le chapitre intitulé “ Si je t’oublie Sri-Lanka ”, on apprend que cet escalier des questions renvoie à une légende affectant le rocher de Sigirya, qu’il est sans commencement, qu’il n’a de fin ni dans le ciel ni dans l’ultime goutte de la pluie ”. On apprend qu’il n’est pas orienté, que “ l’étage de la splendeur ” n’est pas plus en haut qu’en bas, double horizon toujours sous les nues. Pour l’homme qui marche, pour le poète, pour vous comme le disait l’un des beaux titres d’André Frénaud – bien injustement oublié à mes yeux – “ il n’y a pas de paradis ”…
Charles Dobzynski : L’Escalier des questions n’existe qu’en tant que mythe. J’ai forgé ce titre à partir d’un souvenir : la montée de l’escalier en spirale de l’étonnant rocher karstique de Sigirya, au Sri-Lanka. La paroi rocheuse que gravit cet escalier métallique est ornée de fresques anciennes aux sujets légendaires. Je n’ai pu atteindre la plateforme supérieure et ses lions de granit, surpris par un violent orage qui m’a contraint à redescendre en quatrième vitesse. Cette plateforme est “ l’étage de la splendeur ” où je ne suis pas parvenu, comme interdit par le destin. Cette mésaventure de l’interruption, sous la pluie battante et les éclairs, m’a posé le problème des commencements et des fins, des désirs et des velléités. Pour moi, l’escalier n’a jamais pris fin. Il est resté en suspens. Il est resté en question. Qu’aurais-je vraiment trouvé là haut, en supposant que j’atteigne ce qui est supposé être le paradis, un degré de l’altitude d’où la vue devient infinie ?
Alain Freixe : Ainsi donc s’écrit le temps. Marche à marche. Question après question. Sans prise. En prose ! Car sont poèmes en prose les marches qui composent cet escalier des questions. De courts récits souvent insolites qu’un humour aux arêtes vives met souvent en scène. On pense à Michaux, à Monsieur Plume…
Charles Dobzynski : Oui, le temps s’écrit en marchant, en montant, parfois sans but défini. Mais on peut aussi, par la spirale de la mémoire, le redescendre en sens inverse et modifier du même coup la perspective. Nous avançons dans notre vie par degrés successifs et souvent par les degrés de questions non résolues, de mystères qui sont des marches dans l’obscur, et ces questions sont des brèches dans notre généalogie. Chaque bref récit a pour composante un souvenir, qui est en même temps le noyau d’une question. Certes, on y habite l’insolite. On y erre dans le dédale de l’étrangeté. C’est par l’étrangeté que l’on se découvre, que l’on repère sa singularité. Et l’humour aide à cisailler les barbelés des idées toutes faites.
Alain Freixe : Puis-je me permettre une dernière question, plus générale celle-là. Elle concerne la poésie en son présent. Vous êtes un homme de revue, engagé dans l’histoire de la poésie de ces quarante dernières années, comment décririez-vous le paysage de la poésie française d’aujourd’hui ? Vous-même où vous situeriez-vous ?
Charles Dobzynski : J’ai le sentiment que la poésie est aujourd’hui plus vivante que jamais, multiple, à l’école buissonnière des prédicats et des dogmes. Elle se cherche des ouvertures, des écoutes nouvelles, plutôt que des sophistications qui aboutissent à des impasses. Les écritures se font plus sensibles au réel, au subjectif, à l’intime redéployé. Les chapelles tournent au clan et les anathèmes d’un certain terrorisme esthétisant tournent à vide. Le paysage poétique est émaillé de réminiscences, de désirs, de pulsions amoureuses et d’une volonté de changer que ne favorise pas toujours l’émiettement des structures poétiques. Je me félicite de la diversité, de la pluralité des tendances. Mais le vers, fût-il autrement commandé, doit rester le vers, porteur, comme un fil, de l’électricité poétique. En ce qui me concerne, outre le travail critique que je poursuis à Europe et à Aujourd’hui Poème, en dehors de tout esprit de chapelle, j’essaie par la poésie de tirer un peu de lumière d’un puits sans fond. Je ne me situe que par rapport au devenir, à la liberté que je revendique, une liberté qui ne se contente ni du jeu ni du système de destruction des formes. J’ai été un enfant – tardif, c’est vrai, – du surréalisme, puis de la Résistance. Aujourd’hui, je refuse tout cadre préétabli, car je sais que je me transforme avec la poésie, avec l’écriture. Chaque étape sur cette voie, chaque livre, participent d’un mouvement qui est peut-être aussi un recommencement.
18:11 Publié dans Du côté de mes interventions, Du côté de mes publications, Mes ami(e)s, mes invité(e)s | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : charles dobzinski
07/08/2014
Michel Ménaché a lu "Lieu païen" de Mohammed bennis publié aux éditions de l'Amourier
Mohammed Bennis* revendique aussi bien l’héritage de la poésie arabe conjuguant l’amour à la mystique que le renouveau de la langue arabe classique, « acte de naissance dans l’exil » qu’il refuse d’abandonner aux fondamentalistes : « La voix de la poésie arabe ancienne m’accompagne et me libère de toute sorte de soumission », confie-t-il à Alain Freixe dans un entretien que publie Basilic, gazette de l’association des amis de l’Amourier. Les cinq longs poèmes qui composent le Livre païen correspondent aux cinq espaces d’une quête qui s’ouvre sur le mausolée d’un mystique face à l’océan, Canicule de la mer, suivi de Rocher de fièvre ; l’auteur confronte dans Hiéroglyphes sa mort inéluctable à celle des morts de l’ancienne Egypte, cherche son chemin ou le perd entre sable et musique dans Désert au bord de la lumière puis achève, ou plutôt laisse en suspens sa quête, avec Un nuage traversant le silence.
Cette poésie associant le mythe et le chant prend la forme de l’éternel retour, « l’écriture d’un corps en face de sa mort », la parole poétique étant vouée à la solitude absolue. Ecriture de la fragmentation qui crée un effet de chœur mystique des voix multiples du poème : « le secret de la voix / est un de mes secrets. » Si les éclats métaphoriques ne construisent pas un sens immédiatement déchiffrable, ils tendent à l’extrême de la parole : « que celui qui dort sous les images change comme il veut et quand il veut la solitude du soleil. » La quiétude retrouvée face aux vagues qui « répètent l’image des peuples », soulève l’âme du poète et libère sa contemplation métaphysique : « Qui es-tu en ton exil / qui t’a mis visage face au portail de la mer / pour examiner le silence […] Ô illuminés sortez de vos cellules / réveillez-vous en palmiers / environnés par les espaces / du pays de la plénitude. »
Dans le second poème, Rocher de fièvre, la méditation oscille entre l’intime et l’infime, entre l’ici et l’infini : « Soudain une chose s’est effritée / tes mains reviennent d’une profondeur / qui touche le génie des ancêtres / Comment le désastre ne croit-il pas en lui. » L’obsession de la mort récurrente dans tout le recueil fulgure : « Que mes pieds aillent entre cri et douleur / Ceci est le lit du silence / Chronique pour corbillard. »
Hiéroglyphes s’ouvre sur « Tout un horizon d’argile / Et l’éternité qui pend comme une grappe… » Le chemin de soi se faufile dans le labyrinthe des effrois et des spectres : « Le sang obéit / à qui le fait couler / Nuage ou poussière / ou lueurs subtiles / ont tatoué sur mon épaule / des rides de rage. » Décrypter les frises « au seuil du silence » confère aux morts le pouvoir d’habiter le présent. La mémoire d’un passé perdu brûle : « « Des destin vêtus de leur durée / lisent le sens qui déborde des cicatrices / Cortège de solitaires / Les voies lentes se préparent / à recevoir les passagers glorieux / Elles élargissent leurs méandres. »
Désert au bord de la lumière est dédié à Adonis. Mohammed Bennis joue sur la force du symbole paradoxal : « Au commencement le sable est un pont / les pas mènent au sang de la fin / Mais point de fin pour qui élargit / la source de la soif. » Si « aucun horizon ne dure », le poète doute, se convainc de la vanité de toute chose, multiplie les renversements de sens mais affirme avec force : « J’ai soif de l’étranger. » Une typographie triangulaire figure une strophe en toupie s’amenuisant jusqu’à la pointe : « Le sable est plein de blessures, comme si, / avec une rapidité d’expert, un / sabre apposait des signes. / Comme si le pied d’une / danseuse, un anneau / à la cheville, ta / touait son / immen / sité. » A force de solitude, le poète prétend chercher l’amour où il se perd et défie avec cran le destin qu’il s’est choisi : « je proclame ma résidence dans sa poussière. »
Un nuage traversant le silence, dernier mouvement, est composé en quatre parties. Le poète dit à la fois l’ambition et les limites de sa quête existentielle : « Ma main s’est détournée de moi » ou encore : « j’essaie un sens qui paralyse les doigts. » Le poète a le sentiment d’une épreuve dont les limites sont sans cesse perdues, repoussées : « Mais toi tu explores une étendue coupée en morceaux et recousue Chaque fois tu te retrouves derrière des variations dont tu examines la force […] Mes souffles sont dispersés et j’ai la fièvre du chemin. »
A l’appel de la poésie, Mohammed Bennis en éveil, avec la pluralité des voix qui peuplent sa solitude fait résister, face à ceux qui la dévoient, la langue des maîtres de la poésie arabe.
*Mohammed BENNIS : Livre païen, traduit de l’arabe par l’auteur avec Bernard Noël, éd. L’Amourier 16 €
17:27 Publié dans Mes ami(e)s, mes invité(e)s | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ménaché, mohammed bennis, mizu pa*ien
05/07/2014
Michel Ménaché a lu "L’AMOUR AU FÉMININ : LES FEMMES-TROUBADOURS ET LEURS CHANSONS (Introduction et traduction de Pierre BEC, édition bilingue)
Trop souvent ignorées, les voix féminines de la poésie médiévale* représentent environ un quart des manuscrits retrouvés. Il est donc heureux que la lyrique féminine des trobairitz, cultivée dans l’ombre de la production masculine, soit prise en considération. Pierre Bec, médiéviste et spécialiste de la littérature occitane, présente et commente dans la collection « Troubadours » éditée par Fédérop, un choix significatif de textes de femmes-troubadours. Il note que si les formulations troubadouresques sont globalement les mêmes pour les hommes et les femmes, certaines chansons anonymes ou mal identifiées soulèvent le doute entre l’oeuvre d’un auteur de sexe féminin (le je scriptural) et la féminité textuelle (le je lyrique) pouvant être la projection fantasmée d’un homme. Ces confusions de genre existent déjà dans la tradition galégo-portugaise des cantigas (Tout comme la littérature universelle abonde de textes érotiques faussement attribués à des femmes). Pierre Bec relève en outre que les rares biographies (vidas et razos) ne font pas de discrimination fondamentale entre trobairitz et troubadours. Hommes ou femmes, les troubadours participent du même monde aristocratique. Les trobairitz (dòmnas, « tour à tour grandes dames, épouses d’un seigneur féodal, aimantes ou femmes adorées, protectrices et mécènes, médiatrices et conseillères, inspiratrices et poétesses »)étaient souvent socialement supérieures à leurs amants (cavaliers). L’ouvrage distingue les cansós (chansons troubadouresques d’amour courtois, -la fin’ amor-) des tensons, discours ou dialogues à deux ou trois voix sur des questions de casuistique amoureuse dans lesquelles la dòmna se présente comme médiatrice tentant de réconcilier des amant brouillés.
Les cansós (composés en strophes de vers rimés : coblas et tornades) constituent la première partie de l’anthologie. Une seule chanson retrouvée d’Azalaïs de Porcairagues (qui aurait vécu dans la deuxième moitié du XIIème siècle) l’a fait considérer presque l’égale de la Comtesse de Die et de Na Castelosa. Cette chanson d’amour contrarié mêle joie et mélancolie : « Jongleur qui a le cœur gai / Porte là-bas vers Narbonne / Ma chanson et sa tornade / À dame jeune et joyeuse. » Bieiris de Romans nous laisse le seul poème d’amour connu d’une trobairitz écrit par une femme à l’adresse d’une autre femme. La formulation érotique ne se voile pas derrière un paravent mystique : « Car en vous est mon cœur et mon désir / […] Et c’est pour vous que souvent je soupire. » Thème récurrent de l’amour courtois, dans une de ses quatre chansonsidentifiées, Ami, si je vous trouvais franc (six coblas suivies d’une tornade), la trobairitz Na Castelosa vibre de tout son amour déçu et soupire pour son chevalier infidèle : « Vous qui êtes mon mal et ma souffrance […] Je ne devrais avoir joie de chanter / car plus je chante / et plus j’ai mal d’amour. » Souffrance de même nature pour Clara d’Anduze amoureuse d’Uc de Saint-Cire (milieu du XIIIème siècle). Azalaïs d’Altier, proche d’eux, elle-même auteur d’une épître amoureuse unique en son genre, s’offre en médiatrice pour réconcilier les deux amants. Quant à la célèbre comtesse de Die dont les chansons comme celles de Na Castelosa sont parmi les plus belles et les plus passionnées de la fin’amor, elle nous livre les plaintes pathétiques d’une malmarida (mal mariée) trahie par son amant : « Car il me plaît de vous vaincre en amour / […] Bien me surprend ami votre arrogance / Et mon cœur a bien sujet d’être triste / De vous voir ravir mon amour par une autre… » En marge de la poésie amoureuse, le plus souvent traitée par les femmes-troubadours sur le mode de l’idéalisation ou de l’aspiration au rêve inaccessible, Gormonda de Monpeslier se dresse en prédicatrice virulente contre l’hérésie venue de Toulouse dans un long poème de 140 vers qui répond à la diatribe anti-papale du troubadour Guilhem de Figueiras : « Pis que Sarrasins et de cœur plus perfide / sont ces apostats, et qui suit leur demeure / Dans l’abîme en feu ira pour tout salut / En damnation… » De l’amour mystique à la guerre sainte !
Le genre dialogué des tensons est présenté en deux parties distinguant les cas de discussion « femme – femme » et ceux de « femme – homme ». Quand N’Almuc de Castelnoir est brouillée avec Gui de Tournon, N’Iseut de Capion se propose de rétablir entre eux la paix ; mais N’Almuc de Castelnoir pose ses conditions et exige que l’amant volage s’amende. Un autre exemple de tenson retient notre attention concernant le parti pris de la virginité opposé à celui du mariage avec le refus radical de la maternité aux conséquences physiques désastreuses. N’Alaisina Iselda et Na Carenza confrontent ainsi leurs points de vue dans une parodie de casuistique amoureuse masculine… Entre femme et homme, les tensons ont souvent un caractère de badinage érotique. Ainsi dans la tenson échangée par Guilhelma de Rosers avec le gênois Lanfranc Cigala, troubadour de la première moitié du XIIIème siècle, le chevalier vaincu dans le débat poétique entend prendre sa revanche au lit : « Dame, j’ai le pouvoir et la hardiesse / A votre gré de vous vaincre en un lit / Car je fus fou de tenter ce combat, / Mais je veux être vaincu quoiqu’on dise… » Guilhelma, avec humour, n’est pas en reste : « Lanfranc, je vous l’accorde et j’y consens / Car j’ai tant de courage et de hardiesse / Qu’avec la ruse habituelle des femmes / Le plus hardi ne me ferait pas peur. » Marie de Ventadour, grande dame, n’est connue comme trobairitz que par une seule tenson ayant pour thème la parité en amour. La dame provoque le troubadour qui ne chante plus (Gui d’Ussel ayant renoncé au trobar sur ordre du légat du pape car il était chanoine !). La tenson de Domna H. et Rosin met en évidence les audaces féminines de ce XIIIème siècle occitan. La dame ici défend l’amant trop entreprenant et accuse de lâcheté celui qui s’est arrêté en cours de route. Rosin, le troubadour prend au contraire le parti de l’amant respectueux de la dame : « il commit folie / quand il osa forcer sa dame… »
Si les femmes-troubadours ont été jugées scandaleuses au cours des derniers siècles par des érudits misogynes et des esprits chagrins, les féministes d’aujourd’hui ont parfois tendance à les récupérer sans rapport aux idéaux et au contexte particulier de l’Occitanie médiévale. Les chansons réunies dans cette anthologie nous informent sur la société courtoise, ses modèles de comportement, ses valeurs féodales éthiques et affectives. Pierre Bec reconnaît cependant que la fin’amor au féminin pose encore des problèmes aux exégètes mais il retient que le rôle des dómnas se révèle beaucoup plus important qu’il n’était admis auparavant et il lui paraît aujourd’hui « d’une incontestable luminosité ».
*L’AMOUR AU FÉMININ : LES FEMMES-TROUBADOURS ET LEURS CHANSONS, (Introduction et traduction de Pierre BEC, édition bilingue, Fédérop – 15 €)
Article publié dans la revue Europe N° 1015-1016 (nov. Déc. 2013)
17:37 Publié dans Mes ami(e)s, mes invité(e)s | Lien permanent | Commentaires (0)
Michel Ménaché a lu "Maram AL-MASRI : Elle va nue la liberté"
Hantée par le soulèvement populaire syrien contre la dictature, bouleversée par les images terribles qui circulent sur internet, qui lui parviennent de tous les réseaux sociaux avec lesquels elle reste jour et nuit en lien, Maram al-Masri* s’impose l’état de veille. Dans son recueil au titre aussi humble que radical : Elle va nue la liberté, des villes éviscérées, du sang répandu, des victimes emprisonnées, suppliciées, des familles déchirées, des enfants sacrifiés sur l’autel de la barbarie, chaque cri des mères devient poème, chaque douleur intime devient la douleur de tout un pays… Exilée déchirée à vif, elle redécouvre la démarche du Bertolt Brecht du Manuel de guerre allemand dont chaque court poème était inspiré par une image de l’atroce actualité hitlérienne. Maram al-Masri entend rendre hommage aux combattants de la démocratie, d’abord aux victimes d’un pouvoir aveugle et sourd au malheur. Malheur qu’il multiplie chaque jour davantage en recourant aux bombardements aériens et aux armes chimiques. Chant d’indignation et de rage, il ne s’agit nullement d’une complainte mais plutôt d’un hymne à l’amour et à la liberté. « Un grand peuple au XXIème siècle a décidé de renaître », écrit-elle dans son introduction.
Chaque arrêt sur image retient l’émotion, cristallise le symbole : « L’avez-vous vu ? // Il portait son enfant dans ses bras / et il avançait d’un pas magistral / la tête haute, le dos droit… // Comme l’enfant aurait été heureux et fier / d’être ainsi porté dans les bras de son père / Si seulement il avait été / vivant. » Les mères sont très présentes dans le recueil, maintenant les liens du sang et de la tendresse comme un surcroît ou un sursaut d’humanité face à la terreur : « Tu vas être enterré, / ô martyr, / avec les lèvres de ta mère / collée à ta peau. »
Les mercenaires du pouvoir tentent de masquer leurs crimes, de traiter leurs victimes en assassins en essayant de leur faire endosser de faux témoignages dans les hôpitaux désorganisés : « Tu dois signer ici que ce sont les hors-la-loi / qui ont tiré sur toi. / Non dit le blessé. / Un révolver s’approche de sa tempe : / signe ici ! / Non c’est l’armée régulière. // Le coup de feu éclate. » Face au danger, avant d’enterrer ses morts, il faut aussi sauver le dernier pain pour survivre, récupérer l’arme précieuse qui changera de main, filmer la scène pour garder trace, s’adresser au reste du monde… Et quand une famille se sacrifie pour envoyer une jeune fille en études supérieures, ce n’est pas le diplôme espéré qui en échoit : « Elle est partie au sein de l’université / chargée de stylos et de rêves. // Une de ses chaussures / est revenue dans les mains de sa mère. »
Maram al-Masri s’adresse aussi aux 5000 femmes emprisonnées subissant tortures et humiliations : « Que faites-vous mes sœurs / lorsque la rage coule dans vos yeux ? » Elle évoque les réfugiés, prêts à tout perdre pour rester en vie et qui fuient par centaines de milliers les tueries. Pour tous, résistants ou exilés, « elle va nue, la liberté, […] /on brise ses pieds / mais elle avance. / On coupe sa gorge / mais elle continue à chanter. »
Par-delà tous les crimes, toutes les exactions, l’espérance redouble, renaît toujours avec des accents maternels : « Ô Syrie, / nous allons laver ton sang / avec le lait de notre amour. »
En fin de recueil, Maram al-Masri a adapté et traduit un poème écrit par son frère, Monzer Masri, resté au pays : « Je vis dans la mort. / Je ne fais rien d’autre que vivre comme un témoin, / mais j’ai décidé de ne pas être un faux témoin. » Un pont ouvert entre l’exil et le pays martyr.
La voix intime et chaude de Maram al-Masri est celle du peuple syrien tout entier, celui qui espère la paix et la démocratie en dépit des prédateurs et charognards qui soufflent sur les braises…
*Maram AL-MASRI : Elle va nue la liberté (bilingue, éd. Bruno Doucey, 15 €)
Article paru dans la revue Europe, n° 1012-1013 (août-sept. 2013)
17:32 Publié dans Mes ami(e)s, mes invité(e)s | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ménaché, maraù al-masri, revue europe
Albertine Benedetto, Le présent des bêtes, extraits inédits
On va aux cimetières, vous savez, pour la vue ou pour s’y reposer, pour causer. A mesure qu’on fait des tours, la foule se masse et s’engage par la colonne d’air venant du ventre encore une fois jusqu’au puits de la bouche. La parole ratisse les allées et les pierres ramenant tel nom à tel autre qui s’étaient oubliés : la tante diseuse de cartes, le grand-père et son fusil jeté, vies sorties de la ferme ou de l’épicerie, ferments mythologiques. Encore une fois refont leurs gestes, on entend leur voix, leur façon bien à eux de parler de bouger accompagne nos pas. Certains noms figurent en très gros, manière de dessiner l’arbre qui se met à verdir par éclats et brisures d’une mémoire à trous. Mosaïques si noircies par le temps que certains disparaissent vraiment. On perd le fil dans l’écheveau des familles. Il faut recommencer pièce à pièce les histoires, s’embrouiller dans les amours, c’est toujours compliqué les amours. Le cœur en deuil se répète les noms et ce n’est pas triste, à cause des oiseaux et des fleurs.
St Martin 09
Paupières baissées, lèvres serrées, ils traversent leur nuit sur une planche de bois. Leurs yeux ne voient pas les lettres s’effacer sur la pierre, les noms se brouiller dans le lointain. Dame de pique sans répit pour celle qui tira les cartes, Gaby au nom léger, Gabrielle Millepied. Douceur d’Octobre où fleurissent les tombes. Eux se tiennent par la main, comme dans la foule des grands départs, eux pourtant seuls debout au milieu des gisants. Se tiennent par la main, par leurs bouches aussi où le souffle voyage. Passent parmi ces distraits qui restent à quai.
St Martin 11
our de pieuse visite. Le regard parti sur les pierres levées, on tire la chaîne. Remontent des eaux noires Eugène, Julie, Marie, Madeleine, ô la vibration entre nos lèvres de vos noms si doux, réchauffés à notre souffle de vivants. Vite avant que la pierre n’avale la dernière syllabe, encore une fois faire signe. Avant que, sur vos tombes désaffectées, le fossoyeur n’appose l’affichette, à qui destinée ? mais réglementaire : prière de se faire connaître.
St Martin 12
17:25 Publié dans Mes ami(e)s, mes invité(e)s | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : albertine benedetto, le présent des bêtes
15/02/2014
Michel Ménaché a lu "Phares, balises et feux brefs suivi de Périples" de Frédéric-Jacques Temple
Frédéric Jacques Temple, poète planétaire, publie un double recueil qui, de ses eaux vives, désaltère le lecteur. Alain Borer présente fraternellement l’auteur en « adolescent nonagénaire », en loup de mer, en bourlingueur (comme son ami Cendrars), en savant lettré, en Apache. « Temple est une nature », il est la réincarnation de l’Achab de Moby Dyck, -son nom de code-. Et s’il « est revenu de l’Enfer » de la bataille de Monte Cassino en 1943, c’est pour « en rapporter la bande-son » dans La route de San Romano.En quête d’un ailleurs perpétuel, « voyageur immobile, explorateur égaré, […] il n’a cessé de résister à la dislocation du monde. »
Avec Phares, balises & feux brefs (Préfacé par Alain Borer, éd. Bruno Doucey 15 €), le lecteur est d’emblée invité au voyage. Par mers et continents, au plus près de la faune et de la flore que l’auteur étudie depuis l’enfance. Dans Calendrier du sud, Temple égrène les douze mois de l’année sous la forme de courts poèmes riches en métaphores telluriques et animalières. Août :« Le mois de ma naissance / Invincible torpeur / dans la sueur pesante. / L’aigre violon du moustique / perce la nuit molle. / Il faut durer / jusqu’à l’orage. » Octobre : « Triomphe de la rouille / et gloire des renards / le cuivre et l’or / incendient les herbages. » Paysages lointains, dédié à la mémoire de son premier éditeur algérois, Edmond Charlot, évoque le port d’El Biar, les odeurs de la casbah, le Chenoua, « royaume des vipères », les oursins de Tipasa « gorgés de pourpre » arrosés d’un « vin sombre », ouvrant « la porte / du bonheur. » La mémoire du poète est « un grenier / à mirages où puiser / et les paysages sont des jouets perdus / ranimés pour notre survie. » Les amitiés traversent le recueil, de René Depestre à Yves Berger, d’Henri Pichette à Alain Borer pour lequel c’est à la course obsédante de Rimbaud, en fuite perpétuelle, qu’il fait écho : « Poésie, la belle imposture, / leurre pour piéger l’éternel. / Oui, je préfère l’aventure / à ce pathos sempiternel. » Le poète prête aussi sa plume à l’entomologiste pour observer le rituel impitoyable de « l’amante religieuse » : « La mante prégadieu / tête sèche ventre mou / joint les faulx de ses mains / en sa prière carnassière / et pend à ses crochets / le mâle / au sommet du jouir. »
Périples s’ouvre sur le Larzac : « Enfant, berger de mes troupeaux de rêves, / j’allais foulant la folle avoine / sur les ardents plateaux déserts / où règne la senteur enivrante des buis / entre les épineux soleils des cardabelles / dans le thrène du vent parmi les herbes rases… » Temple évoque aussi Max Rouquette, l’ami disparu des errances communes en pays d’Oc, avec La fleur adverse, - la ronce -, « dont l’ombre s’étale souveraine / sur la tombe de Rimbaut d’Aurenga / à qui je parle / une langue adverse. » De courts poèmes reconstituent en fragments le village et quelques figures ayant marqué l’enfance du poète : Auguste-Hercule, la petite fille au chat, le garde-chasse... Les murets de pierres sèches demeurent qui sont « gardiens de la mémoire. » Un long poème en prose fait renaître un jardin au bord de l’eau surgi du passé : « Nerveuse, agile, musicale, une rivière accompagne de tout temps le chant de ma mémoire, en basse continue. » Description méticuleuse, leçon de choses à vif, inventaire d’un arpent fondateur du rapport intime au monde. Puis le vagabondage reprend : Venise, Dublin, Namur, Vision du Neguev, Jérusalem, l’Amérique des « nations premières », pour revenir aux premières chevauchées, sur le sable du temps : « Mon cheval à roulettes / noir et blanc pommelé / galope encore / sur la terrasse de l’enfance… » L’amour referme la boucle avec ces vers dédiés à Brigitte : « Sous ton ombre / je me dresse / fier soleil / et j’avance / délivré de ma torpeur / dans l’oubli des cicatrices / enfant nouveau entre tes bras / qui m’enserrent / comme des branches / et me bercent. » Enfin, Temple se révolte contre la mort prochaine : « Je m’insurge, / maudis le fatal rendez-vous, / insulte l’ignoble bête noire, / mais ne perds de la vie / la moindre goutte de son miel. »
Hymne solaire avant la nuit. Temple résiste encore à la dislocation du monde…
Paru dans la revue Europe, n° 1007 mars 2013
16:51 Publié dans Mes ami(e)s, mes invité(e)s | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : ménaché, frédéric-jacques temple
04/01/2014
Claude Haza a lu Vers les riveraines d'Alain Freixe, Fonds Poésie, éditions de l'Amourier
Je cherche la porte d’accès au texte. Je m’y adonne plusieurs fois de suite sans savoir encore si j’ai franchi la bonne entrée. Mais peu importe, puisqu’il me semble déceler dans cette longue fresque poétique une sorte de visite, de marche sans doute, ou encore une approche « vers les riveraines » réelles ou symboli-ques que sont la vie et la mort.
Ces deux dimensions de l’existence se côtoyant en tous lieux et à tout instant de la rencontre existentielle − notre principale préoccupation. Que l’on soit attentif à leur présence, à leur passage furtif ou pas, on est toujours quelque peu chargé du poids de l’une et de l’autre. Les Riveraines sont en nous et devant nous. On les voit agir. On les ressent nous façonner l’esprit, le désir, le besoin d’être. Elles nous font vivre et elles nous font peur.
Ainsi, dans ce recueil on avance et on pense à travers elles comme présences irrévocables du début jusqu’à la fin. On accompagne le poète aux prises avec ses propres riveraines, avançant vers elles à tâtons ou frontalement. Il les côtoie alternativement ou il les assemble dans une même contingence.
Alain Freixe parle donc ici à la vie et à la mort, de leur vide et de leur plein de présence comme aussi de souvenirs, de vision du monde, de choses réelles ou imaginaires. Tel ce poème : « corps et terre démembrées / je suis passé derrière / leur vie / d’eux / je n’ai vu / que des morceaux du temps / restés là à flotter / sur l’eau noire / qu’ils avaient bue … ».
Au fur et à mesure de ma lecture j’ai trouvé ce que je cherche moi aussi : nostalgie, interrogation, étonnement, espoir et même tristesse – dont l’accent ici indique une force à se laisser bercer par elle, le temps de reprendre la route, comme dans ce poème : « après / c’est comme une musique / qui rouvre les yeux / et lance le regard / drapé de déchirures / de mots écrasés /d’images écorchées / pour au loin / l’entendre tinter / (…) / ferrée de silence / la route à présent / est rendue à son asphalte / à ses mirages (…) »
Claude Haza - 11. 10. 2013
16:06 Publié dans Mes ami(e)s, mes invité(e)s | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude haza, vers les riveraines, alain freixe