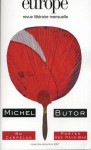19/01/2008
Table ronde sur le N°de la revue Europe consacré à Michel Butor le vendredi 25 janvier 2008 à la BMVR Louis Nucéra à Nice à 17hs
17:15 Publié dans Du côté de mes interventions | Lien permanent | Commentaires (0)
08/01/2008
Aux passant(e)s du blog
Ami(e)s connus, moins connus voire inconnus qui passez par les mailles de la toile sans vous y prendre que 2008 vous accorde l’énergie nécessaire à la réalisation des projets qui vous tiennent le plus à cœur. Et le cœur !
Energie nécessaire pour cette fermeté dont parle Kafka dans son aphorisme 21 quand il évoque « une main tenant une pierre ». Main qui ne « la tient ferme que pour la relancer encore plus loin, aussi loin que mène le chemin. »
15:55 Publié dans Du côté de mes interventions | Lien permanent | Commentaires (3)
Exposition « Joë Bousquet, j’habite au milieu des couleurs » du 30 novembre 2007 au 01 mars 2008 à la Maison des Mémoires – Maison Joë bousquet, 53 rue de Verdun, 11000 Carcassonne (tel/fax : 0468725083)
(Conçue par Le centre Joë Bousquet et son temps en partenariat avec le Conseil Général de l’Aude, l’exposition propose un cheminement dans l’univers de Joë Bousquet.
Des rencontres réunissant Yannick Bellon, Eric Le Roy, Serge Bonnery, André Cariou, Anne Cathala, Michaël Glück, Sylvie Gonzalez, Anne Gualino, Rose-Hélène Iché, Yolande lamarin, Adriano Marchetti, Doiminique Rabourdin, Alain Freixe et bernard Noël, se sont déroulées les 30 novembre et 1 et 2 décembre 2007.
Les œuvres présentées : peintures, photographies, sculptures, ouvrages, revues, documents témoignent des liens vitaux que le poète a entretenu avec les créateurs entre les années 1925 et 1950.)
 « Les peintres m’ont comblé. Quand j’étais aussi pauvre qu’eux, ils m’ont fait de ma chambre une
« Les peintres m’ont comblé. Quand j’étais aussi pauvre qu’eux, ils m’ont fait de ma chambre une demeure enchantée. »
demeure enchantée. »
Joë Bousquet à Maurice Nadeau
On l’aura compris, il ne s’agissait pas pour les concepteurs de l’exposition de courir après les pièces telles que mais de tenter d’évoquer l’atmosphère de ce « repaire amoureux », ce « lieu souterrain » dont Bousquet disait – Et c’est le titre même de l’exposition ! – que là, « il habitait au milieu des couleurs », que sa vie même était dans ces « réalités éruptives »
Pari gagné !
A parcourir salles et couloirs, c’est un vent et une lumière qui vous accompagnent : vent qui porte haut l’écho d’une rébellion qui avait subordonné « toutes les activités esthétiques à une idée morale de l’homme » ; lumière d’un refus de tout ce qui asphyxie l’homme et le voue à l’écoeurement.
15:40 Publié dans Du côté de Joë Bousquet, Du côté de mes interventions | Lien permanent | Commentaires (0)
Balise 25 - Marx et la "parole d'étranger"
« Le seul langage compréhensible que nous puissions parler l’un à l’autre est celui de nos objets dans leurs rapports mutuels.
Nous serions incapables de comprendre un langage humain : il resterait sans effets. Il serait compris et ressenti d’un côté comme prière et imploration, et donc comme une humiliation : exprimé honteusement, avec un sentiment de mépris, il serait reçu par l’autre côté comme une impudence ou une folie et repoussé comme telle.
Nous sommes à ce point étrangers à la nature humaine qu’un langage direct de cette nature nous apparaît comme une violation de la nature humaine ; au contraire, le langage aliéné des valeurs matérielles nous paraît le seul digne de l’homme, la dignité justifiée, confiante en soi et consciente de soi. »
Karl Marx
15:27 Publié dans Balises | Lien permanent | Commentaires (0)
Martin Miguel – Peindre / Perdre – Galerie de la Marine du 13 deécembre 2007 au 09 mars 2008 à Nice
 Peinture ? Sculpture ? interroge Michel Butor tant il est vrai qu’avec Martin Miguel, « l’histoire de l’art sort de
Peinture ? Sculpture ? interroge Michel Butor tant il est vrai qu’avec Martin Miguel, « l’histoire de l’art sort de son cadre pour nous indiquer les passages secrets » ; qu’avec lui, « l’art fait le mur » selon les mots de Raphaël Monticelli, en quoi ses œuvres sont « sources de poésie car « elles créent à l’intérieur de nos discours habituels, des trouées, des absences ou des pertes que nous devons apprendre à combler ». A quoi je rajouterai qu’ici peindre n’est pas couvrir une surface mais mettre à nu un vide. Avec la couleur noire, Martin Miguel fait le vide : « noir de source, ai-je écrit dans le catalogue aux côtés des textes de Michel Butor et de Raphaël Monticelli et des photographies de François Fernandez, pour les yeux qu’il ouvre en nous. Contre tout ce qu’il y a de mort dans le monde. »
son cadre pour nous indiquer les passages secrets » ; qu’avec lui, « l’art fait le mur » selon les mots de Raphaël Monticelli, en quoi ses œuvres sont « sources de poésie car « elles créent à l’intérieur de nos discours habituels, des trouées, des absences ou des pertes que nous devons apprendre à combler ». A quoi je rajouterai qu’ici peindre n’est pas couvrir une surface mais mettre à nu un vide. Avec la couleur noire, Martin Miguel fait le vide : « noir de source, ai-je écrit dans le catalogue aux côtés des textes de Michel Butor et de Raphaël Monticelli et des photographies de François Fernandez, pour les yeux qu’il ouvre en nous. Contre tout ce qu’il y a de mort dans le monde. »15:24 Publié dans Mes ami(e)s, mes invité(e)s | Lien permanent | Commentaires (0)
Jeanne Bastide - La lumière arrive
 ( Méditerranéenne, Jeanne Bastide est née à Montpellier en 1947, “…dans les faubourgs. Pas le Montpellier de la ville – celui de la campagne. Un berceau de pierre dans un écrin de vignes ”.
Psychologue de formation, elle a été un temps enseignante avant de se consacrer à l’écriture, la sienne et celle des autres. Elle propose l’écriture dans des structures institutionnelles, des associations, des librairies ou des médiathèques… depuis plus de dix ans.
Elle participe à l’animation de « La belugo », l’étincelle en occitan. Cette association a pour but de promouvoir l’écriture sous toutes ses formes en organisant des ateliers d’écriture, des lectures, des « écuries d’écrits », des stages…(contact : Belugo, 95 avenue Azema – 34530 – Montagnac – 0467240233 beugo@club-internet.fr)
( Méditerranéenne, Jeanne Bastide est née à Montpellier en 1947, “…dans les faubourgs. Pas le Montpellier de la ville – celui de la campagne. Un berceau de pierre dans un écrin de vignes ”.
Psychologue de formation, elle a été un temps enseignante avant de se consacrer à l’écriture, la sienne et celle des autres. Elle propose l’écriture dans des structures institutionnelles, des associations, des librairies ou des médiathèques… depuis plus de dix ans.
Elle participe à l’animation de « La belugo », l’étincelle en occitan. Cette association a pour but de promouvoir l’écriture sous toutes ses formes en organisant des ateliers d’écriture, des lectures, des « écuries d’écrits », des stages…(contact : Belugo, 95 avenue Azema – 34530 – Montagnac – 0467240233 beugo@club-internet.fr)Elle publie régulièrement en revue. Lucarnes aux éditions de L’Amourier, collection Thoth, est son premier récit.
15:15 Publié dans Inédits, Mes ami(e)s, mes invité(e)s | Lien permanent | Commentaires (0)
Balise 24 - La lettera Amorosa de Julien Gracq
( Dans une édition hors commerce tirée à 63 exemplaires en juillet 1952, Julien Gracq publiait cette Prose pour l’étrangère, suite de 12 poèmes en prose que l'on trouvera dans La Pléiade, tome I. J'ai choisi le premier de cette suite pour rendre hommage à l'auteur d'Au château d'Argol, un de mes grands souvenirs de lecture de jeune homme et pour lier le thème de la "Lettera amorosa" du Printemps des poètes de l'an passé à "l'éloge de l'autre" à venir entre le 3 et le 16 mars 2008 )
15:10 Publié dans Balises | Lien permanent | Commentaires (0)
23/12/2007
A la bascule de l'an
Trois éléments dans la simultanéité des heures:
- Dans la collection "À CÔTÉ" des Cahiers du Museur, je mets un point final à Braises sous le vent texte qui accompagne une mise photographie de Frédéric Lefeuvre, mise en lumière du pog de Monségur
- J'apprends alors que je boucle mes bagages pour Perpignan, Paris puis Valberg, la mort de Julien Gracq
Vite, vite, cet extrait que j'emprunte à Lettrines: "
"Montségur. Quand j'y passai, le paysage était ruisselant, les montagnes cachées derrière des échartpes de pluie. (...) En quittant Lavelanet par la route de Quillan, tois ou quatre fois encore par des brèches dans l'écran de la chaîne verdoyante, on voit au midi la dent sombre au profil redoutable, la pierre brûlée qui reparaît uyn instant et fait signe, comme un phare mystérieux de lumière noire."
- Cette image, venue de l'autre côté de la frontière, où se tient celle qui m'accompagne :
À très bientôt!
Bonne énergie à tous, toutes pour l'année nouvelle qui s'annonce! Difficile, comme de juste!
14:10 Publié dans Dans les turbulences | Lien permanent | Commentaires (5)
18/11/2007
Balise 23 - Voyager en intensité
20:00 Publié dans Balises | Lien permanent | Commentaires (2)
Frédéric Lefeuvre, constructeur d'images
 Mon ami Frédéric Lefeuvre m'envoie ses ombres frontières,sa reconquête du regard. C'est un livre d'artiste à douze exemplaires comportant 15 images originales.Il prend place dans cette belle collection des Cahiers du chêne rouge qu'il a fondé il y a quelques années à Seglien, 56160 (Tel: 0297280199) et dont le site est en construction: http://monsite.wanadoo.fr/lechenerougeeditions
Mon ami Frédéric Lefeuvre m'envoie ses ombres frontières,sa reconquête du regard. C'est un livre d'artiste à douze exemplaires comportant 15 images originales.Il prend place dans cette belle collection des Cahiers du chêne rouge qu'il a fondé il y a quelques années à Seglien, 56160 (Tel: 0297280199) et dont le site est en construction: http://monsite.wanadoo.fr/lechenerougeeditions
Dix volumes déjà:
-Les caresses de la terre, chant baroque d'Italie et d'Espagne (juin 2004)
-Les chemins du seigle, paysages de Bretagne, I (juin 2004)
-Les chemins du seigle, paysages de Bretagne II (juin 2004)
-De ballades en complaintes, Antonin Artaud, septembre 2004
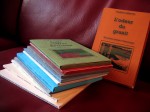 -Le passeur solitaire, Joë Bousquet, préface d'Alain Freixe (janvier 2005)
-Le passeur solitaire, Joë Bousquet, préface d'Alain Freixe (janvier 2005)
-Sous les drapeaux de l'illusoire, texte de Line Clément (Avril 2005)
-Raconte-moi un mouton!, vendanges 2005 (Octobre 2005, Hors série N°1)
-Sulle colline bruciante, Cesare Pavese, texte d'Yves Ughes, (novembre 2005)
-Faits d'hiver, Paris février/mars 1983 (mai 2006)
-L'odeur du granit, Territoires intimes d'Armorique, février 2007
Frédéric Lefeuvre est l'homme du juste loin. Il sait la bonne distance, celle qui laisse la lumière circuler parmi les visages. Et lève leur présence. On pourra se reporter à mes Archives du mois de novembre 2006 à la date du 01 /11/06 pour lire L'oeil de la main, texte que j'ai consacré au travail de Frédéric Lefeuvre.
Dans son Odeur du Granit, ses Territoires intimes d'Armorique, il faisait précéder ses12 photographies d'un texte où il revisite sa démarche de constructeur d'images au plus près de son "désir photographique". Eclairant!
"Le photographe tranche dans le réel, communément on dit qu'il écrit avec la lumière. Derrière la toile des apparences que capte la rétine, avant que les dès ne soient jetés, il a le pouvoir d'offrir une face visible au vécu intime des choses.
Je construis des images en passant, en passeur si possible, tout en laissant disponible ma pensée, et en pansant les plaies du temps à partir d' une géographie intérieure et muette. Aucune chapelle esthétique ne se cache derrière elles. Elles se veulent l'union d'une rencontre et d'une émotion. De celle qui est marquée par une quête de l'insaisissable.
Tout d'abord, au niveau de l'acte de prise de vue, mon cheminement se nourrit d'histoires anciennes et de la vibration des lieux ; c'est une forme de photographie contemplative à l'écoute des silences et des signes de ce qui « a été ». On fait toujours les mêmes photographies, on marche toujours vers le même horizon, on creuse toujours le même trou pour faire naître toujours plus d'apparitions. Il faut toujours chercher ce qui est derrière le cadre assassin du photographe.
Ce qui m'émeut, c'est le contact direct de la main avec les fibres du papier bromure qui révèle le négatif exposé par la chambre noire. Je procède avec des produits actifs par tamponnage, par caresses et par glissements successifs d'arabesques sur le support baryté. Les vapeurs murmurent avec le hasard. Parfois l'émulsion dégage des saveurs délétères, elle fume, elle brûle, elle irrupte des ombres sorties de mes mirages ; ce qui doit « être » depuis mes chaudrons infernaux, persistera et existera.
Dans mes paysages de Bretagne, j'espère renouer avec l'authenticité et la beauté d'un territoire qui souffre d'un déficit esthétique dans sa perception. Je recherche le lien, puis l'empreinte. La pensée ne se détruit pas, elle remonte toujours le puits du temps. C'est tout le contraire d'un système : le mode opératoire est aléatoire et détaché de la technique ; le but est de se perdre en chemin, de se mettre en danger parmi une mosaïque de paysages et de nouvelles frontières.
En fait, j'opère en utilisant une forme d'écriture automatique portée par une sensibilité en rupture. C'est une histoire de respiration et de fenêtres ouvertes sur une ballade poétique. Ma démarche est une oeuve de « déconstruction » des images telles que la société les conçoit. Notre regard est devenu économique et sous contrôle. Aussi, il m'importe plus que jamais de maintenir mes désirs photographiques dans la magie et le souffle si vulnérable de la vie."
© Frédéric Lefeuvre
12:25 Publié dans Mes ami(e)s, mes invité(e)s | Lien permanent | Commentaires (0)
12/11/2007
Turbulence 20 - Vie et mort des revues de poésie
Ainsi donc s'en est fait: le Nouveau recueil s'arrête. Avec le N° 85, la revue que dirigeait depuis 1995 Jean-Michel Maulpoix, soutenue par les éditions du Champ vallon - revue qui avait pris la suite de celle intitulée Recueil et qui avait vu le jour en 1984 - disparaîtra sous la forme visible que nous lui connaissions.
Nous irons tourner d'autres pages.
Celles, virtuelles, d'un nouveau Nouveau recueil, mis en ligne à l'adresse suivante : http://www.lenouveaurecueil.fr/ "revue gratuite, numérique, plus prompte, plus réactive, plus présente, plus vivante...", écrit à son sujet Jean-Michel Maulpoix.
Souhaitons lui bonne navigation.
Et souhaitons aussi bon vent, à l'enseigne de l'Atelier du Grand Tetras, à la revue Résonance générale qui publie son N°1.
Cette maison d'édition implantée dans un petit village du Massif jurassien, se dit animée par une vision écopoétique du monde. Elle dispose de 3 collections: "Terroir vécu" qui regroupe des textes fixant la singularité d'un art de vivre régional, tourné non vers le passé mais vers l'avenir; "Ecriture" est consacrée au roman et "Glyphes" à la poésie."Hors des sentiers battus, résister", son mot d'ordre me va. Et c'est là le propre d'un certain nombres de ces éditeurs que l'on dit petits!
Résonance Générale est dirigée par Daniel Leroux. Ses rédacteurs sont : Serge Martin, Laurent Mourey, Philippe Païni. Une revue qui dans son premier numéro affiche une préface/manifeste, c'était dans nos sombres temps devenu chose rare.
Résonance pourquoi? "Parce que nous sommes du langage et parce que vivre dans le langage refuse de séparer lire-écrire-penser-vivre, parce que nous sommes des écoutes actives autant que des activités d'écoute. La résonance est à penser comme une poétique plurielle de la voix et des voix dans chaque voix".
Résonance générale Pourquoi? "pour entendre le sujet comme un rythme, une relation, une pensée du mouvement."
Il n'est dès lors pas étonnant de voir ce premier numéro tourner autour de la pensée du rythme de Henri Meschonnic. "poète libre" comme le nomme Serge Martin, pour qui "le problème poétique majeur, aujourd'hui comme toujours, n'est pas la poésie mais le poème", le poème comme oeuvre de langage.
(coordonnées : Résonance générale, l'Atelier du Grand tetras, au-dessus du village, 25210, Mont de Laval. Tel: 0381689191. Mel: latalierdugrandtetras@wanadoo.fr.
La revue est semestrielle, Abonnement pour 3 N°s: 40 euros. 15 euros le N°)
18:30 Publié dans Dans les turbulences | Lien permanent | Commentaires (0)
07/11/2007
Claudine Galea - L'heure Blanche
 ( Claudine Galea écrit du théâtre, des romans pour les adultes et pour la jeunesse. Elle travaille également avec les chorégraphes et créateurs d'images nouvelles n+n corsino. Elle est présente sur Remu.net.
( Claudine Galea écrit du théâtre, des romans pour les adultes et pour la jeunesse. Elle travaille également avec les chorégraphes et créateurs d'images nouvelles n+n corsino. Elle est présente sur Remu.net.
D'elle, elle dit : "Je suis d'origine maltaise, mon père est venu d'Algérie quelques années avant ma naissance et j'ai grandi à Marseille. Je vis à Paris, mais ce sont toujours la lumière du sud et la présence de la mer qui me portent. Je n'aime pas beaucoup les catégories qui enferment et scindent. C'est sans doute pour ces raisons que j'ai toujours exploré différents territoires, seule ou accompagnée, avec des artistes d'autres horizons. "
Parmi ses derniers livres : Le bel échange (récit), Morphoses (roman graphique avec Goele Dewanckel), Rouge Métro (roman noir à partir de 15 ans) aux éditions du Rouergue, L'amour d'une femme (récit) au Seuil, Je reviens de loin (théâtre) aux éditions Espaces 34 et La règle du changement aux éditions de l'Amourier, cadre dans lequel je l'ai rencontrée.Elle me confie aujourd'hui L'heure blanche qui devrait faire l'objet d'une publication avec des illustrations de Goele Dewanckel très prochainement.)
Je m'appelle Blanche.
Je porte des robes blanches des culottes blanches des socquettes blanches et des tennis blanches.
Je n'aime pas la nuit.
Je n'aime pas les jeux d'enfants. Je n'aime pas plonger dans la piscine. Jouer à cache-cache. Je n'aime pas qu'on me fasse tourner avec un bandeau sur les yeux pour avancer à tâtons à la recherche des autres qui gloussent qui rient qui poussent des cris et appellent : Blanche par ici, Blanche par là.
J'aime l'été. Le sable dans l'île et l'heure de midi.
J'aime quand il n'y a pas d'ombre. Que les ombres même sont blanches.
C'est un pays très chaud où ma mère est née et m'emmène en vacances.
A midi personne ne sort.
Moi je vais jusqu'au bout du port et je vois tout ce que j'aime voir.
La plage à droite comme un voile de mariée.
La plage n'en finit plus de couler vers l'horizon. Une jeune fille en blanc marche sur la plage, la mariée entre dans la mer. Je la perds. Elle devient le ciel le sable l'eau et le soleil.
Ma mère accourt pour me mettre un chapeau blanc sur la tête.
Ma mère a une jupe blanche et un dos nu blanc. Et des lunettes de soleil noires.
Je déteste les lunettes de soleil.
Ma mère dit des mots : folle insolation trop chaud midi aveuglant mourir.
Je ne comprends pas ce qu'elle dit.
Je ne suis pas comme elle. Je n'ai pas chaud, pas mal à la tête et mes yeux aiment la lumière.
Je m'assieds sur la pierre blanche du quai. Je tourne le dos à la mer.
Les rues en pente du village dégringolent, ce sont des cascades.
Les maisons flottent, ce sont les rideaux en mousseline blanche que maman a mis dans le salon.
Qu'est-ce qui ressemble le plus à la neige ? La mer ou les maisons ?
Je fais des dessins sur des feuilles blanches. J'ai une boîte de peinture. Je n'utilise que le blanc. J'ai quarante dessins blancs. Depuis quarante jours.
Qu'est-ce qui ressemble le plus à la neige ? C'est l'heure de midi dans l'île au milieu de la mer.
Maman ne voit pas ce que je peins. Elle ne voit rien.
Elle passe une couche de peinture blanche sur le mur blanc, je vois le nouveau blanc, puis elle passe une deuxième couche, je vois le nouveau nouveau blanc.
Maman s'énerve : tu vois bien c'est blanc pareil, c'est pareil, tu ne peux pas voir du blanc sur du blanc. Mets des couleurs, ce sera beaucoup plus joli. Et plus gai.
Je regarde l'île et autour de l'île. Je regarde mes tennis blanches et mes ongles. Et dans le miroir je regarde mes dents. Et je regarde ma robe d'été en coton et aussi ma culotte. Je vérifie que tout va bien, tout est blanc.
Et je l'entends miauler.
Je la vois, ombre blanche le long du béton blanc.
Qu'est-ce qui est le plus blanc, la route, la maison, Bianca ?
Je lui ai apporté un peu de lait dans ma petite bouteille que maman avait remplie d'eau. Elle lappe dans ma main. Je m'allonge sur la pierre contre Bianca. Dans sa fourrure blanche, je m'endors.
Même les bruits sont blancs. Le cri des mouettes. Les mâts des bateaux qui vibrent dans l'air. Mon cœur qui bat, blanc.
Maman crie, appelle : Blanche !
Elle ne me voit pas.
Je suis la pierre et le béton, la plage et le sable, l'eau et le ciel, la chaleur et la lumière. Je suis l'île et j'ai dix ans. C'est ici que je suis bien moi, c'est ici que je veux vivre. Je veux vivre quand c'est midi et que je suis seule dans les rues de l'île. C'est l'heure blanche dont tout le monde a peur. C'est l'heure où j'oublie tout, où je n'ai plus mal, c'est l'heure du bonheur. Le bonheur est blanc.
Un jour toute ma peau sera blanche, et seront blancs aussi mes yeux bleux et mes cheveux blonds. Et ma langue, et la langue rose de Bianca. Le blanc me pousse dedans.
Quand je serai toute blanche, je disparaîtrai.
Comme mon papa.
Il photographiait les phoques. Neige, congères, lacs gelés. Il me montrait ses images. Il me disait, regarde Blanche, celle-là je l'ai solarisée. Je voyais des ombres banches, des flous blancs, des taches blanches, des mouvements blancs sur l'écran.
Il mettait encore plus de soleil, il appuyait sur le flash, il blanchissait, il illuminait, il aveuglait tout de blanc. Il disait, les aveugles voient dans le noir, moi je vois dans le blanc.
Moi aussi je vois. Je vois bien, je vois tout dans le blanc, je le vois.
Il y a quarante jours, maman a dit : papa a disparu, le blanc l'a pris, il est dans l'hiver éternel.
Elle a pleuré.
Moi je sais où il est.
Il est dans ses photographies, solarisé.
Il est dans l'île à l'heure de midi. Il est dans le sable et maman va le rejoindre dans sa robe de mariée. Il est entre la terre et le ciel à midi quand ça clignote et que tout devient jaune puis orange puis rouge puis noir puis blanc.
Je le peins dans mes dessins.
Qu'est-ce qui est le plus blanc, le vide, l'absence, le désir, l'attente ?
Un jour je serai Bianca et Bianca sera moi. Peut-être qu'il est là, mon papa, à l'intérieur de Bianca. Je caresse sa fourrure blanche, je t'aime Bianca.
Je crois que je sais : le plus blanc, c'est aussi le plus grand, c'est quand j'ai tout le temps, que c'est l'été, les vacances, que je peux faire ce qui me plaît, marcher dans l'île à l'heure la plus blanche de la journée.
Quand je sens dans mon ventre et ma poitrine quelque chose monter, monter.
Le plus blanc, c'est ce qui contient toutes les couleurs, c'est ce qui fait ressembler l'été à l'hiver, c'est ce qu'on met quand on va se marier, c'est ce qui rend le sale propre, c'est le drap qu'on met sur les morts et les premiers vêtements des bébés, c'est ce qui efface les fautes d'orthographe, et c'est la fleur du jasmin, le parfum préféré de maman, c'est les cailloux du petit Poucet, c'est la fin de la nuit, les nuages sur lesquels on vole, la crème chantilly, c'est Bianca et c'est mon papa. Le plus blanc, c'est d'aimer.
Comment expliquer ça à maman ?
© Claudine Galea
18:43 Publié dans Inédits, Mes ami(e)s, mes invité(e)s | Lien permanent | Commentaires (1)