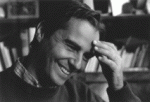09/12/2006
Turbulence 7 - Jérôme Bonnetto, Vienne le ciel et le personnage de roman
Le personnage comme être de langue, c’est là une voie de poète. Le personnage qui en sort ne peut qu’en demeurer marqué. D’où l’importance pour lui des monologues intérieurs. Ada est d’abord un phénomène de langue. Du coup les autres personnages de Vienne le ciel, le photographe surtout, Alexandre même ont moins de présence.
Pour les poètes, le langage n’est pas un simple instrument de communication, il est ce qui toujours naît au point de friction de notre conscience et du monde. Là, des images, un rythme qui s’habille de mots, naissent.
Dirais-je qu’une fois trouvée la langue et donc le personnage, le danger que court un romancier tel que Jérôme Bonnetto, c’est de tomber amoureux de son personnage. Pourquoi danger ? Parce qu’il risque de s’enivrer de sa musique et oublier le drame du sein duquel est né le personnage, non ?
23:20 Publié dans Dans les turbulences, Du côté de mes interventions, Inédits | Lien permanent | Commentaires (5)
Daniel Mohen - La pratique du jardinier et la créativité artistique
 C’est en fréquentant les jardins potagers de l’arrière pays niçois, peu après mon installation dans la région, que j’ai découvert un monde étrange, révélant peu à peu des pratiques étonnantes liées essentiellement à la culture des légumes et des fruits.
C’est en fréquentant les jardins potagers de l’arrière pays niçois, peu après mon installation dans la région, que j’ai découvert un monde étrange, révélant peu à peu des pratiques étonnantes liées essentiellement à la culture des légumes et des fruits.
A Lucéram, en plein hiver, mon regard avait tout d’abord été alerté par des chiffons multicolores suspendus aux arbres : de vieux vêtements qui n’avaient pas été accrochés là par hasard…Puis j’avais trouvé de véritables tissages fabriqués avec des bouts de ficelle, des filets, des morceaux de fil de fer, des vieux sacs en plastique. Peu à peu j’ai découvert un monde où l’imaginaire et les techniques de culture faisaient bon ménage.
j'ai trouvé, dans ces jardins, un écho à certaines de mes préoccupations plastiques, un climat de créativité qui m’a séduit. J’y ai découvert les indices d’une pratique riche, débordante, spontanée, liée à deux notions-clef dans l’art contemporain : la récupération et la réutilisation. La récupération, en effet, est une des activités première du jardinier : matériaux divers, objets, ustensiles, récipients, glanés à droite et à gauche, rangés, stockés avec le plus grand soin, à l’abris. La réutilisation montre l’ingéniosité, la
rationalité, l’organisation du travail, mais aussi l’astuce, et même l’humour du maître des lieux.
Depuis quelques années, j’ai gardé des photos, témoins de mes découvertes et de mes réflexions. Je propose ici quelques feuillets de ce carnet de notes.
© Daniel Mohen
23:00 Publié dans Inédits, Mes ami(e)s, mes invité(e)s | Lien permanent | Commentaires (1)
Madame venue dans le travers de mon travail sur Jacques Dupin,le 17 novembre 2006
20:53 Publié dans Du côté de Madame***, Inédits | Lien permanent | Commentaires (2)
05/12/2006
Balise 12
15:20 Publié dans Balises | Lien permanent | Commentaires (1)
25/11/2006
Yves Ughes/Alain Freixe - Soirée « Rappelez-vous… »
22:55 Publié dans Du côté de mes interventions | Lien permanent | Commentaires (0)
24/11/2006
Dominique Sorrente - Hypothèses du feu (extrait de Mandala des jours - à paraître)
Dominique Sorrente est né en 1953 à Nevers. Enfance vécue sous le signe d'une double influence, arrière-pays celtique et présent méditerranéen. Il vit aujourd'hui à Marseille. Il écrit depuis l'âge de 16 ans, époque où il se lie d'amitié avec le poète Christian Guez-Ricord (1948-1988). Il participera à la vie de la revue SUD jusqu’ en 1998. Il a fondé et anime aujourd’hui l’ association de poésie Le Scriptorium.
Ses principales publications
se trouvent dans la collection verte de Cheyne Editeur.:
La Lampe Allumée sur Patmos (1982)
La Combe Obscure (1985)
Les Voix de Neige (1988, Prix Louis Guillaume 1988)
Petite Suite des Heures (1991, Prix Antonin Artaud 1992)
Une Seule Phrase pour Salzbourg (1994)
La Terre Accoisée (1998)
Le Petit Livre de Qo (2001)
Fougères d’amnésie. Se souvenir est comme un bruit de porte. L’ancien monde du bois.
Air disséminé, toujours en lisière de ce qui candidate au langage. Tout un monde autour de la peau, muet encore.
Aléatoires, les fuites du temps. Où nous passons sans retenir, cela crépite.
Dire qu’il suffit d’un oiseau de feu pour réfuter l’épaisseur sans horizon des choses.
*
On donne des mots en pâture au maître intérieur qui les broie peut-être ou les ingurgite. Quand on les récupère, ils ont un drôle d’air d’introuvables.
16:45 Publié dans Inédits, Mes ami(e)s, mes invité(e)s | Lien permanent | Commentaires (1)
21/11/2006
André Frénaud, poète métaphysique?
(Texte remanié d'une conférence prononcée à La Maison de la poésie de Grasse le vendredi 17 novembre 2006 à l'invitation de l'association Podio qui travaille pour "la défense et 'illustration de la poésie à Grasse.
J'invite ceux qui souhaiteraient prendre connaissance des poèmes lus lors de cette intervention à se procurer les livres. L'oeuvre poétique d'André Frénaud se trouve maintenant disponible sous la forme de 5 volumes dans la collection Poésie/Gallimard)

« Oublions les choses, ne considérons que les rapports"
Braque

Et d’abord pourquoi André Frénaud ?
Peut-être à cause de ces mots de Bernard Noël rencontrés dans son article sur jacques Dupin paru dans Strates, volume collectif dirigé par notre ami Emmanuel Laugier : « Peut-être Jacques Dupin a-t-il des frères en Pierre-Jean Jouve et en André Frénaud, il n’a pas de semblable », mots qui font signe vers une voix, un timbre singulier, une manière unique de remuer la langue et de la faire sonner de manière tantôt assourdie et tantôt agressive…
Peut-être à cause de cette solitude dans le paysage poétique des années 50/80 qui le voit persister alors que s’imposent fragments et dis-jonctions à écrire de longs poèmes qui sont autant de vastes méditations, autant « d’affrontements de la nuit qu’il avait en lui », selon les mots d’Yves Bonnefoy.
Peut-être à cause de ces mots anciens de Montale qui en 1953 écrivait : « La poésie est appréhendée par lui comme un acte vital qui porte et résout en soi toutes les contradictions par le fait même de les vivre (…) c’est le seul monde où puisse évoluer u !n homme comme André Frénaud, poète de grande culture, mais qui ne croit pas à « la littérature », individualiste, sinon anarchiste, disons un esprit réfractaire qui ressent pour les hommes une « piété » infinie et qui ne pense pas qu’on puisse les racheter à coups de trique, comme on le fait des brebis égarées. »
Ou ceux de mon ami Gaston Puel qui dirigea en1981 un N° spécial de la revue Sud sur André Frénaud et qui écrivait dans sa préface que ce dernier « se (présentait) à nous comme l’un des poètes français les plus nécessaires à notre survie d’homme de 1981 »
Peut-être à cause des paradoxes que souligne Gaston Puel: - homme qui commence par la fin. Ainsi le poème Epitaphe qui date de 1938 et ouvre son livre Les rois mages paru en 1944 chez Seghers
Lecture de Epitaphe, Les Rois mages, Poésie/Gallimard, p.15 (30 ‘’)
- homme qui aime les hommes mais qui écrit un ‘je me suis inacceptable » !
- athée qui ne cesse de revisiter la tradition chrétienne
- révolutionnaire tôt revenu de ses rêves mais qui pas de son idéal de justice
- amoureux de la nature qui déclare que « toujours les grandes villes (l’)ont troublé plus que la nature qui est trop claire et qu’elles seules donnent « le sentiment de ce que l’on n’atteint pas »
- amoureux de son « vieux pays » de Bourgogne mais qui avoue s’être épris définitivement de l’Italie et peut-être à un degré moindre de l’Espagne.
On pourrait continuer...
18:05 Publié dans Du côté de mes interventions, Inédits | Lien permanent | Commentaires (0)
15/11/2006
Marcel Migozzi - Vers les fermes, ça fume encore (Extraits)
1
J'aurais d'une passion très lente aimé garder les vaches ( en chemins creux
et près en douce qui s'en vont courber la terre verte ) aimé
pour ne pas oublier l'odeur surtout des grosses à lait cru
déchets sacrés et encollés poils
de déesses.
Et le purin comme un étang
avec son job des profondeurs :
amant délivré des matières.
2
Un soir d'hiver ça fume à l'ombre
d'une brouette paillée.
Etable d'or et de fumier pour les oiseaux.
Et l'écriture mieux respire
à des poèmes qui survivent à l'enfance.
3
Dans les feuillées, un ange
passe et s'accroupit,
comme autrefois à la vidange dans les herbes,
( puits perdu, fosse ) on s'abandonne.
Viennent les délivrances, odeurs
des restes à soupirs.
22:04 Publié dans Inédits, Mes ami(e)s, mes invité(e)s | Lien permanent | Commentaires (0)
13/11/2006
Turbulence 6- Bernard Noël : Le permis de chasse

17:05 Publié dans Dans les turbulences, Mes ami(e)s, mes invité(e)s | Lien permanent | Commentaires (1)
12/11/2006
Balise 11
"Il y a des ulcères dans la pureté, nous allons
du visible à l'invisible.
Sur cette erreur repose notre coeur."
Antonio Gamoneda
20:40 Publié dans Balises | Lien permanent | Commentaires (2)
03/11/2006
Hans Freibach - Du verrou à la clé
Philippe Jaccottet
J'aime qu'ici, à La Sape dont le numéro 18 traçait les perspectives au cœur même d'un libre entretien entre les membres qui firent son histoire, on ait toujours su reconnaître que c'est cette présence autre que la poésie a toujours tenté de signifier, celle pour laquelle le poème cherche à être un abri. Abri précaire, il est vrai, jamais définitif, abri ouvert à ce qui le dépasse.
Poser la question du lieu, c'est aussi prendre la mesure de nos jours, de ces jours où l'homme des sociétés industrielles, encombré de savoirs et de machines, obsédé par des soucis de rentabilité et d'efficacité technique n'a plus qu'un rapport lointain et médiatisé avec la terre.
Poser la question du lieu, c'est aussi bien inviter la poésie à rouvrir les chemins de la terre, puisque son propos ne saurait être ni de s'armer pour la croisade, ni de s'ériger en donneuse de leçons; peut-être même sa raison d'être est-elle plus simple, plus humble, mais aussi plus essentielle, irréductible; peut-être, oui, est-elle de témoigner pour un lieu encore possible, pour une authentique habitation. Or n'est-il pas vrai qu'il n'y a de vraie demeure qu'ouverte à la communauté des hommes, là où un devenir commun est offert; qu'il n'y a de lieu que de partage et d'amour ?
Poser la question du lieu, c'est se demander si le poème peut être cette clef, en quoi Char voyait sa "demeure", et si ce n'est pas dans le poème que se réalise aujourd'hui la vocation par excellence du lieu : nous ouvrir à la présence du monde et des autres dans ce monde ?
17:15 Publié dans Mes ami(e)s, mes invité(e)s | Lien permanent | Commentaires (0)
01/11/2006
L'oeil dans la main - à propos du travail de Frédéric Lefeuvre
 Ces images cherchent à saisir le monde à son point le plus vivant. Là où ses frappes nous touchent. En ce point de vie qui fait trou dans la réalité.La technique n’a pas changé. C’est toujours de développement dont il s’agit. Mais là où il y a changement, c’est que dans les images de Frédéric Lefeuvre, Le développement se montre en tant que tel. Il vient sur le devant de l’image. Occupe son avant-scène. En propre.Chez Frédéric Lefeuvre, la photographie n’est pas art de la répétition. Retour à l’identique de ce qui a été. Tel quel. Privé de son champ de possibles, de cette banlieue du sens, de ces terrains vagues où demain se prépare dans les fumées. Cette mauvaise image qui rabat le fait sur lui-même, l’enferme sur lui-même par soustraction, lui retirant ce cortège de possibles qui l’accompagnait, on ne la rencontre pas chez Frédéric lefeuvre. Ces images à lui sont parfois déroutantes, c’est qu’elles s’arrachent à leur narrativité, à leur pouvoir de représentation et d’illusion. Elles sont travaillées de l’intérieur par cet arrachement.
Ces images cherchent à saisir le monde à son point le plus vivant. Là où ses frappes nous touchent. En ce point de vie qui fait trou dans la réalité.La technique n’a pas changé. C’est toujours de développement dont il s’agit. Mais là où il y a changement, c’est que dans les images de Frédéric Lefeuvre, Le développement se montre en tant que tel. Il vient sur le devant de l’image. Occupe son avant-scène. En propre.Chez Frédéric Lefeuvre, la photographie n’est pas art de la répétition. Retour à l’identique de ce qui a été. Tel quel. Privé de son champ de possibles, de cette banlieue du sens, de ces terrains vagues où demain se prépare dans les fumées. Cette mauvaise image qui rabat le fait sur lui-même, l’enferme sur lui-même par soustraction, lui retirant ce cortège de possibles qui l’accompagnait, on ne la rencontre pas chez Frédéric lefeuvre. Ces images à lui sont parfois déroutantes, c’est qu’elles s’arrachent à leur narrativité, à leur pouvoir de représentation et d’illusion. Elles sont travaillées de l’intérieur par cet arrachement.
 au travers des sels et des acides. Dans la cuve. Jusqu’à le ramener sinon tel quel du moins tel qu’il se donne dans son effacement. C’est cela qui reste. La trace d’un retirement, d’un en-aller.La question reste bien toujours celle de savoir comment produire des images en photographie qui ne soient pas redondantes par rapport à la réalité. Qui donnent toujours sa chance au réel comme celles de Frédéric Lefeuvre.Répétons. D’abord, il y a eu ces paysages. Ces choses de la terre sous le ciel. Regardées longtemps. très longtemps.
au travers des sels et des acides. Dans la cuve. Jusqu’à le ramener sinon tel quel du moins tel qu’il se donne dans son effacement. C’est cela qui reste. La trace d’un retirement, d’un en-aller.La question reste bien toujours celle de savoir comment produire des images en photographie qui ne soient pas redondantes par rapport à la réalité. Qui donnent toujours sa chance au réel comme celles de Frédéric Lefeuvre.Répétons. D’abord, il y a eu ces paysages. Ces choses de la terre sous le ciel. Regardées longtemps. très longtemps.Ensuite, il y a eu leurs traces dans les yeux. Sillons plus qu’empreintes. Moins caractères qu’entames.Et sur leurs devers a glissé la mémoire jusqu’à ce que ce soient comme deux trois pousses qui du fond des solutions ont remonté. Comme deux trois mots sur la page peuvent lever.En avant du poème.

Quelque chose vient d’ailleurs. Quelque chose n’en finit pas de remonter du fond des images de Frédéric Lefeuvre. Quelque chose qui les éclaire de l’intérieur.Loin de tomber sur ses images, la lumière en émane. Comme si elle provenait de lampes habitant depuis longtemps leur fond obscur. C’est elle que Frédéric Lefeuvre fait lever depuis la cuve. Les images qui y bouent sont des corps de lumière blanche. Corps de lune. Ils rayonnent.
Autour, il y a le gris d’une brume légère qui souvent tournoie, tourbillonne. Comment savoir si elle met les choses au fond d’une transparence ou derrière un voile? Les images de Frédéric Lefeuvre sont une réserve de formes . Un lieu possible de surgissement. Ce sont des aérolithes. Elles se suivent. Et voyagent. Entre perception, mémoire et imagination. Elles secouent les trois. Et quelque chose du ciel s’en trouve comme descellé. Et passe. En coup de vent.

Ce pourrait être la nuit. Un clair de lune exangue chercherait après son âme. Cette tournure, les doigts dans la cuve et le silence qui racle. Avant le couteau des sels. Et pour tout prix ce feu dont il rêve.
Cette vibrée d’un moment, combien a-t-il fallu de caresses acides pour qu’elle s’engouffre dans nos chemins et se rue jusqu’à nous?
18:00 Publié dans Inédits | Lien permanent | Commentaires (0)