03/05/2015
Lu 107- La barque de Pierre, Poème pour un pêcheur de Sant Cebrià de Serge Pey, VOIXéditions
 Oui, ça commence toujours par les pieds. Les pieds font base. Ainsi les morts aident-ils à se tenir debout. A risquer l’écart, le déséquilibre, c’est alors la marche. La marche en avant. Celle que vient de mener à bien Serge Pey entre le 16 et le 31 mai 2014 est un appel aux vivants. Le facteur de langue est parti de Toulouse pour déposer au terme de 15 étapes dans la boites aux lettres qui garde vivante la tombe d’Antonio Machado à Collioure, les courriers qu’il a fait écrire depuis octobre 2013 à « Don Antonio, le bon ». Enterré là depuis le 22 février 1939, « le poète du peuple » avait quitté Madrid le 24 novembre 1936 contre son gré, pour rester aux côtés des républicains, ses compagnons de combat contre Franco et ses misérables. Dans la mémoire de tous ceux qui ont l’Espagne au cœur, sa langue et sa liberté, Antonio Machado pérégrine encore. L’exil n’a pas effacé les « chemins sur la mer » qu’il a su tracer et dont il disait que c’était là notre affaire d’homme. Ils écument encore de tous leurs sillages dans son œuvre comme dans celle de serge Pey.
Oui, ça commence toujours par les pieds. Les pieds font base. Ainsi les morts aident-ils à se tenir debout. A risquer l’écart, le déséquilibre, c’est alors la marche. La marche en avant. Celle que vient de mener à bien Serge Pey entre le 16 et le 31 mai 2014 est un appel aux vivants. Le facteur de langue est parti de Toulouse pour déposer au terme de 15 étapes dans la boites aux lettres qui garde vivante la tombe d’Antonio Machado à Collioure, les courriers qu’il a fait écrire depuis octobre 2013 à « Don Antonio, le bon ». Enterré là depuis le 22 février 1939, « le poète du peuple » avait quitté Madrid le 24 novembre 1936 contre son gré, pour rester aux côtés des républicains, ses compagnons de combat contre Franco et ses misérables. Dans la mémoire de tous ceux qui ont l’Espagne au cœur, sa langue et sa liberté, Antonio Machado pérégrine encore. L’exil n’a pas effacé les « chemins sur la mer » qu’il a su tracer et dont il disait que c’était là notre affaire d’homme. Ils écument encore de tous leurs sillages dans son œuvre comme dans celle de serge Pey.
Dans sa marche de la Mémoire, dont la Poésie est fille, il a pris avec lui quelques munitions – ce sont livres chez Montaigne ! Outre ceux de Machado, Lorca, Hernandez, il a pris les siens et parmi les derniers : Le trésor de la guerre d’Espagne (Zulma), Les poupées de Rivesaltes (Quiero), L’agenda rouge du MIR – Mouvement indompté du Rêve – (Al Dante) et La barque de Pierre, poème pour un pêcheur de Sant Cebrià (VOIXéditions) dont j’aimerais vous dire quelques mots.
Saint-Cyprien, quartier de Toulouse où vécut Serge Pey est aussi le nom d’un village de pêcheurs sur la côte catalane, près d’Argelès où vécut dans un camp de concentration une partie de sa famille lors de « la retirada ». Serge Pey, « résistant du sens de l’homme », est un « esgardeur ». Sa main qui écrit a deux yeux, le premier est ouvert sur le passé, son regard l’empoigne : misère et grandeur, honte et fierté, meurtres et tortures, abandons et trahisons. La mémoire nourrit la révolte et la hargne. Le second se porte sur le présent qui se dissout dans l’actuel quand « les marchands vendent tout / jusqu’au soleil / qui ne leur appartient pas » , quand « les bouchers de la lumière (…) débitent la mort » pour « les passants de l’été », décérébrés, sans mémoire qui « passent devant le Bel Ange / échoué au Barcarès / sans savoir son histoire ». Sans savoir qu’ici, les bulldozers ont détruit le Bourdigou aux maisons de sanils et de vent, où « l’on pensait faire / des choses en commun / pour qu’elles ne soient pas communes ».
L’écriture de Serge Pey est résurrectionnelle. Elle fait lever les morts et ses « généalogies » « tirent sur le sommeil / avec de vieux fusils ». Alors les filets de Pierre ramènent dans le présent les images d’hier. Dans les brisements qui suivent ces chocs, sur les arêtes des images de Serge Pey paraissent des éclairs d’une durée nouvelle et sous leur lumière un « nous » prend forme. Un « nous », issu de l’ombre, « dans le dos de la mer », s’annonce. C’est un « nous » en marche qui dit : « nous sommes la vieillesse / nous sommes la jeune mer / et aussi la mer qui vient / et celle qui jamais n’arrive ». C’est un « nous » à « gueule de chien » qui hurle « l’internationale des anges ». Ce « nous » qui revient « parce que nous ne sommes / jamais venus », c’est nous. Demain.
( article paru dans la revue Europe )
09:58 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : serge pey, voix éditions
Lu 106 - lmtv d'Emmanuel Laugier, NOUS, disparate
Pour un OVNI, ce ltmw, dernier livre d’Emmanuel Laugier, en est un ! Un acronyme, je veux dire, ce mot formé à l’aide des initiales d’autres mots. Et ici anglais ! - Il est vrai qu’on trouvera aussi de l’italien - letters to my wife !
Des lettres qui n’en sont pas vraiment, des poèmes - tous numérotés de I à LXXXI – comme autant de blasons à la manière de cette poésie galante du XVI, ces courts poèmes célébrant une partie du corps féminin – on se souvient du « beau tétin » de clément Marot ou du « front » de Maurice Scève - autant d’arrêts sur image d’un long plan séquence qui juxtaposés tiennent dans leur étreinte, bord à bord, l’inexprimable du sens de ce qui s’est passé entre celle nommée « émi », « my own mily one », ces senhals – mais oui, le trobar clus des troubadours n’est pas loin ! - de la « tua donna », poèmes d’amour, donc. Et l’amour aime le secret. Il aime à se cacher. Les poèmes sont cabanes dans le désert de la langue, abris fragiles pour celer, soit contenir et cacher comme le gant la main, l’amour. C’est en cela que le poète que cherche à être Emmanuel Laugier cèle son désir dans le corps de ce livre, dans ce ltmw.
Finalement banal dans leur propos – traduire cette traversée risquée qu’est l’expérience amoureuse - déconcertant dans leur forme et leur démarche, dira-t-on de ces poèmes que leur lecture est difficile ? Que s’y enchevêtrent bien des éléments hétérogènes ? Qu’elle charrie bien des nuages? Plutôt accepter cette obscurité apparente, ne pas vouloir/croire tout éclaircir, s’accomoder des ombres. Ne pas en faire un épouvantail. Il n’y a pas de vérité cachée, d’ordre mystique, hermétique, cabalistique. Pas d’allégorie, pas de clé qui permette de tout comprendre. Pas de fil interprétatif à tirer.
Le texte, de poème en poème, certes peut égarer le lecteur tant il sème à foison des traces – n’en relevons que quelques-unes des chanteuses de jazz comme Jeanne Lee ou Billie Holliday et sa chanson « my man », des groupes ou chanteur de rock alternatif comme Sonic Youth, PJ Harvey en passant par des paysages comme ceux de la route des claps sur les Hauts de Grasse ou ce « paysage de la route d’Uzès » de Nicolas de Stael, des références littéraires à Ossip Mandelstam et à son « verbe à cheval » ou encore à Maurice Blanchot et à sa « folie du jour », à Sandro Penna, Pier Paolo Pasolini… - mais il peut le conduire aussi bien, de lueurs en lueurs, d’obscurité levée en obscurité renouvelée à se trouver dans la situation de qui aime et tombe, perd ses marques en face de l’aimée. Peut-être n’est-il même pas écrit du tout ce texte, peut-être « n’est-il pas là pour être lu, comme l’écrivait Samuel Beckett à propos du Finnegans Wake de Joyce, ou plutôt (…) pas là seulement pour être lu. » Mais « regardé et écouté. »
On ne lit pas Emmanuel Laugier les yeux fermés mais bandés et les oreilles attentives. Ainsi appréhende-t-on une singularité, l’intensité d’une langue en acte, une écriture qui est du côté de la frape, qui cogne et casse ce qui dans la langue est du côté du signe, des représentations, des idées toutes faites associées trop vite et trop aisément .
Il y a dans l’écriture d’Emmanuel Laugier comme un dynamisme immobile, une alternance d’accélérations et de ralentis, de rythmes et de contre-rythmes, des arrêts, des suspensions…Il y a là une manière de tourner autour d’émi, de jouer avec ses courbes. Une ronde.
Couper/recouper/mailler moins les faits que leurs traces. Certaines expressions, certains vers font tourniquet, ils reviennent en ritournelle.
Ainsi voit-on l’écriture d’Emmanuel Laugier se jeter à côté et en avant. Accélérer la langue, la déplacer : mots retournés, agglutinés ; phrases dis-jointes, concassées ou allongées ; stolons qui enjambent les lignes. C’est dans ces avancées aux fréquents arrêts, aux silences d’arrière que la langue d’Emmanuel Laugier prend sous sa sauvegarde les traces des regards perdus à l’avant et du corps qui les porte.
Importe l’intensité d’une langue en acte et, pour nous, de ne pas réduire les individualités, les singularités… méfions-nous de nous-mêmes, de notre paresse qui vite file à l’oubli des textes eux-mêmes. ltmw exige de nous une posture. Il faut rouvir ses yeux comme on remonte ses épaules. Il faut se ressaisir pour le lire. Ressaisissons-nous !
( article paru dans la revue Europe )
09:53 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lmtv, emmanuel laugier, nous
Lu 105 - Geoffroy Squires - Sans Titre, éditions Unes
 Il y eut d’abord le feu aux Belles Lettres, puis l’eau et la boue à la galerie Remarque à Trans-en-Provence. Salamandre, les Editions Unes renaissent, reprises par un poète, François Heusbourg avec l’accord – ce serait peu ! – l’appui et l’enthousiasme toujours intact de Jean-Pierre Sintive, leur fondateur en 1981. A ce jour 5 livres publiés : Tréfonds du temps de Maurice Benhamou, Issue de retour de Jean-Louis Giovannoni,; Sans titre de Geoffrey Squires ; A côté du mot perdu de Bernard Noël et le troisième de Esther Tellerman.
Il y eut d’abord le feu aux Belles Lettres, puis l’eau et la boue à la galerie Remarque à Trans-en-Provence. Salamandre, les Editions Unes renaissent, reprises par un poète, François Heusbourg avec l’accord – ce serait peu ! – l’appui et l’enthousiasme toujours intact de Jean-Pierre Sintive, leur fondateur en 1981. A ce jour 5 livres publiés : Tréfonds du temps de Maurice Benhamou, Issue de retour de Jean-Louis Giovannoni,; Sans titre de Geoffrey Squires ; A côté du mot perdu de Bernard Noël et le troisième de Esther Tellerman.
J’aimerais glisser quelques mots supplétifs à ce Sans Titre, œuvre d’un poète irlandais, inconnu en France et dont François Heusbourg, son traducteur, nous donne la traduction.
Un poète traduit et au plus juste de l’inexprimable se risque dans la langue de l’autre et c’est la nôtre qui reçoit comme un air nouveau qui vivif-ie.
Geoffrey Squires est le poète de ces riens « suspendu(s) au-dessus », « dans l’air » qui se mêlent - « une chose coulant dans une autre » - se fondent sans que l’on ne sache plus « où cela fut » ni même « si cela fut » sauf que cela revient comme une hantise sans que l’on sache pourquoi. Poète de la relation, ou plutôt de la fusion des états de conscience, Geoffrey Squires se montre tout prêt à sauter hors de l’espace mesurable comme du temps des horloges – cet autre espace – où ne joue que la causalité pour, par delà toute chronologie, insister sur une chronographie, une inscription des choses les unes dans les autres. Choses qui de qualité à qualité – « douce(s) intangible(s) comme le sont les qualités » - « s’étend(ent) de toutes parts », prolifèrent – rhizome pas racine ! – poussent à l’horizontale, s’étalent. Devant quoi nous restons « perplexes / incapables de nous en saisir », assurés du fait que « ça ne disparaît pas juste parce que ça a été oublié » mais sans prise sur une quelconque destination. Nous resterons là sans savoir « où tout cela peut bien aller » si ce n’est vers un « peut-être ».
C’est avec ce « peut-être » que nous aurons à travailler - « imagine ce que cela pourrait signifier » nous intime Geoffrey Squires – « travailler avec l ‘oubli : travailler avec ce que l’on ne sait pas » écrit Bernard Noël dans Livre de l’oubli. A quoi je rajouterais volontiers un ou que l’on ignore avoir su ! Et ce pourrait être inventer cela. Produire du nouveau !
( article paru dans le journal L'Humanité)
*
C’était là manière de saluer un retour, une exigence et en profiter pour inviter ceux/celles qui passeraient par Nice à aller voir du côté du 13 de la rue Pauliani à Nice la librairie/galerie Arts 06 que François Heusbourg anime. Passant dans cette rue, ils pourront aussi pousser la porte de la Galerie Quadrige pour voir les éditions de la Diane française que dirige Jean-Paul Auréglia.
09:44 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : geoffroy squires, françois heuxbourg, éditions unes
In Memoriam Charles Dobzynski (1929 - 2014)-III
Notre ami Michel Ménaché nous avait envoyé cette note parue depuis dans la revue Europe que Charles Dobzynski avait écrite à l'occasion de la parution du livre de Michel Ménaché et Josette Vial : Istanbul –Kilim des sept collines paru à La Passe du vent en 2014.
Que la reprendre ici soit notre manière de rendre un nouvel hommage à l'immense passeur de poèmes que fut Charles Dobzynski.
"C’est un album à trois têtes, ou plutôt à trois cœurs : photographie, poésie, correspondance, dans un élégant format à l’italienne qui s’accorde à son sous titre : Kilim des sept collines. Le Kilim est un tapis d’Orient qui inclurait ici, dans son dessin, les sept fameuses collines de la mégapole Istanbul, chevauchant par le Bosphore à la fois l’Europe et l’Asie. Cette ville fabuleuse - misère et merveille souvent juxtaposées - le poète Michel Ménaché en compagnie de la photographe Josette Vial, en parcourt non seulement les apparences, prises dans leur actualité en saisissants instantanés, mais les strates de mémoire. Celles-ci se trouvent entrecroisées en réseaux d’émotions, de remémorations, de reconstitutions mentales infusées d’une nouvelle vie. Ce n’est pas le journal de bord ou le bloc-notes de voyageurs curieux, de touristes avides de pittoresque, de témoins circonstanciels, mais un roman qui s’invente sous nos yeux en réseaux multiples de langages : celui de l’image illustrante et illuminante, celui de la poésie en vers ou en prose, tantôt dans des séquences brèves et intenses, tantôt dans l’alternance des missives adressées par son grand-père Marcos, juif sépharade et stambouliote, à son petit-fils supposé être alors âgé de deux ans. C’est le petit-fils qui reconstruit et nous restitue, à partir d’ échos d’un vécu sans doute familialement transmis, l’expérience singulière d’un homme heureux dans son cadre natal, mais très tôt victime d’une condition trop précaire, de suspicions et de persécutions, conduit à contrecœur à émigrer jusqu’en ce carrefour de l’Argentine, Buenos Aires, alors refuge privilégié de cohortes d’Européens démunis et parmi eux beaucoup de juifs plus ou moins hispanophones, en quête d’une terre d’asile où règne enfin la tolérance et la possibilité de vivre et de travailler dans la dignité.
La vie de cet homme est un puzzle que Ménaché s’emploie à rendre déchiffrable, sensible, attachant, à commencer par cette histoire d’amour et de mariage suspendu, reporté de deux ans par les exigences d’une époque où la pauvreté accablante est le ressort de l’émigration. Le roman de son grand-père Marcos, l’imagination de Ménaché, constamment gouvernée par le souci de la vérité des faits, des détails, et la tendresse générique qui l’irradie, nous le restitue miraculeusement de lettre en lettre. Cette correspondance-fiction semble transiter dans l’espace avec les ailes des oiseaux migrateurs. Mais c’est surtout l’histoire qu’elle traverse et transcrit molécule par molécule, mot par mot. L’histoire légendaire de Constantinople, devenue Istanbul, l’évocation de son quotidien, de son ancienne communauté juive dont le judéo-espagnol, depuis l’expulsion d’Espagne en 1492, demeure la langue d’expression, l’histoire de l’arrivée et de la prise de pouvoir des Jeunes-Turcs, puis de Mustapha Kemal qui tentent de tirer du marasme et de l’effondrement de l’empire ottoman, après la première guerre mondiale, « l’homme malade de l’Europe». Marcos a suivi les cours en français de l’Alliance israélite. C’est un homme d’intelligence, de culture, d’irréductible passion pour la vie, qui rejette des « superstitions ridicules et des préjugés pernicieux » et pour qui la France est un phare : « L’exposition universelle de 1900 n’en finissait pas de nous enthousiasmer. A cette même époque, un officier juif injustement condamné bouleversait nos quartiers. J’accuse d’Emile Zola avait fait l’effet d’une bombe sur les deux rives de la Corne d’or…» Histoire tumultueuse et complexe où se conjuguent les antagonismes des Grecs, des Arméniens, des Musulmans. Et des juifs assignés au recommencement de leur diaspora…
Le Kilim biographique du poète est tissé des commentaires et des pérégrinations incessantes de son Grand Père, d’Istanbul à Buenos Aires et Barcelone, puis en France où il connaîtra, à l’heure de l’occupation nazie, de nouvelles et dramatiques tribulations. Lettres admirables de justesse et de véracité dans leur réalisme. Mais il importe de souligner qu’elles participent d’une subtile orchestration, constamment ponctuée par les photographies qui piègent pour nous des moments, des sites surprenants (tel ce fronton rescapé d’une synagogue incrusté de caractères hébraïques) des visages, des personnages furtifs mais réels. Ponctuée d’autre part comme d’une mélodie qui remonterait du fond des temps et des êtres, par les vers limpides de Ménaché, fils conducteurs – petits-fils conducteurs aussi – de ce livre. Par exemple lorsqu’ils servent de filigranes à l’image de la synagogue retrouvée :
La langue hébraïque
Survit dans un théâtre d’ombres
Tant de livres ont brûlé
Tant de cris se sont perdus
dans les cendres.
La pierre se souvient
elle signe
le passage d’une main amie
au bord d’une pierre tombale.
Oui, il est vrai que tant, que trop de cris se sont perdus. Mais la voix du grand père Marcos persiste et signe, gravée dans l’écriture lumineuse d’un héritier qui possède l’art et le don d’un diamantaire de la mémoire."
Charles Dobzynski
09:26 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charles dobzynski, ménac hé, europe
01/05/2015
In Memoriam Jacques Kober ( 1921 - 2015 )
« ô ange nu console à jamais ce traître à la mort que je suis »
Pierre-Jean Jouve
Pierre Grouix disait de Jacques Kober qu’il était le « cadet des surréalistes ». Il l’était devenu en effet à partir du moment où Aimé Maeght lui confie la revue Pierre à feu et le lancement de la collection Derrière le miroir dans les années 44/45. Il lui sera donné alors d’être connu et reconnu par Breton, Eluard et tant d’autres porteurs de lumière, constructeurs de murs qui tremblent comme de travailler dans cette compagnie qu’il aimait : celle des peintres Matisse, Bonnard, Rezvani, Adami…
 Jacques Kober incarnait cette poésie qui ne loge pas dans les rêves de quelque ailleurs factice, hors d’un Ici et Maintenant que nous avons à habiter. Il n’y avait pour lui que du connu et de l’inconnu, du Supérieur Inconnu dirait son fils Marc !
Jacques Kober incarnait cette poésie qui ne loge pas dans les rêves de quelque ailleurs factice, hors d’un Ici et Maintenant que nous avons à habiter. Il n’y avait pour lui que du connu et de l’inconnu, du Supérieur Inconnu dirait son fils Marc !
La poésie était pour lui l’expérience même de ce qu’il en est de vivre. Relisons son poème « L’existence du puits » :
Aimer juste ce qu’il faut pour faire bouillir la marmite
Ou bien ramener par l’anse de l’imagination
Un grand seau d’existence du puits nommé plongeon
Le matelot a embarqué le lundi 19 janvier 2015.
On peut imaginer sans y croire que son nouveau pays aura nom Jasmin *!
Alain Freixe
*A propos de ce Jasmin, tu es matelot, paru aux éditions Rafael de Surtis en Novembre 1998, j’avais écrit une note de lecture publiée dans un numéro de la revue de poésie Friches en coup de cœur à la mi-mars 1999. La voici telle quelle.
"Pour moi, Jacques Kober, c’est un sourire. Quand je le croise à la faveur d’une conférence, d’une lecture ou d’un vernissage, c’est son sourire que je vois d’abord. Présence d’un visage, donc.
C’est ce sourire que je retrouve aujourd’hui porté par ses mots d’il y a 50 ans - C’était hier, ils ignorent les rides! C’était le temps de « la pierre à feu » ou encore de « Derrière le miroir » que Jacques Kober allait créer chez Adrien Maeght - ceux de Jasmin tu es matelot que les éditions Rafael De Surtis ont eu l’heureuse idée de reprendre. Les trois textes qu’il comporte sont ici augmentés d’une postface de Jacques Kober et présentés avec, en couverture, un dessin de Rezvani resté inédit à l’époque.
Il y a quelque chose d’irréductiblement jeune dans ces textes forgés au « frais de l’amour » et sous ce que les paysages méditerranéens aimés peuvent aussi abriter de sombre, cette part noire d’une mer réputée calme. Ici, le surréalisme est dans toute sa force ascendante. Jacques Kober donnent à ses mots « la force brisante » des images afin qu’ouverts, ils libèrent cela qui en eux cherche à aller plus loin que leurs toujours trop étroites déterminations, et qu’allégés, ils remontent vers un de ces « clairs de terre » - Personne n’a oublié ce titre d’André Breton! - où le ciel, dans « le bégaiement du tonnerre », pèse de toute sa foudre bleue où il lui arrive de trouver à s ’incarner.
Dans ce livre, on tutoie le rêve sous une lumière solaire telle que la mort qui passe dans l’angle obtus du ciel n’est là que pour entretenir la vie.
Vous manquez d’air?
Lisez ce livre de Jacques Kober. Il y souffle l’air salubre du large. Air qui donne corps à ce qui s’exténue dans les signes et se caille dans les mots. Le jasmin, ses effluves, sont les bordées d’un matelot qui dans sa prise de terre - « Ma fête, c’est la terre », écrit Jacques Kober - lance ses mots - Mots d’ « un langage de la passion à ciel de sable » - sur la portée du jour.
19:39 Publié dans Du côté de mes interventions, Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0)
01/10/2014
In memoriam Charles Dobzynski - I -
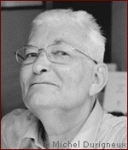 Charles Dobzynski, poète, traducteur, animateur infatigable de la revue Europe, après avoir collaboré à Ce soir, Action poétique,aux Lettres françaises et à Aujourd'hui poème, est mort le 26 septembre à quatre-vingt-cinq ans. Il laisse le souvenir d’un homme engagé et une oeuvre considérable. La bourse Goncourt de la poésie lui a été attribuée pour l’ensemble de son œuvre en 2005.
Charles Dobzynski, poète, traducteur, animateur infatigable de la revue Europe, après avoir collaboré à Ce soir, Action poétique,aux Lettres françaises et à Aujourd'hui poème, est mort le 26 septembre à quatre-vingt-cinq ans. Il laisse le souvenir d’un homme engagé et une oeuvre considérable. La bourse Goncourt de la poésie lui a été attribuée pour l’ensemble de son œuvre en 2005.
Aux éditions de l'Amourier, il avait confié 3 titres: Le Réel d'à côté , L'Escalier des questions et La mort, à vif
En hommage à celui qui disait que sa conception du poétique était "un horizon qui tourne et que nous devons essayer de capturer dans nos recherches", j'aimerais reprendre ici un fragment de l'entretien qu'il m'avait accordé en 2006 lors de la réédition de son "Escalier des questions" et dont vous trouverez l'intégralité sur le site amourier.com, rubrique Basilic. Il s'agit du N°10 que vous pouvez télécharger).
Alain Freixe : Dans le chapitre intitulé “ Si je t’oublie Sri-Lanka ”, on apprend que cet escalier des questions renvoie à une légende affectant le rocher de Sigirya, qu’il est sans commencement, qu’il n’a de fin ni dans le ciel ni dans l’ultime goutte de la pluie ”. On apprend qu’il n’est pas orienté, que “ l’étage de la splendeur ” n’est pas plus en haut qu’en bas, double horizon toujours sous les nues. Pour l’homme qui marche, pour le poète, pour vous comme le disait l’un des beaux titres d’André Frénaud – bien injustement oublié à mes yeux – “ il n’y a pas de paradis ”…
Charles Dobzynski : L’Escalier des questions n’existe qu’en tant que mythe. J’ai forgé ce titre à partir d’un souvenir : la montée de l’escalier en spirale de l’étonnant rocher karstique de Sigirya, au Sri-Lanka. La paroi rocheuse que gravit cet escalier métallique est ornée de fresques anciennes aux sujets légendaires. Je n’ai pu atteindre la plateforme supérieure et ses lions de granit, surpris par un violent orage qui m’a contraint à redescendre en quatrième vitesse. Cette plateforme est “ l’étage de la splendeur ” où je ne suis pas parvenu, comme interdit par le destin. Cette mésaventure de l’interruption, sous la pluie battante et les éclairs, m’a posé le problème des commencements et des fins, des désirs et des velléités. Pour moi, l’escalier n’a jamais pris fin. Il est resté en suspens. Il est resté en question. Qu’aurais-je vraiment trouvé là haut, en supposant que j’atteigne ce qui est supposé être le paradis, un degré de l’altitude d’où la vue devient infinie ?
Alain Freixe : Ainsi donc s’écrit le temps. Marche à marche. Question après question. Sans prise. En prose ! Car sont poèmes en prose les marches qui composent cet escalier des questions. De courts récits souvent insolites qu’un humour aux arêtes vives met souvent en scène. On pense à Michaux, à Monsieur Plume…
Charles Dobzynski : Oui, le temps s’écrit en marchant, en montant, parfois sans but défini. Mais on peut aussi, par la spirale de la mémoire, le redescendre en sens inverse et modifier du même coup la perspective. Nous avançons dans notre vie par degrés successifs et souvent par les degrés de questions non résolues, de mystères qui sont des marches dans l’obscur, et ces questions sont des brèches dans notre généalogie. Chaque bref récit a pour composante un souvenir, qui est en même temps le noyau d’une question. Certes, on y habite l’insolite. On y erre dans le dédale de l’étrangeté. C’est par l’étrangeté que l’on se découvre, que l’on repère sa singularité. Et l’humour aide à cisailler les barbelés des idées toutes faites.
Alain Freixe : Puis-je me permettre une dernière question, plus générale celle-là. Elle concerne la poésie en son présent. Vous êtes un homme de revue, engagé dans l’histoire de la poésie de ces quarante dernières années, comment décririez-vous le paysage de la poésie française d’aujourd’hui ? Vous-même où vous situeriez-vous ?
Charles Dobzynski : J’ai le sentiment que la poésie est aujourd’hui plus vivante que jamais, multiple, à l’école buissonnière des prédicats et des dogmes. Elle se cherche des ouvertures, des écoutes nouvelles, plutôt que des sophistications qui aboutissent à des impasses. Les écritures se font plus sensibles au réel, au subjectif, à l’intime redéployé. Les chapelles tournent au clan et les anathèmes d’un certain terrorisme esthétisant tournent à vide. Le paysage poétique est émaillé de réminiscences, de désirs, de pulsions amoureuses et d’une volonté de changer que ne favorise pas toujours l’émiettement des structures poétiques. Je me félicite de la diversité, de la pluralité des tendances. Mais le vers, fût-il autrement commandé, doit rester le vers, porteur, comme un fil, de l’électricité poétique. En ce qui me concerne, outre le travail critique que je poursuis à Europe et à Aujourd’hui Poème, en dehors de tout esprit de chapelle, j’essaie par la poésie de tirer un peu de lumière d’un puits sans fond. Je ne me situe que par rapport au devenir, à la liberté que je revendique, une liberté qui ne se contente ni du jeu ni du système de destruction des formes. J’ai été un enfant – tardif, c’est vrai, – du surréalisme, puis de la Résistance. Aujourd’hui, je refuse tout cadre préétabli, car je sais que je me transforme avec la poésie, avec l’écriture. Chaque étape sur cette voie, chaque livre, participent d’un mouvement qui est peut-être aussi un recommencement.
18:11 Publié dans Du côté de mes interventions, Du côté de mes publications, Mes ami(e)s, mes invité(e)s | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : charles dobzinski
07/08/2014
Lu 104 - Amelia Rosselli, Variations de guerre et La libellule, Ypsilon éditeur
 Il y a des livres comme ça qui restent là à attendre*. On les prend, les reprend. On attend
Il y a des livres comme ça qui restent là à attendre*. On les prend, les reprend. On attend 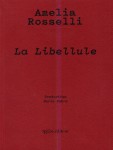 aussi d’engager la lecture, un peu interdits sur ce qui en eux faiseuil : Ici, dans ces Variations de guerre d’Amelia Rosselli, ce « croisement de fièvre et de rigueur » dont parle Jean-Baptiste Para dans sa préface. On sait parce qu’on les a feuilletés qu’ils sont importants, terriblement importants.
aussi d’engager la lecture, un peu interdits sur ce qui en eux faiseuil : Ici, dans ces Variations de guerre d’Amelia Rosselli, ce « croisement de fièvre et de rigueur » dont parle Jean-Baptiste Para dans sa préface. On sait parce qu’on les a feuilletés qu’ils sont importants, terriblement importants.
Le temps passe. Sans vraiment passer. C’est dans ses calmes que vient de paraître La libellule, ce texte de 1958, toujours aux éditions Ypsilon. Texte fondateur d’une poétique dont le mouvement de rotation de cette « tournoyeuse langue », avec ses arrêts et ses brusques démarrages, est mouvement de libération.
On sait qu’écrits de l’autre côté du désespoir, à mains fatiguées de tourner et retourner la langue comme terre gaste, stérilisée à force de mots trompeurs, dégradés, trahis, ces textes en portent la marque, flamme vivante au-dessus des cendres qui ne saurait manquer de nous requérir. Affaire de jour !
Il y a dans les poèmes de ces Variations de guerre, comme dans cette Libellule, cette force qui tient les écrits, qui « défamiliarise la langue » selon la juste expression de Marie Fabre, la tord tout en la gardant dans des formes contre lesquelles elle vient résonner. Et c’est poésie cela ! Il y a là un ton que j’aimerais donner à voir à travers les mots mêmes d’Amelia Rosselli comme celui de « la rixe hivernale de vent, grêle et souffle de printemps mitigé» qui en « radieuses terrasses », bandes passantes, « (labourent) le sol de leurs rayures féroces ». c’est lui qui tient les poèmes en un tout organique, présence intermittente du sujet qui se fait dans le langage et par lui. Ce ton est celui de la guerre quand la guerre est ce « combat spirituel » dont parlait Arthur Rimbaud, cette « volonté d’ouvrir les yeux, de voir en face ce qui arrive, ce qui est » selon les mots de Georges Bataille, celle de ne pas se dérober – « contre tout le mal : voir et savoir » -, de s’efforcer de voir ce que l’on nous invite à ne pas voir, de faire face à son temps, temps corrompu de part en part où « amitié et fidélité » apparaissent comme « choses impossibles » à désirer. Ce ton est celui d’un « esprit vigoureux » secoué par cette mélancolie active qui échoit en partage à l’éternel retour des défaites où l’on voit « sous son pied s’arrêter la lumière » et bégayer l ‘histoire. Défaites, abandons, trahisons, enfer pour l’ « âme rebelle » d’Amelia Rosselli.
Dans cet espace, parfois je vois l’écriture d’Amelia Rosselli se glisser de si en si, de si…alors en si …alors, de contre en contre, entre mots, images et phrases comme entre cailloux et mottes de terre coulent et fuient les serpents ; d’autres fois, je la vois comme une manière de se tenir et de se hisser, de prise en prise, jusqu’aux mots suivants, aux souffles suivants, aux reprises suivantes. Ecrire en enfer, enfer dont on tient battante la porte tant qu’on a la force de jeter le pied contre le chambranle pour qu’elle ne puisse se fermer ce qui rendrait tout possible, toute bifurcation, tout poème impossible.
Viendra un jour de février 1996 où la révolte sera trop grande pour elle, un jour où elle rejoindra les vaincus, ceux qui jusque dans la mort affirment cette part d’inaliénable et irréductible liberté, ce non majeur, ce refus des portes closes, ce principe de résistance « en attente de l’espérance ».
* Amelia Rosselli, Variations de guerre, Traduction et postface de Marie Fabre, Ypsilon.éditeur, 2012 et La libellule, Traduction Marie Fabre Ypsilon éditeur , 2014
17:44 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : amelia roselli, marie fabre, la libellule, variations de guerre, ypsilon
Lu 103 - Philippe Jaccottet en Pléiade!
Etonnante Pléiade* pour les lecteurs de l’œuvre de Philippe Jaccottet! Etonnante, tant ils étaient habitués à certains regroupements éditoriaux. Ici, tous ses livres sont rendus à leur stricte chronologie. C’est son écriture de « création », poèmes, proses et notes de carnets – Ah ! ces « semaisons » que complètent pour l’occasion des « observations » ! - qui ont été regroupés dans ce volume par José-Flore Tappy avec Hervé Ferrage, Doris Jakubec et Jean-Marc Sourdillon, sous l’œil bienveillant et coopératif de Philippe Jaccottet lui-même qui rejoint du coup le club très fermé des auteurs publiés de leur vivant dans la prestigieuse collection – parmi les poètes citons Claudel, Perse et Char.
C’est une belle action que de publier ce beau volume N°594 dans la Bibliothèque de La Pléiade. Je me risque à dire beau parce qu’à le lire on se redresse, on remonte les épaules, la tête quitte le sol vers le haut, marcher à nouveau, marcher encore est à nouveau possible. Beau parce qu’il nous allège au lieu de nous alourdir et qu’il dénoue en nous les langues de la vie. Beau parce qu’une parole de Simone Weil me revient toujours lorsque je pense à la poésie de Philippe Jaccottet : « est beau, écrivait-elle, le poème qu’on compose en maintenant l’attention orientée vers l’interprétation inexprimable en tant qu’inexprimable ». Beau enfin comme un chant quand il n’est rien d’autre « qu’une sorte de regard », chant qui fait passer cette joie antérieure au poème, « d’un autre ordre que littéraire, dieu merci » s’exclame Philippe Jaccottet, dont cela « qui ne peut se voir » reste la source toujours vive et que fait affleurer la baguette de coudrier de nos étonnements.
De son premier livre, L’effraie et autres poèmes (1953) à cette Couleur de terre, inédite, venant juste après Ce peu de bruit (2008) qui accompagnait son anthologie L’encre serait de l’ombre, Philippe Jaccottet est resté fidèle à son injonction : « c’est la lumière qu’il faut à tout prix maintenir ». La lumière, mais quelle ? Celle venue des mots, justement. Cette troisième lumière dont il parlait dans « A la lumière d’hiver » qui après celle du monde, après celle qui du monde passe en nous, est celle « dont ma main trace l’ombre sur la page ». C’est celle-la que l’encre de l’écriture de Philippe Jaccottet porte et diffuse quand sa main croise le visible et le mental. Telle est alors l’évidence de ses images dont il n’y a pas à se méfier, réservant cet œil-là à ce qui dans d’autres images pourrait relever du forçage à vocation stupéfiante.
C’est là que l’écriture de Philippe Jaccottet trouve son ton – J’appelle ton, cette mise en variation de la langue, cette modulation et cette tension de tout le langage - dans cette manière qu’il a de la transmettre « comme une étincelle ou une chaleur ». C’est toujours dans les basses, dans le peu mais endurant, le murmure. C’est quelque chose toujours proche de la limite où sombrer dans le silence est le risque : « limite heureuse qui n’enferme pas ». On dirait que passent alors et se déposent des « buées musicales ». Ce ton est celui qui mêle en un défi le bruit que fait la rouille des feuilles à ce chant que libèrent les roses, et c’est comme un éclat qui se vaporise haut dans l’air contre tous les froids et tous les malheurs du monde.
Je voudrais redire combien sont belles ces quelques 1600 pages, je les vois comme un de ces cols que nous aurions décidés de gravir, garant de continuité, de passage, douant d’ouverture nos montagnes sur cette lumière qui s’élève depuis l’autre versant, remonte les pentes inconnues et dont les premiers souffles, en passant, nous rafraîchissent et affermissent nos pas de marcheurs voutés par trop de doutes, comme le dit souvent Philippe Jaccottet.
* Philippe Jaccottet, Œuvres, Bibliothèque de La Pléiade, NRF, Gallimard
17:34 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe jaccottet, pléiade
05/07/2014
Lu 102 - Fabienne Courtade, Le même geste, Poésie, Flammarion
Ecrire, c’est toujours un même geste*, ce même geste qui est à l’œuvre quand ce mouvement de la main et du corps lève devant lui l’inconnu, quand il ne s’agit pas de traduire une expérience antérieure avec ses sentiments et ses secrets mais quand cette manière d’aller est elle-même le lieu de l’expérience, la réponse apportée à un passage de vie, à ses éclats.
Si le jour est la fatalité du langage, comme l’écrivait Roger Laporte, la nuit serait alors la chance du silence. C’est dans la nuit qu’écrit Fabienne Courtade, celle des sensations vivantes comme telles impossibles à communiquer tant leur magma est fait non seulement d’assemblages mais encore de déchirures, d’écarts. Ici les blancs, les accélérations, les ruptures abondent comme les passages en italiques qui sont et ne sont pas du texte, ni citations, ni paroles rapportées. Au plus, ce sont des trous, au mieux des jours. Le même geste signe une narration ajourée, impossible. Une fiction d’oubli.
D’où viennent les mains jusque dans la main qui écrit ? Ici, cette main n’impose aucun ordre, se refuse à baliser la mémoire, à cairner un chemin. Elle fait advenir l’oubli. Un labyrinthe. Tout se passe comme s’il y avait un enraiement du langage. Ça patine, ça s’interrompt, ça déraille. Si ça bouge, c’est dans le même. Ça balbutie, ça piétine, ça s’enlise. On n’arrive pas à assurer ses pas, à s’assurer de prise en prise, on bute sur la cassure des phrases, des tentatives de narration .
Dans cette écriture rompue, j’entends une insurrection de la langue contre elle-même, une insurrection douce, à voix basse, à parole menue. Rien ici qui tonitrue simplement des mots, des phrases qui dans ces pages disjointes mettent le sens hors-jeu. Et nous voilà comme jetés dehors, sans plus savoir où l’on doit aller, égarés entre les chemins d’une impossible contrée, les mailles d’un épervier qui, remonté, dégoutte dans la lumière ses perles d’eau où le soleil se prend, histoire de nous faire croire encore au ciel. Car c’est poursuivre qu’il nous faut ! Longer ravins et lisières, passer et repasser les lignes frontières, suivre le fil ténu des disjonctions, des coupures, des séparations, fil qui seul nous relie à ce qui nous échappe, cette impossible histoire qui du dehors fait signe, non plus miroir que l’on promenait sur la route mais bris de miroir, morceaux épars, fragments, bribes, miettes que Fabienne Courtade ramasse, plie, déplie, replie, entasse un peu ici, beaucoup là-bas, et entre, c’est son souffle qu’on entend, ras mais endurant, la vie qui passe, qui s’en va vers l’autre.
* Fabienne Courtade, Le même geste, Poésie, Flammarion, 18 euros
17:57 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fabienne courtade, le même geste, flammarion
Lu 101 - Raphaël Monticelli, Mer intérieure, La passe du vent, Poésie
Mare Nostrum, la Méditerranée est notre Mer intérieure*, bleue et noire à la fois, peuplée de fortes images fémininines, ces passantes du coeur. Elle a trouvé abri dans l’anse de nos yeux comme les œuvres des onze artistes convoqués ici : Leonardo Rosa, Jean-Jacques Laurent, Fernanda Fedi, Eric Massholder, Gilbert Pedinielli, Meriem Bouderbala, Oscari Nivese, Abdelaziz Hassaïri, Anne-Marie Lorin, Martin Miguel, Henri Maccheroni. Tous vivent sur les rives de la Méditerranée : Grèce, Italie, Croatie, Provence, Malte, Egypte, Tunisie.
Mer intérieure est un rassemblement de textes écrits pour comprendre ce que les œuvres de ces artistes portent en elles de sens pour nous repérer dans le monde où nous vivons, monde mouvant, imprévisible, dangereux où rien n’est plus comme hier et où nous n’avons pas la moindre idée de ce que pourra bien être demain.
Rassemblement certes mais composé ! Mer intérieure est un livre et non un recueil d’articles. Un travail rigoureux d’articulation a présidé à son architecture dessinant comme un parcours. Ce n’est pas pour rien qu’il ouvre sur « Labia », dédié à leonardo rosa, où il est questions de Delphes, de cet ombilic aux lèvres obscures d’où sourdent d’obliques paroles pour se terminer sur cette « Ode au sexe féminin », dédiée à Henri Maccheroni, autres lèvres, « nid des murmures / la raison du savoir / l’absence première ».
Cette Mer intérieure de Raphaël Monticelli fonctionne comme une chambre d’échos, une caisse de résonance. Résonance ? Ce qui importe en poésie, non ?
*Raphaël Monticelli, Mer intérieure, La passe du vent, Poésie, 10 euros
17:52 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raphaël monticelli, mer intérieure, la passe du vent
Lu 100 - Bernard Noël, La place de l'autre, Oeuvres III, P.0.L
Les plumes d’Eros – Tome I – c’était en 2010, où se rencontrent avec ce qu’il y a d’amoureux dans ce dieu de la fiction qu’est Eros quelques-unes des autres plumes de Bernard Noël. L’outrage aux mots – Tome II – c’était en 2011, comprenait ses principaux textes politiques, a-t-on dit, et avec raison mais peut-être ajouterais-je que toute son œuvre me semble relever du politique dans la mesure où Bernard Noël porte la langue, qu’il la renouvelle infiniment quand le pouvoir qui l’instrumentalise, la défigure, la fige et « se perpétue en la dégradant ».
Avec cette Place de l’autre – Tome III – C’est quelques 900 pages de textes divers que l’on pourrait faire tourner autour de 3 axes : celui de données autobiographiques souvent fortement teintées d’ironie, celui des entretiens – il y en a deux séries – et celui de ces mouvements qui portent l’écriture vers les autres, de Sade à Bataille en passant par Gilbert-Lecomte, Michaux comme vers de nombreux autres que l’on salue et à qui on rend l’hommage d’une parole amie. Et c’est peu de dire que la question de l’écriture, du vide, qu’œil du cyclone, elle porte en elle, hante ces pages : « il me faudrait dire pourquoi j’écris », s’exclame Bernard Noël, il le faudrait…oui, mais voilà ça n’est jamais ça et malgré ça, « de l’autre côté du désespoir », il décide d’écrire quand même. Il choisit de poursuivre pour éprouver l’étrange plaisir de la pensée.
Cette place de l’autre quelle est-elle ? Bien sûr, c’est celle du « tu », de l’autre à qui l’on s’adresse mais elle est aussi bien celle du « je », de ce « je » qui s’ouvre sous les coups du dehors, de cet autre que l’on devient à partir du moment où l’on est contre ce que le « tu », l’autre fait de moi. Pour Bernard Noël, la place de l’autre est toujours de l’autre côté, « en moi derrière moi ». Il est effraction. Il est celui qui vient à l’improviste. Depuis les arrières. Il est surprise, l’autre en moi dont je suis l’hôte, ma part d’ombre. Tout se joue dans notre dos, au revers de nous-mêmes. Quand l’autre vient au jour, c’est au prix de ma disparition. Quand ce bloc d’impensé survient, quand l’écriture en cours lui fait place, elle maintient l’énigme de ce qu’il en est de ce qui est venu. Elle garde vivant. C’est toujours l’autre qui nous saisit dans l’écriture comme dans la lecture. C’est lui qui appelle au dehors, qui rompt, qui éveille le vif. C’est lui qui dans les cendres de ce qui se tient devant, en face, voit depuis l’arrière les flammes anciennes. Entre le mort et le vivant, un éclat. Il éclaire la part inconnue de nous. La part vive, dans la langue rendue à son vivant désordre, où bat l’humain. De l’humain en formation.
Là est la bonne nouvelle de ce livre. Il dit à sa manière, cela que nous allons répétant : l’humain d’abord ! Et par humain, j’entends moins l’homme que cette chance d’homme qu’est tout homme quand il s’empare de ce pouvoir qui est le sien de se saisir comme mise en question de sa propre existence, d’apprendre à voir – « seul le regard sauve » disait Simone Weil – de s’alléger dans les questions, d’agrandir sa sensibilité, Tout cela que peut la poésie quand elle sait laisser à l’autre sa place !
17:48 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard noël, la place de l'autre, p.o.l
99- Francis combes, Si les symptômes persistent, consultez un poète
Poèmes politiques, ces poèmes de Francis Combes* ? Cela se dirait-il encore ? Quelqu’un oserait reprendre cette dénomination pour un ensemble de poèmes – plus de 140 ! - écrits à ras la rue, à ras « la chose vue dans la rue » comme autant de prises de vue, symptômes de toutes ces injustices, horreurs, bêtises qui rendraient le monde inhabitable si on y consentait ? Francis Combes n’y consent pas ! Faire parler ce qui est senti de ce monde est sa belle querelle, au risque de ce qu’y échappe. Car nommer n’est pas chose aisée. Il faut s’y prendre de biais tant notre monde est bien peu assuré de lui-même. Et de ses lendemains. Dire son mot sur les désastres du monde, Francis Combes qui l’a toujours osé donne avec ce nouveau livre tout son sens à cette dénomination de « poème politique », « en démontrant – sans le dire – affirme Bernard Noël dans sa préface, qu’il relève d’abord d’une pratique de la langue et non d’une profession de foi politique ». Ses poèmes se donnent à lire comme des fables . Qu’il soit clairs qu’ils ne se contentent pas d’illustrer je ne sais quelle moralité préalablement établie ! C’est à nous lecteurs de se confronter à leur corps pour en tirer troubles, leçons et actions !
Et puisque Francis Combes est le directeur du BIPVAL (Biennale Internationale des Poètes en Val-de-Marne, 8 promenée Venise Gosnat – 94200 Ivry-sur-Seine) j’ai plaisir la saluer la naissance de Zone sensible, revue de poésie dont les 3 objectifs sont : Mieux faire connaître la poésie contemporaine ; ouvrir un espace de rencontres et de réflexions et parce que la poésie se vit dans la cité, rendre compte de la création, de la diffusion et de la réception de la poésie. Son numéro de mars 2014 – N°1 - a pour thème : « poésie et engagement ».
*Francis Combes, Si les symptômes persistent, Consultez un poète, Poèmes politiques, Collection Le Merle Moqueur, Le temps des cerises, 14 euros
17:15 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : francis combes, le temps des cerises, si les symptômes persistent...




