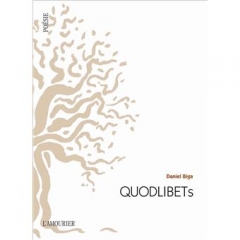22/01/2026
A propos de Daniel Biga
Aux deux notes que je viens de mettre en ligne, je renvoie les lecteurs à mon "Lu-114" de 2015 à propos de son livre Bienvenue à l'Athanée publié aux éditions de l'Amourier.
Je mettrai prochainement en ligne l'entretien que Daniel Biga m'avait accordé et qui fut publié dans la revue Friches en 2013.
14:58 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : daniel biga
LU 128- Daniel Biga, L'Amour d'Amirat, éditions Unes, 2025
Daniel Biga, retour à Amirat*
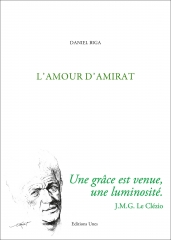 Pour commencer, je souhaiterais rappeler ce que j’écrivais ici même en mai 2018 dans le N° 240 du PCA qui consacrait à Daniel Biga un important dossier dirigé par Raphaël Monticelli : « Daniel Biga, c’est Nice. C’est un amour douloureux de Nice. Et même s’il en a souffert et souffre encore bien des colères par manque d’air, caractéristique essentielle de toutes les erreurs, les catastrophes, voulues ou pas, fruits des incompétences parfois et de l’avidité de quelques-uns toujours, il en aime toujours la beauté doublée de cette fragilité qui la rend si précieuse et si poignante. Il en aime toujours la langue qui erre, aujourd’hui, fantomatique sur les lèvres de quelques ombres. Qui toujours plus s’effacent. »
Pour commencer, je souhaiterais rappeler ce que j’écrivais ici même en mai 2018 dans le N° 240 du PCA qui consacrait à Daniel Biga un important dossier dirigé par Raphaël Monticelli : « Daniel Biga, c’est Nice. C’est un amour douloureux de Nice. Et même s’il en a souffert et souffre encore bien des colères par manque d’air, caractéristique essentielle de toutes les erreurs, les catastrophes, voulues ou pas, fruits des incompétences parfois et de l’avidité de quelques-uns toujours, il en aime toujours la beauté doublée de cette fragilité qui la rend si précieuse et si poignante. Il en aime toujours la langue qui erre, aujourd’hui, fantomatique sur les lèvres de quelques ombres. Qui toujours plus s’effacent. »
Voilà que L’Amour d’Amirat vient de paraître aux Editions Unes. C’est la troisième édition de ce titre. Les deux premières l’ont été au Cherche midi éditeur en 1984 puis en 2013. Celle-ci se présente avec bandeau portant la reproduction d’un portrait déjà ancien de Daniel Biga par son ami de toujours Ernest Pignon-Ernest accompagné d’un jugement de JMG Le Clezio : « Une grâce est venue, une luminosité », tiré d’un article que ce dernier fit paraître dans le journal Le Monde lors de sa première édition en 1984. Ce livre aujourd’hui s’ouvre sur un dessin inédit d’Ernest Pignon-Ernest qui place d’entrée de jeu celui-ci dans l’atmosphère d’un érotisme naturel, fait d’écart, de jeunesse et de fraîche lumière.
L’Amour d’Amirat relate une année passée - 1977-1978 - dans la solitude des hauteurs d’un arrière-pays niçois. Cette solitude into the wild au Barlet va être l’occasion de retrouvailles : d’abord ce corps qu’on oublie au sein des densités urbaines et qu’il s’agit de remettre au diapason des rythmes naturels et au travail physique : maçonneries diverses, débroussaillages difficiles ; ensuite celle de tous les vivants qui peuplent les entours : animaux comme végétaux et bien sûr parmi eux hommes aussi, rares et de ce fait uniques, hommes simples, à leur place sur ce bout de terre, avec qui toute parole prenait sens au point que Daniel Biga pourra écrire : « je devins l’enfant adoptif du domaine (…) oui, une vraie renaissance avec les autres » (extraits des entretiens avec Jean-Luc Pouliquen publiés dans Sur la page chaque jour, paru chez Z’éditions en 1990 dans la collection « Aux archipels de la mémoire », dirigée par Marcel Alocco).
Amirat, ce lieu montagnard fut une expérience : la traversée risquée du « naufragé volontaire », du fuyard contemplatif, du nomade immobile, de l’ermite qui s’émerveille et retrouve le grand dans le petit, l’infini dans le fini, le lointain dans le proche. D’où la présence dans l’Amour d’Amirat des poèmes zen tels que « Quelle surnaturelle merveille ! / Et quel miracle ! voici / je tire de l’eau et je porte du bois ». Ainsi L’Amour d’Amirat est-il fait de « paroles courtes, denses, simples, ordinaires et qui pourtant soulèvent l’évidence », fulgurances où se mêlent instants et souvenirs, proches souvent de l’aphorisme ou du haï-ku.
J’aime à lire ce livre comme un éloge de la fuite. Déguerpir : se jeter à l’écart, faire le pas de côté, quitter un monde qui se ferme toujours plus sur lui-même, sur ses conventions, ses menteries multiples, ses mots et images privés de sens, sa violente latente ou déclarée - guerres et morts à la clé -, cette asphyxie générale qui gagne. Fuir, devenir indien, pour se retrouver et « tenter d’être soi-même à plein temps ». Fuir afin de ne pas oublier, afin de tenir ouvert le chemin de la source, celui de l’eau, de la circulation et de la fluidité qui fait du monde une présence nue et pure, occasion d’une de ces extases matérielles qu’aimait DB chez son ami JMG Le Clezio.
Bientôt 50 ans, vous me direz. Est-ce bien raisonnable de s’intéresser à cette aventure singulière ? N’y-a-t-il pas là vaine nostalgie ? Oh ! que non !
Il est urgent de lire Daniel Biga, de lire ou relire cet Amour d’Amirat pour son amour de la saveur mortelle du monde, son goût de l’intériorité, son sens tout particulier de la recherche spirituelle à partie du plus physique, sa pratique singulièrement jouissive de l’écriture poétique qui ouvre le poème sur émotions et vie nouvelle.
Oui, Il faut lire Daniel Biga. Il faut le lire soit dans ce mouvement d'amitié qui fut le sien lorsqu'il rencontra et écouta pour la première fois, Julien C., berger d'Amirat, sur l'alpage, "immobilisé dans une sorte de charme" et qui vous porte "au plus proche, au plus lointain", vous pousse plus haut, vous élargit vers plus grand ; soit dans l'urgence, comme quand on a froid, que la nuit tombe et qu'il faut vite installer un campement même précaire dans quelques ruines de rencontre.
L’Amour d’Amirat est un refuge, mieux un ref(o)uge comme il l’écrira dans ce Carnet des refuges que publieront en les éditions l’Amourier, un de ces lieux de passage où les fous que nous sommes aussi pourraient refaire leur plein d'énergie avant d'affronter la route qu'éclaire la lumière indécise du matin. Car il y aura un matin, un demain de luttes où relever épaules et tête. Ce livre est un livre fraternel.
(Publié dans le Patriote Côte d'Azur du 16 janvier 2026)
14:54 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : daniel biga, éditioins unes
Lu 127- Daniel Biga, Quodlibets, 2018, éditions de l'Amourier
Daniel Biga, c’est Nice. C’est un amour douloureux de Nice. Et même s’il en a souffert et souffre encore bien des colères par manque d’air, caractéristique essentielle de toutes les erreurs, les catastrophes, voulues ou pas, fruits des incompétences parfois et de l’avidité de quelques-uns toujours, il en aime toujours la beauté doublée de cette fragilité qui la rend si précieuse et si poignante. Il en aime toujours la langue qui erre, aujourd’hui, fantomatique sur les lèvres de quelques ombres. Qui toujours plus s’effacent.
Daniel Biga, c’est une vie artistique exemplaire. Deux sources l’alimentent : les arts plastiques d’une part – on oublie souvent sa participation, au début du moins, à ce que l’on a fini par appeler l’école de Nice – et la poésie, la littérature d’autre part – je pense à sa participation dès 1962 à la revue Identités de Marcel Alocco, Jean-Pierre Charles, Régine Lauro… Là, la modernité se trouvait convoquée et interrogée. La pratique du cut-up – héritée des poètes de la beat generation – et du collage – héritée des surréalistes - a toujours correspondu pour lui à la rumeur de fond du monde, à la multiplicité des voix, au tohu-bohu des images. Dans son œuvre : tons, idées, accents, langues se mêlent, s’entremêlent pour favoriser l’émergence d’un drôle de millefeuille, produit d’une écriture épaisse, crémeuse et craquante à la fois, une écriture en volume au relief tourmenté, au souffle ravageur « entre zut et zen ».
Daniel Biga, c’est l’homme du mesclun. C’est là sa « nissardise » ou sa « nissardité », ce goût du mélange : érotisme et mystique, registre soutenu et registre familier, noblesse et trivialité, intérêt pour les Traditions et pour la modernité, pour les connaissances les plus diverses…ce goût de mettre ensemble ce qui a priori n’avait rien à faire ensemble.
Daniel Biga, c’est le poète de la PoéVie. On lui doit ce mot valise. Il l’a inventé pour signifier cette fusion, cette relation d’infusant-infusé entre la poésie et la vie/la vie et la poésie – cette force qui va de l’avant contre toutes les aliénations que notre monde secrète à l’envi. C’est cette force d’insoumission que Daniel Biga installe au cœur de la langue, c’est elle qu’il jazze. Dans son oeuvre, on a ce tissage-métissage de tons, de sons, de langue; ces ruptures de syntaxe, ces jeux de mots, ces collages-citations. C’est par là que la vie entre en force dans la langue. La vie, toujours première. La vie, ça va et ça vient, ça vient et ça va, « entre les deux se prépare pour les deux parties, le bienfaisant orgasme » dit Daniel Biga. La PoéVie, une puissance germinative, une « germinaction » contre tous les empêcheurs de jouir en rond, pour « se libérer de son cadavre ».
Il est urgent de lire Daniel Biga, pour son sens de l’ange. Cet archétype qui se retrouve dans toutes les Traditions, livres sacrés, mythologies. L’ange que l’on trouve du côté des ombres, des plantes, des reflets, des parfums, des eaux vives, des caresses : légèreté et imperceptibilité. Ange, « à l’écart du compromis religieux » aurait ajouté René Char, ce qui, à l’intérieur de l’homme, tient l’homme, résistant et debout.
Alors lisons son dernier livre publié. C’est dans le fonds poésie des éditions de l’Amourier. Son titre : QUODLIBETs signifie ce qui plaît. Et ce qui plaît à Daniel Biga, c’est ce saccage de langue, encore et toujours. Jamais, peut-être – en quoi il se montre toujours jeune ! – il n’avait mené cette lutte amoureuse dans la langue contre la langue elle-même aussi radicalement que dans ce livre. Il y brise les mots, joue des sonorités, heurte les significations, les démultiplie. Dans cette mise en flottement du texte qui se développe comme une écharpe trouée se déplierait sous rafales de vent plus ou moins violent, ainsi se crée la langue-Biga. Elle combat le cliché en jouant des clichés, en les parodiant, en les sapant. Elle construit en détruisant. Daniel Biga fait jouer les mots et se joue d’eux avec la jubilation de « l’enfant analphabète, ou le peuple », selon les mots de José Bergamin. C’est une « Docte ignorance » (Nicolas de Cuse) qui voit le poète avoir la nostalgie de l’enfance, de l’innocence, de cette « vie imaginative de la pensée » que José Bergamin appelait « analphabétisme » où l’esprit souffle et passe tel Hermès. Ce qui nous plaît, c’est de voir/entendre cette langue-Biga comme une langue trouée, hachée, désarticulée qui va s’étirant, sautant blanc sur blanc. Avec la mort qui rôde, le silence qui menace, c’est la vie qui va, qui gagne. QUODLIBETs ne parle pas du monde mais de ce monde dans lequel vit, aime, souffre, vieillit Daniel Biga et c’est alors le monde qui se lève. Comme Maïakovski, Daniel Biga écrit « selon des motifs personnels sur l’existence générale ».
Il est urgent de lire Daniel Biga !
(Publié dans le Patriote Côte d'Azur en mai 2018)
14:50 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : daniel biga, éditionns l'amourier
28/11/2025
Lu 124- Thierry Metz, Lettres à la Bien- aimée et autres poèmes, Poésie / Gallimard, juillet 2025, cat 3
Thierry Metz, son chemin dans l’inépuisable
 Il faut saluer – et je le fais avec enthousiasme – la parution dans la collection Poésie / Gallimard de ces Lettres à la Bien-aimée et autres poèmes de Thierry Metz même si je regrette que le prix Froissart de1989 Dolmen et L’homme qui penche de 1990 n’y figurent pas.
Il faut saluer – et je le fais avec enthousiasme – la parution dans la collection Poésie / Gallimard de ces Lettres à la Bien-aimée et autres poèmes de Thierry Metz même si je regrette que le prix Froissart de1989 Dolmen et L’homme qui penche de 1990 n’y figurent pas.
Les poèmes de Thierry Metz y sont encadrés d’une importante, précise et rigoureuse préface d’Isabelle Levesque qui s’attache à replacer chacune des œuvres dans son contexte de création et d’une postface d’Eric Vuillard dans laquelle il se montre sensible à l’écriture même de Thierry Metz qui se développe « dans le déchirement du langage et des choses, sur la feuille percée de mots ».
Thierry Metz était maçon, manœuvre - il faut lire le magnifique Journal d’un manœuvre paru chez Gallimard, collection L’Arpenteur, en 1990, qui connut un beau succès de librairie - Oui, il avait choisi d’être maçon parce qu’il y avait là le travail des mains certes mais aussi parce qu’on y apprend que « les murs du livre et de la maison sont percés d’ouverture » et que cela « permet d’y revenir ».
Mais il était déjà tard pour lui puisque, en mai 1988, la mort avait ravi son jeune fils Vincent par l’entremise d’une automobile qui faucha l’enfant en bordure de route.
Il est des voix dont on ne se remet pas de celles qui certains soirs nous rendent visite, celle de l’enfant qui « nous raconte ce qui se passe là-bas, comment sont les gens, ce qu’on y trouve…Ces voix nous ferment les yeux ». Et parfois « Non / Rien de cela / Qu’une inépuisable, inexorable absence / Rien qu’une mort.// Et un nom : Vincent. »
« Quelle absence que d’écrire », écrit Thierry Metz. Cette traque de l’absence dans « la langue / qui chemine dans l’inépuisable », cet affrontement à la question de savoir comment donner présence et voix de rouge-gorge à ce « quelque chose d’incertain / d’indicible / qui ne s’éteint jamais » dura neuf longues années coupées de publications et de deux séjours volontaires en hôpital psychiatrique avant de céder à la ramasseuse de sarments et d’en finir un 16 avril 1997, à 40 ans.
Neuf longues années pendant lesquelles il fut à la manœuvre. Je voudrais rappeler que ce mot renvoie à la manière dont les couleurs d’un tableau sont fondues et agencées. Ici dans les mots.
Mais attention pour Thierry Metz ces mots doivent être écriture sinon, ils ne sont pas parlant, selon lui. Et parlant, ils ne le sont jamais assez. Toujours, ils séparent, nous laissent dehors, au bord – et même si l’on retourne et retourne la langue – de ce qui serait à dire. Ainsi le poème est-il pour lui « un abri de mots / mais pas longtemps », note-t-il. L’absence revient. La poésie circule entre les mots qui portent le drame d’être au monde. C’est par là qu’elle nous touche. On y sent la vie respirer de souffle en souffle. A la Bien-aimée, il écrira : « J’ai vidé la page pour que tu puisses entrer ». C’est ce souci de l’autre qui émeut. Cette volonté d’une écriture qui va seule, avançant au travers d’une vie qui va se dépouillant. Sa parole n’est pas parole de « prince », parole pleine, remplie jusqu’au débord, « sourde de se suffire à elle-même » mais bien parole de « gueux », selon la belle distinction opérée par Christian Bobin, que trouent vide et silence. Assez pour laisser place à nous autres lecteurs, pour partager l’impartageable !
( Paru dans le Patriote Côte d'Azur, semaine du 20-26 novembre 2025)
19:14 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thierry metz, thierry renard
Lu 123 - Thierry Renard, Oeuvres poétiques Tome II, collection La Bibliothèque, La rumeur libre, 2018
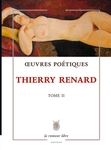 Il y a deux ans, en avril 2016, c’était le tome I des Œuvres poétiques de Thierry Renard, voici maintenant le deuxième. Plus d’un millier de pages, la reprise de 7 recueils dans le Tome I et 14 dans le Tome II plus un inédit qui clôt le volume. J’observe que cet inédit a pour titre Le fait noir/deux qui fait écho au Fait noir, préfacé par Patrick Laupin qui ouvrait le Tome I, comme si 25 ans après le poème avait toujours et encore à témoigner du « passage inexplicable de la vie», son épreuve, ses rencontres, ombres et éclairs mêlés.
Il y a deux ans, en avril 2016, c’était le tome I des Œuvres poétiques de Thierry Renard, voici maintenant le deuxième. Plus d’un millier de pages, la reprise de 7 recueils dans le Tome I et 14 dans le Tome II plus un inédit qui clôt le volume. J’observe que cet inédit a pour titre Le fait noir/deux qui fait écho au Fait noir, préfacé par Patrick Laupin qui ouvrait le Tome I, comme si 25 ans après le poème avait toujours et encore à témoigner du « passage inexplicable de la vie», son épreuve, ses rencontres, ombres et éclairs mêlés.
Deux tomes, c’est une somme ! Son ami Emmanuel Merle disait c’est une « cathédrale laïque » en pensant aux mots de Pierre-Albert Jourdan qui à propos d’un « amandier en fleurs tout bourdonnant d’abeilles » avait écrit : « c’est une cathédrale » ! Ce serait aussi comme un manteau de mots, un manteau de nuit troué de lucioles, traversé de quelques nocturnes « qui (traceraient) la chance d’un autre jour » selon les mots de Michel de Certeau.
La poésie est de l’ordre de ce combat, de cette guerre secrète – « combat spirituel aussi brutal que la bataille d’hommes » disait Arthur Rimbaud – pour garder ouvertes et battantes les portes de ce pays, ce « contre-sépulcre », même s’il n’est qu’un « vœu de l’esprit », cet inconnu devant soi qu’invoquait René Char sans lequel exister ne pourrait que s’effondrer dans les sables mouvants du libéralisme travaillés par l’argent-roi et le mépris des autres, proches ou lointains. Les poèmes de Thierry Renard, ces « éclats de réalité », disent l’urgence, tous sont écrits avec au bas des reins l’aigu d’une lame, celle du temps ; avec dans les poumons, comme une menace d’asphyxie et dans les yeux, le voile de quelques rêves non encore aboutis capables de tenir la bride au désespoir.
Ici, on écrit toujours au plus proche de ce que l’on ressent. Cela tient de la traversée, c’est une vraie expérience comme telle risquée car il ne s’agit pas seulement d’habiller de mots un vécu, il s’agit bien plus de l’interroger, de le mettre à la question, de le faire parler : « chaque poème est un raid dans l’inarticulé » dit Patrick Laupin des poèmes de Thierry Renard.. Ici, on écrit « pour lire et dire le monde », « aérer le présent », se tenir debout, - quelque soient les coups qui jamais ne manquent surtout quand, comme Thierry Renard, on s’expose. Faut-il rappeler l’animateur infatigable, « l’agitateur poétique » selon ses propres mots, qu’il est, toujours sur la brèche de quelques projets nouveaux – passer avec armes et bagages du côté où l’homme n’est rien que cette chance du jour qui vient.
19:08 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0)
08/10/2025
Présentation / Signature de Si le vent du nord... livre d'artiste Alain Freixe - Ernest Pignon-Ernest à la librairie Blaizot à Paris le 16 octobre 2025 à partir de 17h
16:21 Publié dans Du côté de mes interventions, Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernest pignon-ernest, éditions d'art fma
07/10/2025
Avec du ciel en plus, Esdée-Manie avec des collages de Gislaine Lejard, éditions Esdée
09:50 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0)
Lu 122- Pierre Reverdy / Pablo Picasso, Le chant des morts
 Le chant des morts, ce cycle de poèmes écrits entre 1944 et 1948, fut publiés en 1948 par l’entremise de l’éditeur Tériade qui le tira à 270 exemplaire dont 20 HC. Ce grand format – 42, 5 x 32, 5 comprend 124 lithographies de Pablo Picasso qui viennent jouer avec, sérigraphiée, l’écriture manuscrite impérieuse de Pierre Reverdy.
Le chant des morts, ce cycle de poèmes écrits entre 1944 et 1948, fut publiés en 1948 par l’entremise de l’éditeur Tériade qui le tira à 270 exemplaire dont 20 HC. Ce grand format – 42, 5 x 32, 5 comprend 124 lithographies de Pablo Picasso qui viennent jouer avec, sérigraphiée, l’écriture manuscrite impérieuse de Pierre Reverdy.
Certes, nous n’avons pas ces grandes double page, ce papier d’Arches, le vermillon original ; certes, l’édition qu’en fait la collection Poésie / Gallimard est réduite au tiers de l’édition originale. Et donc certes, on pourrait trouver à redire. Finalement, on aurait tort. Puisque nous avons là, un des « livres de dialogue », selon l’expression d’Yves Peyré, majeurs de l’après-guerre, mis à la disposition du plus grand nombre, un livre réunissant ces deux grands « transformateurs de puissances » que furent Reverdy et Picasso à un moment où la catastrophe historique de la seconde guerre mondiale avait atteint l’humanité entière, où « la mort (était) à tout bout de champ / sur les cicatrices toujours rouvertes des étoiles ».
Sur plus de 120 pages à la simplicité nue et impérieuse de l’écriture manuscrite de Reverdy répondent les « balafres sanglantes » écrit François Chapon, de Picasso. Ses lignes épaisses, croix et ronds répliquent, encadrent sans limiter comme autant de poteaux d’angle les vers de Reverdy. A la lumière déchirée des mots de Reverdy répondent les injonctions des traits de Picasso : traits, Saetas, ces flèches/chants tirées au noir, à la véhémence du Nada que Reverdy tient en respect. Reverdy met le feu à la langue, les mots dans ses poèmes sont en flammes, ce sont ces brandons que Picasso met en rythme, page après page, dans ce chant des morts qui du chant à ce côté d’antiphonaire, cette opposition de timbres, cet agôn entre signes plastiques et signes graphiques, image et texte. Entre le rouge du sang et le noir de l’encre, la poésie chante plus haut et plus loin, hors du livre, elle plane magistralement sur la vie. C’est sa ligne de vol qui nous sollicite, quelque chose de singulier, autre chose que l’on entend, une autre musique, un autre tempo. L’œil, suspendu entre noir et rouge, se fait oreille interne. C’est elle qui perçoit ce chant des morts. Là est s’inversent les signes. Alors on voit tout le négatif nous faire don d’une émotion qui ranime en nous cette « santé du malheur » dont parlait René Char, quelque chose que le mot « vitalité» pourrait désigner aussi. Redresser, redonner vie, réjouir, il est des livres qui le peuvent. Ce Chant des morts en est un.
09:44 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre reverdy, pablo picassi
Lu 121- Serge Pey, Mathématique générale de l'infini
 Perdona’m aquesta paraula en la nostra llengua : Hola Serge amic ! Oui, pardonnez-moi ce salut à Serge Pey dans « la langue des chiens », cette langue si longtemps réprimée et que l’on parle des deux côtés des Pyrénées, langue dont on emprisonne aujourd’hui ceux qui avec elle entendent démocratiquement instaurer une république catalane.
Perdona’m aquesta paraula en la nostra llengua : Hola Serge amic ! Oui, pardonnez-moi ce salut à Serge Pey dans « la langue des chiens », cette langue si longtemps réprimée et que l’on parle des deux côtés des Pyrénées, langue dont on emprisonne aujourd’hui ceux qui avec elle entendent démocratiquement instaurer une république catalane.
Cette « langue des chiens », je l’entends dans bien des titres de livres publiés chez ceux que l’on nomme « petits éditeurs » dont le travail admirable porte la poésie d’aujourd’hui dans toute sa diversité et que Serge Pey a réuni dans ce fort volume de la collection Poésie / Gallimard qu’André Velter dans sa préface présente comme un « exercice d’incantations martelées, une pratique du dévoilement, de la déchirure, de la blessure vocalisée qui accroît infiniment le champ du réel tout en le forçant à trembler sur ses bases », Mathématique générale de l’infini. Je l’entends aussi dans bien des noms croisés au hasard des poèmes dans ces quelques 37 titres comportant plus de 150 bâtons, figures même de la poésie-action de Serge Pey : sardane et ses flabiols i tambouris, Argelès, Sant Cebrià, Pedro Soler, Tautavel, Canigou, la Têt, la Santa Espina…
Mathématique générale de l’infini, ceux qui s’étonneront de ce titre, c’est qu’ils ne savent pas danser la sardane, qu’ils n’ont aucune idée des pas courts, des pas longs, de leur nombre, des pas glissés, pointés ou sautés : « deux fois nos pas courts / et deux fois nos pas longs / pour allonger l’infini / d’un pas plus grand que lui ». Le poète est un danseur. Un danseur mathématicien. Il compte avec ses pieds, tourne sur place, lève les bras au ciel, convoque et révoque l’infini, le rapproche et l’éloigne, l’accueille et le renvoie. « La sardane des chiens puisque tel est notre nom/ dans les camps / de l’autre côté », comme les poèmes de Serge Pey, sont des pièges à infini. Poète, il sait tordre la langue et l’arracher à tous les conformismes qui la menacent, l’avachissent et finissent par la pétrifier. Il sait l’espacer, l’étirer, la distendre, la douer de lointain, l’aérer et donner prise au silence, cette mise d’air, et c’est ouverte qu’elle résonne sans jamais se fermer sur elle-même. On peut entrer dans la ronde, le cercle de la sardane s’ouvre et se ferme alors comme on peut entrer dans le poème et que lire devient respirer du coeur. Fraternité de la danse, fraternité du poème.
Serge Pey est ce mathématicien qui dans son dialogue avec le peintre Jean Capdeville a appris de Simone Weil qu’il fallait « veiller au niveau où l’on met l’infini » et surtout ne pas le mettre où le fini convient seul. Cela se mesure, il y faut un œil qui ne se regarde pas dans un miroir mais qui traversant le miroir le brise et c’est dans ses tessons épars répandus sur la page que l’on fait image de soi. Comme l’âme, elle ne s’éveille que brisée.
« Donner des yeux au langage », comme le voulait Octavio Paz, la main le peut quand les pieds, leur martellement, est remuement du sens, appropriement du sol et de l’espace, ouverture de la bouche, cette « oreille qui voit » écrit Serge Pey, et qu’une autre langue naît dans la langue. Oui, c’est bien cela que l’on entend, une échappée de langue hors de la langue, une voix qui devient bâton pour assurer la marche du poème dans un monde devenu toujours plus dangereux où règnent la solitude des nantis comme des malheureux qui poussent leur pas sans bâton autre que celui qui, invisible, s’enfonce douloureusement dans leurs reins les jetant dans une en-avant éperdu, dans un monde où l’on détruit comme hier au Bourdigou, entre mer et étang, en Roussillon, aujourd’hui à Notre-Dame des Landes, ces lieux « où l’on pensait faire des choses en commun / pour qu’elles ne soient pas communes ».
On connaît l’aventure de Serge Pey enfant concernant la porte devenue table quand le père la dégonda pour accueillir et faire asseoir autour de cette nouvelle table ces amis inattendus poussés là par quelque nécessité. J’aime à croire que lui donner la volte vaille aussi. Alors c’est la table dont le plateau deviendrait porte si avec des amis on le verticalisait et le dressait ouverte sur les jours à venir et battante. Ce livre est table et porte, porte et table. Entrez / sortez, partagez repas et prenez ce chemin dont on sait bien qu’il se fera « al andar », pas après pas, comme le voulait Antonio Machado, grenade qu’on ouvre et que maintient ouverte un incessant éclair.
(publié dans la revue Europe)
09:40 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : serge pey
14/09/2025
Présentation / Signature de Si le vent du nord... livre d'artiste Alain Freixe - Ernest Pignon-Ernest à la librairie Blaizot à Paris le 16 octobre 2025 à partir de 17h
10:06 Publié dans Du côté de mes interventions, Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alain freixe, ernest pignon-ernest, librairie blaizot
Lu 119 -Ossip Mandelstam Œuvres poétiques, Œuvres en prose Le coffret, 1500 p, 59 euros
Ossip Mandelstam, poète rebelle, étranglé petit à petit par la censure stalinienne. Poète intransigeant, sans concession vis-à-vis des mensonges du pouvoir, de sa terreur grandissante au fur et à mesure que « le montagnard du Kremlin » et sa « racaille de chefs au son frêle » étouffaient la révolution. Le « siècle chien-loup » finira par avoir raison de celui qui se disait être l’ami de tout ce qui vivait sur terre. Sa vie prendra fin, après avoir été condamné à 5 ans de travaux forcés à Vladivostok, dans un camp de transit où il souffrit tous les froids.
Jean-Claude Schneider, traducteur, a « cheminé dans l’obscur », accompagné d’Anastasia de la Fortelle dont les notes et commentaires sont particulièrement éclairantes, pour donner « une voix française à Mandelstam », un « apocryphe de l’original » qui sait « respecter « le buissonnement des significations » en conservant à la parole l’ombre dont elle s’habille et qui la tient.
Il y a chez Mandelstam constamment réaffirmées une volonté de vivre au plus près des réalités du monde sensible et des forces qui le traversent – ce qui pourrait expliquer son émerveillement à la découverte des terres nouvelles de sa vie errante, notamment cette Arménie que pendant 8 mois en 1930 il parcourra – mais « les discordes enflammées des hommes » dans ce temps où « tout de par le monde est sans dessus dessous » font tomber sur les jours un hiver toujours plus féroce qui s’impose à lui et dont il ne pourra détacher les yeux, le vouant à « épier les pas du siècle, le bruit et la germination du temps » et donc à une solitude toujours plus grande : « seul je regarde le gel en face » notera)-t-il. Dès lors, écrire sera mener une guerre sans merci pour « soulever les paupières douloureuses du siècle ». Cette guerre, c’est « la volonté d’ouvrir les yeux, de voir en face ce qui arrive, ce qui est » écrira ailleurs Georges Bataille ; c’est ne pas se dérober, faire face à son temps, s’efforcer de voir ce que l’on nous invite à ne pas voir, ce qu’on nous interdit de voir ou ce qu’on nous cache. Dans ses poèmes comme dans ses proses, écrire est cette traversée risquée d’une parole capable d’affronter le présent pour que sous les masques de l’actuel on entende les remugles du temps, ses sourdes germinations.
Pour tenir tête à la violence de l’histoire, Mandelstam mobilisera cette autre violence, celle de la mémoire – « La mémoire, c’est la guerre » affirmera Walter Benjamin – il ira chercher dans hier, ses amis – ses vrais contemporains - Villon, Dante, Verlaine… - non pour pleurer les beaux jours anciens ni par vaine nostalgie régressive mais bien pour y creuser et amener au jour quelques graines survivantes – il faut lire l’admirable Entretien sur Dante ! – Chez Mandelstam, le rapport au passé est toujours de tension. Il s’agit de ramener dans l’aujourd’hui certaines questions restées là en dormance, certaines valeurs oubliées ou non encore advenues pleinement.
La poésie – poème comme prose ! C’est même là le mérite de ces 2 tomes de nous permettre de sentir combien c’est le rythme qui fait sous-sol et fait exister cette parole – se montre bien ici, d’une part, en diane, l’éveilleuse. Elle tonne et claironne ses réponses au siècle, appelle au sursaut, au réveil. Et, d’autre part, en Diane, la provocatrice qui enjoint Actéon à dire ce qu’il a vu – Diane se baignant nue avec ses suivantes – « s’il le peut » ! Comment ne pas se souvenir de ce « oui, je le peux » qu’Anna Akhmatova, l’amie de Mandelstam, répondit à la femme aux lèvres bleues devant la prison de Leningrad sous le terrible règne de Iéjov. C’est un tel « oui » que l’on entend chez Mandelstam et que mène jusqu’à nous ces deux volumes : « oui, je gis sous terre » mais « vous n’avez pas mis fin au remuement des lèvres ». Cela sonne comme s’épanouit un sourire par où passe toute l’humanité, cette exigence qui donne à la poésie la ferme conscience de sa légitimité.
10:05 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ossip mandelstam
01/09/2025
Exposition Eric Massholder à la Galerie Quadrige à Nice du 5 septembre au 4 octobre 2025
09:19 Publié dans Du côté de mes interventions, Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alain freixe, galerie quadrige