03/04/2017
In memoriam Jacques Kober
 « ô ange nu console à jamais ce traître à la mort que je suis » - Pierre-Jean Jouve
« ô ange nu console à jamais ce traître à la mort que je suis » - Pierre-Jean Jouve
Pierre Grouix disait de Jacques Kober qu’il était le « cadet des surréalistes ». Il l’était devenu en effet à partir du moment où Aimé Maeght lui confie la revue Pierre à feu et le lancement de la collection Derrière le miroir dans les années 44/45. Il lui sera donné alors d’être connu et reconnu par Breton, Eluard et tant d’autres porteurs de lumière, constructeurs de murs qui tremblent comme de travailler dans cette compagnie qu’il aimait : celle des peintres Matisse, Bonnard, Rezvani, Adami…
Jacques Kober incarnait cette poésie qui ne loge pas dans les rêves de quelque ailleurs factice, hors d’un Ici et Maintenant que nous avons à habiter. Il n’y avait pour lui que du connu et de l’inconnu, du Supérieur Inconnu dirait son fils Marc !
La poésie était pour lui l’expérience même de ce qu’il en est de vivre. Relisons son poème « L’existence du puits » :
Aimer juste ce qu’il faut pour faire bouillir la marmite
Ou bien ramener par l’anse de l’imagination
Un grand seau d’existence du puits nommé plongeon
Le matelot a embarqué le lundi 19 janvier 2015.
On peut imaginer sans y croire que son nouveau pays aura nom Jasmin *!
Alain Freixe
*A propos de ce Jasmin, tu es matelot, paru aux éditions Rafael de Surtis en Novembre 1998, j’avais écrit une note de lecture publiée dans un numéro de la revue de poésie Friches en coup de cœur à la mi-mars 1999. La voici telle quelle:
Pour moi, Jacques Kober, c’est un sourire. Quand je le croise à la faveur d’une conférence, d’une lecture ou d’un vernissage, c’est son sourire que je vois d’abord. Présence d’un visage, donc.
C’est ce sourire que je retrouve aujourd’hui porté par ses mots d’il y a 50 ans - C’était hier, ils ignorent les rides! C’était le temps de « la pierre à feu » ou encore de « Derrière le miroir » que Jacques Kober allait créer chez Adrien Maeght - ceux de Jasmin tu es matelot que les éditions Rafael De Surtis ont eu l’heureuse idée de reprendre. Les trois textes qu’il comporte sont ici augmentés d’une postface de Jacques Kober et présentés avec, en couverture, un dessin de Rezvani resté inédit à l’époque.
Il y a quelque chose d’irréductiblement jeune dans ces textes forgés au « frais de l’amour » et sous ce que les paysages méditerranéens aimés peuvent aussi abriter de sombre, cette part noire d’une mer réputée calme. Ici, le surréalisme est dans toute sa force ascendante. Jacques Kober donnent à ses mots « la force brisante » des images afin qu’ouverts, ils libèrent cela qui en eux cherche à aller plus loin que leurs toujours trop étroites déterminations, et qu’allégés, ils remontent vers un de ces « clairs de terre » - Personne n’a oublié ce titre d’André Breton! - où le ciel, dans « le bégaiement du tonnerre », pèse de toute sa foudre bleue où il lui arrive de trouver à s ’incarner.
Dans ce livre, on tutoie le rêve sous une lumière solaire telle que la mort qui passe dans l’angle obtus du ciel n’est là que pour entretenir la vie.
Vous manquez d’air?
Lisez ce livre de Jacques Kober. Il y souffle l’air salubre du large. Air qui donne corps à ce qui s’exténue dans les signes et se caille dans les mots. Le jasmin, ses effluves, sont les bordées d’un matelot qui dans sa prise de terre - « Ma fête, c’est la terre », écrit Jacques Kober - lance ses mots - Mots d’ « un langage de la passion à ciel de sable » - sur la portée du jour.
17:55 Publié dans Du côté de mes interventions, Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0)
Lu 117- Blanqui, l'enfermé de Gustave Geffroy, collection Bio, L'Amourier éditions
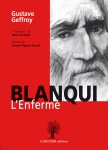 « Il ne faut pas essayer de faire des bonds, mais des pas humains, et marcher toujours. »
« Il ne faut pas essayer de faire des bonds, mais des pas humains, et marcher toujours. »
Auguste Blanqui
« Nous ne pouvons être rendus meilleurs sinon par l’influence sur nous de ce qui est meilleur que nous. »
Simone Weil
Touché ! Premier mot qui s’impose à moi à propos de cette lecture dans notre été 2015 entre le traitement que l’Europe inflige à la Grèce et la question des migrants, du tunnel sous la manche aux Méduses libyennes !
Je voudrais saluer ici Jean Princivalle, Bernadette Griot et Benjamin Taïeb d’avoir eu l’idée magnifiquement audacieuse d’oser pour fêter les 20 ans d’existence de leur maison d’édition L’Amourier de republier ce livre de Gustave Geffroy, Blanqui, L’Enfermé publié d’abord en 1897 puis en 1926 – et introuvable depuis des lustres si ce n’est sur publie-net le premier des 2 livres par les soins de François Bon – introduit par une juste préface de Bernard Noël et accompagné d’un dessin d’Ernest Pignon-Ernest. On la disait plutôt marquée comme maison éditant des écritures dont la poésie est le cœur de feu de la prose et donc habitantes des bords et des lisières, à l’écart, dans ce qui se chuchote entre les genres. Et on avait raison mais ne s’étonneront de ce choix que ceux qui ne comprennent pas que travailler la langue, pratiquer « une prose en action » selon les mots de Boris Pasternak, c’est inventer de l’humain en formation car la langue et l’homme, c’est tout un ! Or c’était bien là le projet de Gustave Geffroy et de son Blanqui, l’enfermé : retrouver l’homme, le montrer s’inventant lui-même, dans les prisons les unes plus abominables que les autres – et ce pendant quelque 37 ans ! – dans les rues, sur les barricades, armes à la main – chassepot ou plume selon les circonstances – et le voir devenir ce « martyr héroïque de la liberté humaine » selon les mots de Garibaldi.
Il y a dans l’écriture de Gustave Geffroy de nombreux passages dont le timbre, le rythme, libèrent une énergie qui nous emporte. Ce livre porte et transmet l’énergie d’une fraternité turbulente, riche de ses conflits. Il y a dans ce livre une voix d’encre qui à propos d’Auguste Blanqui, de sa vie, de ses combats pour ses idées, ses analyses des situations de 1830, 1848 et 1871, ses souffrances, ses malheurs, ses 37 années d’enfermement dans les pires conditions – et toujours la mer et ses brumes autour – ses espoirs trahis, montre et insiste sur le fait qu’il est possible d’aller vers son risque et que devenir ce que l’on est est naissance, épreuve après épreuve, à soi-même. Une vie d’homme peut ressembler à cela, c’est énorme et pourtant jamais écrasant ! Auguste Blanqui habita une douleur, « ce fruit immortel de la jeunesse » selon René Char. Jamais fait Blanqui – tant pis pour ceux qui tant de fois l’ont cru refait ! – toujours à naître ; jamais empêtré dans ses échecs – et ils furent nombreux ! – toujours à la proue, là où le navire fend l’eau des jours.
Le mont Saint-Michel, Belle-île-en-mer, le fort du Taureau, ces trois prisons aux terribles conditions d’existence ont scandé la vie d’Auguste Blanqui et la ronde des défaites (1830, 1848, 1871). Gustave Geffroy donne à voir au plus près « l’effort presque surhumain » par lequel « il s’est arraché au milieu ennemi » et comment « l’enfermé » « s’est évadé en lui-même » jusqu’à écrire ce livre rempli de science et de poésie, qu’aimera Nietzsche, L’Eternité par les astres, écrit au fort du Taureau. Il montre bien l’aspect tragique de cette existence prise dans la tension entre résignation et révolte, tension toujours vive qui le jettera toujours à l’avant de ses jours, exposé au présent, tendu contre la force trompeuse de l’évidence, du temps des horloges, cet espace avec sa neutralité mathématique, ce temps où s’enchaînent les causes et les effets irrémédiablement et qui serait soi-disant la voie du progrès, pour un temps qui dans son épaisseur garde mémoire d’hier mais non en historien – ces gardiens d’un passé mort – mais bien au présent comme ce sur quoi on peut encore disputer dans l’attente d’une conscience subversive qui serait interruption du cours du monde, venue au devant de la scène des opprimés de toujours.
Il y a cela de revigorant dans ce livre : voir comment Auguste Blanqui subvertit les subversifs, ceux qui toujours tournent les choses à l’envers au profit des pillards et des propriétaires de tout poil, ce sont ceux qui transforment les atrocités des vainqueurs – voyez la « semaine sanglante », voyez la colonisation… - en évolution normale et comme quasi-naturelle. Il y a une tyrannie du fait accompli quand plus rien ne reste en lui de ce qui en faisait un possible en devenir, pris dans une situation, travaillé par les forces et les contradictions inhérentes au contexte…Cela est passer au feu les faits, les brûler, les désarmer.
Le livre de Gustave Geffroy réveille Auguste Blanqui, le libère en l’arrachant aux historiens. Il le rend au politique comme stratégie du présent, laissant la voie libre aux possibles, aux bifurcations, à l’inouï de l’événement intempestif, inconditionnel, comète imprévisible dans le ciel des défaites.
Oui, « il y a des traditions de l’émancipation », Jacques Rancière a raison. Auguste Blanqui en incarne un versant à reparcourir. Le livre de Gustave Geffroy est comme une main donnée, une vigueur renouée, le coup d’épaule fraternel d’un exemple qu’il a su rendre vivant par son écriture, alerte et toujours fraîche. Oui, Il y a des mots à reprendre, à se réapproprier, le mot de « fraternité » par exemple, des mots dont il resterait à « libérer le ciel » selon l’expression du poète André du Bouchet. Certaines espérances y voyagent encore. Gardons les yeux levés, lisons !
17:19 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0)
30/11/2015
Lu 116- Raphaël Monticelli - Bribes - L’Amourier éditions, 26 euros
Outre la magistrale et émouvante biographie d’Auguste Blanqui, L’Enfermé de Gustave Geffroy, la reprise des sept livres augmenté d’un huitième, Dans la suite des jours de Michaël Glück, les éditions de l’Amourier publient un fort volume qui reprend les quatre livres de bribes parus – Intrusions illustré par Edmond Baudoin– 1998, Réversions illustré par Jean-Jacques Laurent -1999, Effractions illustré par François Goalec - 2003, Expansions illustré par Marc Monticelli - 2005 - sous le titre global de Bribes tirées de la mort de Dom Juan, présenté désormais comme une « première période », auxquels Raphaël Monticelli a ajouté un cinquième livre titré Déploiements qui ouvre une deuxième période intitulée Bribes issues du nid de l’aigle. Et c’est un vrai bonheur de lecture !
Après Expansions – et même si le mot déjà fait signe vers un plus grand développement – Déploiements accentue cette ouverture vers d’anciennes Bribes qui avaient été publiées en dehors des éditions de l’Amourier et vers des textes plutôt consacrés à des artistes, notamment à Max Charvolen avec qui Raphaël Monticelli et le photographe Alkis Aliotis s’en furent travailler à Delphes autour des restes du temple dit du « Trésor des Marseillais ». Cela dit on retrouve les thématiques, les personnages – Et disons-le, on aime à retrouver Josué, Ulysse, les Apaches… - les références telles que les AOI de La Chanson de Roland ! qui terminent certaines bribes - mais aussi les interrogations sur les genres. Cela dit on se montrera sensible à une plus grande unité dans le choix d’écriture et au souci de mieux marquer l’agencement des Bribes entre elles.
Comme l’Ulysse des Bribes, le narrateur de ces miettes narratives est un revenant. Il écrit à partie de la mort dans la vie des mots. Au-devant d’eux. Comme Josué, leur personnage central, qui dès les premières lignes « enclencha les mécanismes », le narrateur qui les compose est un compositeur aussi se lisent-elles « littéralement et dans tous les sens », comme le conseillait Arthur Rimbaud à sa mère à propos de ses vers, tant leur écriture est polyphonique et polysémique. Une vraie écriture de Jubilation.
Ces Bribes sont autant de textes qui naissent de ses heurts avec le monde, celui de tous les jours avec son cortège d’injustices et de violences, de malheurs mais aussi de surprises et de joies, celui des amis, des gens, des faits, des textes et des œuvres. Autant de chemins qui cartographient une véritable traversée de soi où il s’agit d’apprendre, comprendre et aimer tout ce qui entre en nous, que l’on porte moins qu’on ne s’y épaule : écrivains et leurs mots, leurs images ; peintres et leurs signes, leurs matières ; événements, rêves…
Ces Bribes sont aussi une tentative pour coller tous ces morceaux, ramasser toutes ces miettes, nouer tous ces fils épars. Et moins échafauder un sens que trouver une sortie, percer une issue. S’en sortir, sans sortir de cet enfer qu’est notre monde aux mains de ceux qui s’en croient les possédants !
Ce que Raphaël Monticelli appelle Bribes, d’autres le nommeraient fragments de récits, nouvelles, poèmes…et ce n’est pas là leur moindre originalité que de se faufiler ainsi entre les genres !
C’est que Raphaël Monticelli est poète ! Je sais que le plus souvent il a du mal à assumer cette dénomination. Pourtant, je l’ose en prenant de préciser que j’entendrais ici par poète, un facteur de langue et c’est alors lui qui est voie d’accès au monde réel, lieu du combat qu’il mène de bribe en bribe. A son rythme. Selon ses tons. Avec ses nuances.
Ainsi s’il y a des phrases, il y a surtout un phrasé. Phrasé qui se diversifie en fonction du rythme, des prises de souffle, des tons. Poétiser la prose pourrait être le beau souci de Raphaël Monticelli : travail sur les phrases mais aussi sur leur montage. On ne peut qu’être sensible à ce soin pris à ménager passages et passerelles, à agencer ces « restes » qui remontent de la vie, ces miettes.
Dans ces Bribes, la vie dépasse des mots qui la désignent, marque même de la présence d’un poète selon Odysseus Elytis. C’est-à-dire de quelqu’un dont la tâche est de travailler la langue comme on travaille la terre, comme on la retourne, la prépare, l’ensemence. Ici, on la charge d’intensités soit en chauffant à blanc ses éléments, soit en les dénudant jusqu’à l’os et cela pour que celle qui reste notre langue commune livre autre chose que le compte-rendu exact, objectif et tautologique de nos rencontres avec le monde, avec ce qu’il a de toujours autre : paysages, situations, visages, œuvres…bref avec l’épaisseur et la complexité, les infinies nuances du réel, de nos relations avec lui.
Ces Bribes sont le livre d’une vie. Non au sens testamentaire du mot mais par référence au « beau coût » qu’il représente, à cette expérience, à ce parcours toujours risqué que représente leur écriture qui se poursuit. Et se poursuivra, n’en doutons pas.
Qui a décidé un jour d’intervenir sait qu’il aura à recommencer sans cesse et que ce ne sera pas là morne répétition mais accueil à ce qui vient. Va venir. Cela dont nous ne saurions rien anticiper. Vraiment.
10:49 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raphaël monticelli
19/09/2015
Lu 115- Le Requiem et autres poèmes, Anna Akhmatova
 Avec ce livre Le Requiem & autres poèmes choisis dans lequel Henri Deluy nous donne un choix anthologique des poèmes d’Anna Akhmatova allant de «Le soir » (1912) à ce « Septième livre », qui regroupe des textes de 1936 à 1964, augmenté de « poèmes non repris en livres et poèmes retrouvés », il poursuit son action poétique de traducteur, de passeur d’une langue l’autre – notamment les poètes russes de ce XXème siècle. Juste avant celui-ci en 2014, c’était Voronej, chez le même éditeur, qui regroupe un choix de poèmes extraits des Cahiers de Voronej d’Ossip Mandelstam, écrits en 1935 en exil dans cette ville sur le Don jusqu’en 37 ; en 2013, c’était un choix de poèmes de Boris Pasternak, Quand s’approche l’orage publié par Le temps des cerises ; en 2011, on se souvient de L’amour, la poésie, la révolution, poèmes de Maïakovski avec des collages d’Alexandre Rodtchenko toujours au Temps des cerises ; dans cette remontée du temps, je m ‘arrêterai à L’offense lyrique et autres poèmes de Marina Tsétaïeva, paru chez Fourbis en 2004. Je noterai toutefois deux choses : d’abord qu’à chaque fois, Henri Deluy mêle à sa présentation une chronologie précise et précieuse, ; ensuite, qu’il n’hésite pas à joindre – c’est le cas pour Pasternak, Mandelstam, Akhmatova – les poèmes qu’ils écrivirent à Staline comme en son temps François Villon écrivit sa Ballade de l’appel !
Avec ce livre Le Requiem & autres poèmes choisis dans lequel Henri Deluy nous donne un choix anthologique des poèmes d’Anna Akhmatova allant de «Le soir » (1912) à ce « Septième livre », qui regroupe des textes de 1936 à 1964, augmenté de « poèmes non repris en livres et poèmes retrouvés », il poursuit son action poétique de traducteur, de passeur d’une langue l’autre – notamment les poètes russes de ce XXème siècle. Juste avant celui-ci en 2014, c’était Voronej, chez le même éditeur, qui regroupe un choix de poèmes extraits des Cahiers de Voronej d’Ossip Mandelstam, écrits en 1935 en exil dans cette ville sur le Don jusqu’en 37 ; en 2013, c’était un choix de poèmes de Boris Pasternak, Quand s’approche l’orage publié par Le temps des cerises ; en 2011, on se souvient de L’amour, la poésie, la révolution, poèmes de Maïakovski avec des collages d’Alexandre Rodtchenko toujours au Temps des cerises ; dans cette remontée du temps, je m ‘arrêterai à L’offense lyrique et autres poèmes de Marina Tsétaïeva, paru chez Fourbis en 2004. Je noterai toutefois deux choses : d’abord qu’à chaque fois, Henri Deluy mêle à sa présentation une chronologie précise et précieuse, ; ensuite, qu’il n’hésite pas à joindre – c’est le cas pour Pasternak, Mandelstam, Akhmatova – les poèmes qu’ils écrivirent à Staline comme en son temps François Villon écrivit sa Ballade de l’appel !
Anna Akhmatova ! Vous l’entendez ce nom ce nom de poète – elle s’appelait Anna Garenko – le poète Joseph Brodsky déclare à son propos : « les 5 A d’Anna Akhmatova eurent un effet hypnotique et placèrent la titulaire de ce nom en tête de l’alphabet de la poésie russe », c’est que son « engagement lyrique » fut tel qu’elle ne se sépara jamais malgré les épreuves, les calomnies, les persécutions qui rythmèrent sa vie ni de la poésie, ni de son peuple. De ce lyrisme toujours limpide, précis et retenu – « Il faut que dans le vers, écrivait-elle, chaque mot soit à la place, comme s’il y était déjà depuis mille ans, mais que le lecteur l’entende pour la première fois. » - ce livre en donne pleinement la mesure. Et comme Henri Deluy a eu raison de reprendre ce « Requiem » - « l’un des grands poèmes du XXème siècle » - de 1957, Anna Akhmatova y pose et affronte la question importante entre toutes : celle de l’irreprésentable de la douleur, de l’infigurable d’une situation, de l’impossible compte-rendu d’une réalité. Ainsi à la question qui ouvre le « Requiem », celle de « la femme aux lèvres bleuies » qui attendait devant le prison de Leningrad durant les terribles 17 mois du pouvoir de Iéjov en 1937-1938: « et ça vous pouvez le décrire ? », Anna Akhmatova ose l’impossible de cette réponse : « oui, je peux » pour la chance « d’un sourire sur ce qui autrefois avait été son visage ». Un sourire. De l’humain. Tel est le pouvoir de la poésie. Oui, dans son « Requiem » Anna Akhmatova arrive à nous montrer l’horreur de ces journées dans une image et même si c’est un pas-tout, si l’ampleur du noir ne sera jamais totalement éclaircie, les poèmes d’Anna Akhmatova allument des lampes sur ce moment du temps et sur nous-mêmes. Oui, René Char a raison : « certains jours, il ne faut pas craindre de nommer les choses impossibles à décrire ».
20:04 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anna akhmatova, le requiem
Lu 114- Daniel Biga, Bienvenu à l'Athanée, L'Amourier éditions
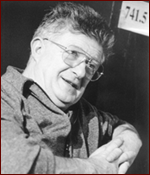 Daniel Biga, c’est Nice. C’est un amour douloureux de Nice. Et même s’il en a souffert et souffre encore bien des colères par manque d’air, caractéristique essentielle de toutes les erreurs, les catastrophes, voulues ou pas, fruits des incompétences parfois et de l’avidité de quelques-uns toujours, il en aime toujours la beauté doublée de cette fragilité qui la rend si précieuse et si poignante. Et la langue qui erre, aujourd’hui, fantomatique sur les lèvres de quelques ombres. Qui toujours plus s’effacent.
Daniel Biga, c’est Nice. C’est un amour douloureux de Nice. Et même s’il en a souffert et souffre encore bien des colères par manque d’air, caractéristique essentielle de toutes les erreurs, les catastrophes, voulues ou pas, fruits des incompétences parfois et de l’avidité de quelques-uns toujours, il en aime toujours la beauté doublée de cette fragilité qui la rend si précieuse et si poignante. Et la langue qui erre, aujourd’hui, fantomatique sur les lèvres de quelques ombres. Qui toujours plus s’effacent.
Daniel Biga, c’est une vie artistique exemplaire que deux sources alimentent : les arts plastiques d’une part – on oublie souvent sa participation, au début du moins, à ce que l’on a fini par appeler L’école de Nice – et la poésie, la littérature d’autre part – je pense à sa participation dès 1962 à la revue Identités de Marcel Alocco, Jean-Pierre Charles, Régine Lauro…Là, la modernité se trouvait convoquée et interrogée. La pratique du cut-up – héritée des poètes de la Beat Generation – et du collage a toujours correspondu pour lui à la rumeur de fond du monde, à la multiplicité des voix, au tohu-bohu des images. Dans son œuvre : tons, idées, accents, langues se mêlent, s’entremêlent pour favoriser l’émergence d’un drôle de millefeuilles, produit d’une écriture épaisse, crémeuse et craquante à la fois, une écriture en volume que l’on trouve d’une part dans ce fronton que lui consacre la revue Friches dans son n° de février 2013 ( ) comme dans ce Bienvenue à l’Athanée qui vient de paraître dans le Fonds poésie des éditions de l’Amourier (2012, 13 euros).
Outre ce titre à l’humour noir dévastateur, l’originalité de ce livre est qu’il est précédé de deux autres textes plus anciens et aujourd’hui épuisés : des extraits d’Histoire de l’air paru en 1984 et Sept anges paru en 1997. Or entre ces trois textes, aux écritures pourtant bien différentes comme s’il s’agissait des traces que laisserait la pointe d’un sismographe qu’on aurait placé en prise directe sur différents moments de ton existence, ça circule et ce qui circule, c’est une figure : celle de l’ange, cet étrange messager qui n’est pas que la pure figure d’ un pur esprit mais au contraire le compagnon quotidien, l’intermédiaire entre l’homme et le Tout Autre – le Rien ou le Tout, Daniel Biga s’en moque ! Pour lui, l’ange est du côté « des ombres, des fusains, des plantes, des miroitements, des eaux légères, des reflets, des parfums, des effleurements, des ondes, des caresses imperceptibles ». Il est moins le secret que ses abords multiples.
Il ya dans la poésie de Daniel Biga l’affirmation d’une forte présence au monde jusque dans ce qu’il a de plus âpre : la solitude, la perte, le déclin, la mort. Aimer le monde, c’est aussi arriver à pouvoir dire oui à l’inacceptable et pourtant totalement invitable, celui de toute mort.
A l’Athanée, on nous attend ! La Poévie de Daniel Biga – Il a inventé ce mot-valise pour signifier cette fusion, cette relation d’infusant/infusé entre la poésie et la vie/la vie et la poésie –force les passages, va de l’avant contre toutes les aliénations que notre monde secrète à l’envie. Cette force d’insoumission, Daniel Biga ll’installe au cœur de la langue, il la jazze. Dans Bienvenue à l’Athanée, on a ce tissage/métissage de tons, de sons, de langue (l’anglais y côtoie le Nissart !) ; ces ruptures de syntaxe, ces jeux de mots, ces collages/citations. Daniel Biga coupe, ravaude, crie, harmonise soudain, fait silence. Ça « mezcle » pour donner cours à une figure de la poésie.
Il est urgent de lire Daniel Biga pour son amour de la saveur mortelle du monde, son goût de l’intériorité, son sens tout particulier de la recherche spirituelle, sa pratique singulièrement jouissive de l’écriture poétique qui ouvre le poème sur émotions et vie nouvelle.
Bienvenue à l’Athanée, ce dernier saloon où l’on cause Poévie est aussi un salut aux vivants que nous sommes !
*
Signalons trois autres parutions : Séparation aux éditions GrosTextes, la revue Friches Le Gravier de Glandon, 87500 Saint-Yrieix) de février 2013 qui lui consacre un dossier et le Réédition au cherche Midi de l’Amour d’Amirat, Né nu, Killroy was here et Oiseaux mohicans.
19:18 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : daniel biga, l'amourier
Lu 113- Rienzi Crusz, L'amour là où les nuits sont vertes, L'Amourier éditions
Rienzi Crusz ? ça ne vous dit rien, n’est-ce pas ? Et pour cause. Le voilà édité pour la première fois en France traduit par Isabelle Metral de cet anglais que l’on parle au Canada et dont elle a su capter les vibrations jusqu’à les faire résonner dans notre langue. Rienzi Crusz est né à Galle à Ceylan (maintenant Sri Lanka)en 1925. Il s’est établi depuis 1965 au Canada où il réside actuellement.
Sa poésie sent la route – là où est l’âme disait Deleuze à la suite de Kerouac – l’errance, les changements de direction, les carrefours où l’on s’arrête le nez dans les parfums et les yeux loin devant dans les couleurs quand c’est « l’heure de la surprise », quand « le divin (prend) chair », « (fait) jouer les humeurs prodigues / des hommes, le pot-pourri du monde / en une neuve symphonie » et fait signe vers « le pays immigré / sans saison contraire », le « vert pays » !
Là où les nuits sont vertes , là est l’amour, cet amour dont Rimbaud qui avait rêvé des « nuits vertes aux neiges éblouies » disait qu’il « (était) à réinventer ».
Ah ! Le vert ! Il est bien la couleur dominante de ce recueil de Rienzi Crusz ! C’est que « le paradis des amours enfantines » était vert lui aussi déjà chez Baudelaire – vous vous souvenez de ces « violons vibrant derrière les collines ». Du côté de Ceylan, de l’enfance de Rienzi Crusz, il y eut de tels violons. Leurs vibrations passaient au vert ces fragments de paysage, ces recoins d’enfance, ces gestes qui reviennent dans les poèmes témoigner de cette traversée nocturne, de ce travail de terrassier et de carrier qu’est l’écriture poétique quand elle cherche à déboucher à l’air libre. Cet air dont nous avons tous besoin, vous le trouverez dans L’Amour là où les nuits sont vertes, il souffle entre les poèmes, entre les vers de Rienzi Crusz.
19:15 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : rienzi crusz, l'amourier
07/08/2015
Lu 111- André Velter / Ernest Pignon-Ernest, Le Tao du toreo, Actes Sud
 Les événements, ces secousses d’être, ont leurs voies. Ils nous créent parce qu’ils nous somment d’entrer en eux par le côté ensoleillé, celui où loin de chercher à les définir, ce qui est toujours les stériliser, les faner, les dissoudre, on les laisse nous définir, devenir le sang de nos vies.
Les événements, ces secousses d’être, ont leurs voies. Ils nous créent parce qu’ils nous somment d’entrer en eux par le côté ensoleillé, celui où loin de chercher à les définir, ce qui est toujours les stériliser, les faner, les dissoudre, on les laisse nous définir, devenir le sang de nos vies.
L’événement se produisit « par fort soleil et mystère avéré » un 16 septembre 2012 dans les arènes de Nîmes. Amoureuse des œuvres du temps, l’éternité s’était invitée sur le ruedo le temps d’un solo de José Tomas face à six toros. Diane était également présente et comme à Actéon qui vit ce qu’il ne devait pas voir – la déesse nue sans ses voiles comme ici où « jamais on n’a vu, ce qui s’appelle voir, / tant d’éclairs invisibles (…) » - elle lança son fameux « nunc sit poteris narrare licet ! », vas-y, raconte, si tu le peux, maintenant !
J’aime à croire que ce défi André Velter dut l’entendre. Le poète savait la chose impossible sinon à se transformer en chroniqueur taurin toujours quelque peu prisonnier dans sa prise de vue de son cadrage et voué aux chiens de la déesse, sinon à la tourner et à tenter de nous donner à entendre la résonance de cet instant furtif, de ce passage de vie : « non pas raconter, écrit André Velter, mais raviver cette commotion d’être qui prit possession de chacun, et de tous à la fois, pendant les deux heures et demie d’une corrida à nulle autre pareille. » Dans cette mise en écoute il est accompagné d’une part par la langue espagnole grâce à des traductions de Vivian Lofiego et c’est manière de convoquer Lorca et ses cinco de la tarde, Machado et son andar, Bergamin et sa musica callada et d’autre part, par les dessins d’Ernest Pignon-Ernest toujours ajustés à ces moments et aux gestes précis qui leur donnent espace. Mais ce serait trop peu dire, il faut insister sur l’intelligence de la mise en page génératrice de rythme et tout particulièrement dans le chapitre « Suertes », cet art d’enchaîner les figures.
Ce que nous donnent à entendre André Velter et Ernest Pignon-Ernest dans cette œuvre croisée dédiée à José Tomas, c’est cette musique de fin silence de son toreo sous les traits d’un art martial que le torero inventa ce jour là.
Un art qui au « combat se (conjugue) » où l’action est conforme à la nature des choses et des êtres conformément à une définition possible du Tao. A chaque toro son temple, cette qualité dans la manière de toréer qui dit les accordailles avec le toro.
Un art où le non-agir n’est ni passivité, ni repli, ni indolence mais un agir autre car « il agit, ô combien, sans agir plus que ça / pour détourner la charge / placer le leurre en vérité », qui ouvre sur une présence autre tant José Tomas, « ailleurs déjà, ailleurs encore », était là sur le mode du n’être pas là, « dans cette approche ralentie, menton au creux de l’épaule » afin « à l’heure du rendez-vous » de « régner par l’étrange pouvoir de l’absence, selon les mots de Victor Segalen.
Un art de l’effacement où le torero se dépouille de lui-même, se débarrasse de tout ce qui pourrait l’encombrer jusqu’au courage pour que ce vide qu’il fait et laisse être soit lieu d’hospitalité pour le toro. Cet art de l’accueil est un art de l’espace tant il s’agit de « décider des formules et du lieu », de tenir le sitio où à l’image de l’essieu, immobile, qui permet à la roue de tourner, « seul à danser avec son ennemi », il occupe le « centre » transformant l’arène en ruedo solaire, où il ne fait jamais nuit quand meurt le toro selon René Char. Un lieu de vérité car « placer le leurre en vérité » comme sut le faire José Tomas en ce jour de feria des vendanges n’est surtout pas leurrer le toro, le tromper, c’est juste le faire passer en exécutant vraiment la passe, la passe torera dont Ernest Pignon-Ernest sut capter l’insaisissable, c’est le « délurer » selon l’expression de José Bergamin. Ce jour-là, il n’y avait qu’une parole dans l’arène, celle de la passe. C’est elle qui parle au toro. Elle qu’il entend et à qui il réplique.
Et de passe en passe jusqu’à cette magnifique passe de poitrine dont la muleta aurait pu ne jamais retomber ou seulement longtemps après la disparition dans la nuit du toril du toro Ingrato qui fut grâcié ce jour-là, c’est un art de la composition in situ de mouvements accordés les uns aux autres, un art de l’enchaînement des passes qui me fait penser à cet art d’ « entrebezcar » les mots des troubadours, un art du secret et du silence.
J’aime voir le livre se terminer sur une leçon pour ce qu’il en est de nous dans un monde qui « roule sa norme et son ennui / avec le rejet par principe de tout ce qui subjugue / de tout ce qui exalte ». Avec ce Tao du Toreo se trouve réhabilité ce qui apparaît, ce qui est dit, cet aplomb qu’il y a à tenir, cette « parole qui engage », comme doit l’être ce qui est écrit « quand les mots ont présence d’os et d’âme », quand c’est le cœur qu’ils visent et atteignent « sous l’emprise de la vraie vie, / parce que la vie c’est pas assez » et que la poésie doit être « un feu de voix » voué à tous les vents du vivant, à ses énergies, ses vertiges, ses surgissements de printemps !
19:50 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré velter, ernest pignon-ernest, tao, toreo, actes sud
Lu 110- Alejandra Pizarnik, L’enfer musical - Cahier Jaune – Extraction de la pierre de folie - La comtesse sanglante – Les travaux et les nuits, Arbre de Diane, (traduits de l’espagnol par Jacques Ancet) Ypsilon.éditeur
Commencer par la fin, remonter le cours des livres d’Alejandra Pizarnik (1936- 1972), figure majeure de la poésie argentine des années 60/70, tel est le choix de Ypsilon éditeur qui s’est engagé dans la publication de l’œuvre complète de cette Dame de la nuit. A ce jour, six livres publiés, quelques dix autres titres à venir. A partir de cet enfer musical, descendre dans les livres, ce sera comme remonter à contre-pente dans les éboulis des proses, les pierriers des poèmes, ce sera dénuder toujours plus ce désir du « poème-terre promise » où l’âme, ce « nœud rythmique » dont parlait Mallarmé trouverait à renouer sa mélodie, ce sera voir son fouet zébrer la nuit d’éclairs et se fermer au noir de leur tonnerre.
Parmi ces livres, Jacques Ancet qui, outre les traductions, assure ici ou là quelques courts textes qui accompagnent avec discrétion mais donnant toujours sur de beaux éclairages, a raison de placer La comtesse sanglante, à une de ces bifurcations où Alejandra Pizarnik jouait toujours sa vie.
Il convient de prévenir le lecteur de La comtesse sanglante . Ce texte relève de cette prose que poursuivait Alejandra Pizarnik où la force qui devait soulever ses phrases visait à l’emporter loin du corset des genres. Pour cela, ce livre vaut et par lui-même et pour ce qu’il nous apprend des hantises qui traversent la poésie d’Alejandra Pizarnik, notamment celle de la nuit et de la mort. A quoi je rajouterai volontiers qu’il a cette qualité de présence qu’ont les écrits qui s’arrachent tout saignant de la vie et dont « chaque mot dit ce qu’il dit et plus encore et autre chose aussi ».
D’Alejandra Pizarnik, on ne saurait dire telle vie, telle œuvre comme on le dit souvent mais bien telle œuvre, telle mort. Alejandra Pizarnik rejoignit ses poèmes le 25 septembre 1972. Son sang la noya. A moins que ce ne soit le seconal qui le glaça.
Le sang ! Celui qui brille dans tant de nos expressions ! Sang de la vie et de la mort.
La comtesse Erzsébet Bathory ne pouvait que fasciner Alejandra Pizarnik.
La comtesse – ses « dents de loup » - et ses quelques 600 victimes. Toutes des jeunes filles. Toutes torturées. Toutes saignées. La comtesse et sa hantise de la mort. Du vieillir. La comtesse qui se baignait dans le sang des vierges pour rester jeune et belle. La comtesse et « la beauté convulsive » de son combat. De son affrontement à l’impossible : « nul jamais ne voulut à ce point ne pas vieillir, c’est-à-dire mourir. C’est pourquoi elle représentait et incarnait peut-être la mort ; Car, comment la mort pourrait-elle mourir ? ». La comtesse et son silence : « assise sur son trône » et qui « regarde torturer et écouter crier ». La comtesse et son miroir, habitante du pays froid des reflets. La comtesse et sa mélancolie.
Alejandra Pizarnik pouvait-elle ne pas s’identifier à la comtesse ? Entendons-nous. L’une tue pour se maintenir en vie, l’autre écrit pour la même raison – Vous vous souvenez de ces mots d’Henri Michaux : « Ecrire, écrire : tuer, quoi » - L’une croit dans les vertus régénératrices du sang humain, l’autre se fait un sang d’encre. Les deux occupent la place de la mort. Si elle est « la Dame qui ravage et dévaste tout comme et où elle veut » quand elle prend les traits de la « Dame des ruines », elle est celle qui « (dit) un mot sans jamais cesser » de ne pas le dire, celle qui interdit aux « mains de poupées » d’Alejandra Pizarnik de se mêler aux « touches » et d’entrer « dans le clavier pour entrer dans la musique et pour avoir une patrie ».
Alejandra Pizarnik restera donc parmi nous, sans-patrie. Noir sur blanc. Présente dans les pages qui accueilleront ses écrits, leur amour sans fin du silence et du « langage des corps ».
*Note parue dans le journal L'Humanité
19:29 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alejandra pizarnik, ypsilon éditeur
Lu 109-Jean-Marie Barnaud, Le don furtif, Cheyne éditeur, collection verte, 2014
J’ai toujours vu/connu Jean-Marie Barnaud fasciné par les poètes pour qui la poésie était chemin de l’homme dans le temps, humanisation du temps par la parole , recherche angoissée et souvent douloureuse de leur parole de vivant, la parole de la dernière chance. Car c’est toujours la dernière chance. Aujourd’hui comme hier. Demain aussi bien !
Un spectre hante la poésie de Jean-Marie Barnaud: la question de l’à quoi bon Je sais bien que les esprits forts ne croient pas aux fantômes mais la langue comme la science des membres absents le dit, ce sont des revenants !
Le nouveau livre de Jean-Marie Barnaud, Le don furtif, paru comme les précédents – dix sans compter les rééditions, chez Cheyne éditeur ! – en voilà un compagnonnage ! – ne déroge pas à ce retour : à quoi bon la poésie si elle n’a pas à voir avec « vivre », avec ce qu’il en est de vivre, ses contradictions, ses fatigues, cet épuisement qui parfois nous tient et nous serre encore plus peut-être alors que vient « le grand âge » et « ses jours friables » ? A quoi bon la poésie face aux « chiens de la force », quand l’Histoire bégaie, que les malheurs montent, que s’empourprent les dangers ? A quoi bon la poésie si elle n’est que jeu de langage, belles fleurs de serre stériles, simple jeu de l’intellect ? Que peut la poésie face à « la langue close / qui savoure ses outils » ?
De quoi souffre la poésie de ce temps, notre présent, si ce n’est de l’absence d’une image, de cette « grande image » dont Lao-Tseu pouvait dire qu’à partir d’elle on pouvait être du monde, le parcourir, en étant en accord – Ah ! ces jours où l’ « on se croirait encore / les élus d’un ciel » ! - , en harmonie avec les choses.
Il ya une profonde nostalgie chez qui « cherche encore / espérant que la chose se lève / de l’obscur / et qu’elle éclaire toute la scène » et donne sens par là au monde. Nostalgie qui fonde une mélancolie difficile à juguler. Mais elle a disparu la grande image et sa voix, « tout au fond ». Reste le ravin noir, le bord du précipice, le seuil du vide…Inquiétant pour sûr mais pas rien pour autant ce retour de l’ancien chaos ! Et si cette faille d’abîme était à accueillir ?
J’aime les mots qui terminent ce livre. Ces mots disent l’accueil : « Bonjour la terre qui vient / droit devant ». Cette terre vous l’entendrez comme vous voudrez, de celle des marins où reprendre pied à celle de la tombe où perdre pied, moi, j’y verrai bien cette « mère de toutes choses / et qui contient l’abîme » dont parlait Hölderlin souvent présent dans ce livre de Jean-Marie Barnaud. Et si ce qui soutenait était le vide, « la blancheur de l’inconnu : en avant de moi » aurait dit André du Bouchet ? Et s’il nous fallait cesser d’être dans cette douleur qui nous enserre sans nous déchirer entre constatation qu’il n’y a plus de « grande image » qui soutiendrait toutes les images - le monde avec ! – et le souhait qu’il y en ait une quand même, malgré tout, au fond ? La belle querelle de JMB, son drame – cette action sur lui du plus que lui-même – c’est de ne point arriver à décider : la voix de la « chose », celle du « disparu », de « celui qui avait fait briller l’éclat », n’est-elle qu’ »un rêve / un déguisement (…) une pantomine », oui ou non ?
Faudra-t-il toujours être de ces « voyageurs », de ces « obstinés » qui « (repartent) en chasse (…) blessure aux yeux » ? Et s’il suffisait de s’arrêter, de se tenir debout dans le petit matin, - cette lumière du petit jour Jean-Marie Barnaud la nomme « la discrète » ! – qui, tous les jours, à la dérobée – le furtif, cet instant, tient du vol ! – vient et revient ? C’est à pas légers qu’ « il porte le temps sur ses épaules » et s’en va « dénouer les ombres ». Et si c’était ce passage-là qui seul importait – « tous les matins / cette jeunesse passe / notre chance peut-être » - ce saut, ce bond. Pour rien que la brûlure d’un passage. Mobilité pure. Musique sous le silence. Les mots manquent, les mains manquent, et alors ? A Jean-Marie Barnaud, j’aimerais offrir ces mots de Nietszche : « L’instant infinitésimal est la réalité, la vérité supérieure, une image-éclair surgie de l’éternel fleuve ».
* Note publiée dans la Revue des Belles-Lettres
19:07 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-marie barnaud, cheyne éditeur
Lu 108- Entailles de Pierre Chappuis, éditions Corti
On savait que la poésie de Pierre Chappuis – Entailles est le quatorzième ouvrage qu’il publie chez José Corti. J’aime au seuil de cette note saluer cette belle fidélité ! - était une poésie dans laquelle le poème est expérience où la parole se risque vers ce qu’elle ignore de ce qui se tient devant et qui la tire toujours plus avant. C’est là une mise en rapport avec l’inconnu, avec ce qui disparaît dans son apparaître, avec l’instant quand il est ce qui coupe. Instant qui est également ce qui, comme l’aube, est déchirure qui renouvelle, déprise et reprise. Entailles fait la part belle à ces déchirements qui instaurent, qui créent de la continuité dans la discontinuité comme ces eaux qui après avoir surgi s’empierrent et disparaissent avant de ressurgir plus loin, plus bas, toujours plus vives. « Elasticité mienne » dit Pierre Chappuis dans la mesure où « D’instant en instant / - ponctuation mouvante et brève - / air, espace se recréent ».
L’éclat déchire, la bande de brume aussi quand ce n’est pas le froid qui « (étrangle) les vocalises » des « lueurs sur le lac ». Entaille, demeure de nuit. Au commencement était la déchirure, l’entaille instauratrice de distance, aveugle – on se souvient de ce titre fondateur de Pierre Chappuis Distance aveugle – dans la mesure où c’est ce que l’on ne voit pas dans ce que l’on voit qui importe.
Séparation, soustraction, entrée dans la perte. Aux lèvres de l’entaille lève le vide. Coupure appelle couture. Bâtir sur le trou, la perte, l’en-allée des couleurs. Il y a de la nuit dans les paysages de Pierre Chappuis. Non pas l’autre du jour mais la nuit d’avant jour et nuit, ce « noir de source », ce « soleil souterrain « dont parlait Joë Bousquet.
Pierre Chappuis s’attache à figurer le rapport qui nous lie aux choses et qui nous en sépare, telle cette « Montagne encore, scindée en deux / Blanc, brume / bandeau hérité de la nuit / telle, coupée la parole. »
C’est là affaire de poésie, affaire de rythme qui seul régénère et vivifie la langue: saisir en plein vol ce qui disparaît dans son apparaître. Alors la parole se génère et se déploie sur ses failles.
Pour Pierre Chappuis, le travail d’écriture est travail d’une force qui vient d’ailleurs, d’avant le poème et que le poème ne parviendra pas à limiter. Cette force prend ses formes dans le poème mais c’est en le traversant. Reste le passage d’une intensité. Comme entre flux et reflux, quelque chose passe. Coupure, alla assure le saut, bond et rebond, un rythme naît là. Le poème ici est tout à sa vague - « viendraient à moi (…) une vague, la suivante, et la suivante » note Pierre Chappuis – comme en auto-mouvement, il renaît en quelque sorte de ses failles, ces coupures, ces entailles dans le massif de la langue.
Entailler, c’est évider, donner place au vide, condition première du rythme. Le vide chez Pierre Chappuis est un mode de la présence, toujours en échappée, hors langage, les mots faisant tout au plus signe vers… Ce que l’on entend alors dans la poésie de Pierre Chappuis, écriture toute de concentration et d’abandon, c’est la petite musique d’un sens qui file vers son horizon impossible. Le sens ici n’est pas explicatif. Il ne nous sert pas à faire main basse sur les choses et le monde. Le sens vient déranger, troubler, ouvrir, sans fin, entaille après entaille. Il ne fixe rien, il est agent de transformation.
Transformation interminable qui fonde le fait qu’il n’y a aucune complaisance à soi dans la poésie de Pierre Chappuis, ici jamais la parole ne s’attarde auprès d’elle-même. Elle dit à chaque fois un rapport neuf. Coupe, et se relance toujours en avant de soi. Fille du vide, elle est dans le suspens du respirer. Or c’est cela que nous voulons : respirer, quand c’est l’asphyxie qui menace par trop d’homogénéité dans le temps !
* Note publiée dans la Revue des Belles-Lettres
19:05 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre chappuis, éditions corti
03/05/2015
Lu 107- La barque de Pierre, Poème pour un pêcheur de Sant Cebrià de Serge Pey, VOIXéditions
 Oui, ça commence toujours par les pieds. Les pieds font base. Ainsi les morts aident-ils à se tenir debout. A risquer l’écart, le déséquilibre, c’est alors la marche. La marche en avant. Celle que vient de mener à bien Serge Pey entre le 16 et le 31 mai 2014 est un appel aux vivants. Le facteur de langue est parti de Toulouse pour déposer au terme de 15 étapes dans la boites aux lettres qui garde vivante la tombe d’Antonio Machado à Collioure, les courriers qu’il a fait écrire depuis octobre 2013 à « Don Antonio, le bon ». Enterré là depuis le 22 février 1939, « le poète du peuple » avait quitté Madrid le 24 novembre 1936 contre son gré, pour rester aux côtés des républicains, ses compagnons de combat contre Franco et ses misérables. Dans la mémoire de tous ceux qui ont l’Espagne au cœur, sa langue et sa liberté, Antonio Machado pérégrine encore. L’exil n’a pas effacé les « chemins sur la mer » qu’il a su tracer et dont il disait que c’était là notre affaire d’homme. Ils écument encore de tous leurs sillages dans son œuvre comme dans celle de serge Pey.
Oui, ça commence toujours par les pieds. Les pieds font base. Ainsi les morts aident-ils à se tenir debout. A risquer l’écart, le déséquilibre, c’est alors la marche. La marche en avant. Celle que vient de mener à bien Serge Pey entre le 16 et le 31 mai 2014 est un appel aux vivants. Le facteur de langue est parti de Toulouse pour déposer au terme de 15 étapes dans la boites aux lettres qui garde vivante la tombe d’Antonio Machado à Collioure, les courriers qu’il a fait écrire depuis octobre 2013 à « Don Antonio, le bon ». Enterré là depuis le 22 février 1939, « le poète du peuple » avait quitté Madrid le 24 novembre 1936 contre son gré, pour rester aux côtés des républicains, ses compagnons de combat contre Franco et ses misérables. Dans la mémoire de tous ceux qui ont l’Espagne au cœur, sa langue et sa liberté, Antonio Machado pérégrine encore. L’exil n’a pas effacé les « chemins sur la mer » qu’il a su tracer et dont il disait que c’était là notre affaire d’homme. Ils écument encore de tous leurs sillages dans son œuvre comme dans celle de serge Pey.
Dans sa marche de la Mémoire, dont la Poésie est fille, il a pris avec lui quelques munitions – ce sont livres chez Montaigne ! Outre ceux de Machado, Lorca, Hernandez, il a pris les siens et parmi les derniers : Le trésor de la guerre d’Espagne (Zulma), Les poupées de Rivesaltes (Quiero), L’agenda rouge du MIR – Mouvement indompté du Rêve – (Al Dante) et La barque de Pierre, poème pour un pêcheur de Sant Cebrià (VOIXéditions) dont j’aimerais vous dire quelques mots.
Saint-Cyprien, quartier de Toulouse où vécut Serge Pey est aussi le nom d’un village de pêcheurs sur la côte catalane, près d’Argelès où vécut dans un camp de concentration une partie de sa famille lors de « la retirada ». Serge Pey, « résistant du sens de l’homme », est un « esgardeur ». Sa main qui écrit a deux yeux, le premier est ouvert sur le passé, son regard l’empoigne : misère et grandeur, honte et fierté, meurtres et tortures, abandons et trahisons. La mémoire nourrit la révolte et la hargne. Le second se porte sur le présent qui se dissout dans l’actuel quand « les marchands vendent tout / jusqu’au soleil / qui ne leur appartient pas » , quand « les bouchers de la lumière (…) débitent la mort » pour « les passants de l’été », décérébrés, sans mémoire qui « passent devant le Bel Ange / échoué au Barcarès / sans savoir son histoire ». Sans savoir qu’ici, les bulldozers ont détruit le Bourdigou aux maisons de sanils et de vent, où « l’on pensait faire / des choses en commun / pour qu’elles ne soient pas communes ».
L’écriture de Serge Pey est résurrectionnelle. Elle fait lever les morts et ses « généalogies » « tirent sur le sommeil / avec de vieux fusils ». Alors les filets de Pierre ramènent dans le présent les images d’hier. Dans les brisements qui suivent ces chocs, sur les arêtes des images de Serge Pey paraissent des éclairs d’une durée nouvelle et sous leur lumière un « nous » prend forme. Un « nous », issu de l’ombre, « dans le dos de la mer », s’annonce. C’est un « nous » en marche qui dit : « nous sommes la vieillesse / nous sommes la jeune mer / et aussi la mer qui vient / et celle qui jamais n’arrive ». C’est un « nous » à « gueule de chien » qui hurle « l’internationale des anges ». Ce « nous » qui revient « parce que nous ne sommes / jamais venus », c’est nous. Demain.
( article paru dans la revue Europe )
09:58 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : serge pey, voix éditions
Lu 106 - lmtv d'Emmanuel Laugier, NOUS, disparate
Pour un OVNI, ce ltmw, dernier livre d’Emmanuel Laugier, en est un ! Un acronyme, je veux dire, ce mot formé à l’aide des initiales d’autres mots. Et ici anglais ! - Il est vrai qu’on trouvera aussi de l’italien - letters to my wife !
Des lettres qui n’en sont pas vraiment, des poèmes - tous numérotés de I à LXXXI – comme autant de blasons à la manière de cette poésie galante du XVI, ces courts poèmes célébrant une partie du corps féminin – on se souvient du « beau tétin » de clément Marot ou du « front » de Maurice Scève - autant d’arrêts sur image d’un long plan séquence qui juxtaposés tiennent dans leur étreinte, bord à bord, l’inexprimable du sens de ce qui s’est passé entre celle nommée « émi », « my own mily one », ces senhals – mais oui, le trobar clus des troubadours n’est pas loin ! - de la « tua donna », poèmes d’amour, donc. Et l’amour aime le secret. Il aime à se cacher. Les poèmes sont cabanes dans le désert de la langue, abris fragiles pour celer, soit contenir et cacher comme le gant la main, l’amour. C’est en cela que le poète que cherche à être Emmanuel Laugier cèle son désir dans le corps de ce livre, dans ce ltmw.
Finalement banal dans leur propos – traduire cette traversée risquée qu’est l’expérience amoureuse - déconcertant dans leur forme et leur démarche, dira-t-on de ces poèmes que leur lecture est difficile ? Que s’y enchevêtrent bien des éléments hétérogènes ? Qu’elle charrie bien des nuages? Plutôt accepter cette obscurité apparente, ne pas vouloir/croire tout éclaircir, s’accomoder des ombres. Ne pas en faire un épouvantail. Il n’y a pas de vérité cachée, d’ordre mystique, hermétique, cabalistique. Pas d’allégorie, pas de clé qui permette de tout comprendre. Pas de fil interprétatif à tirer.
Le texte, de poème en poème, certes peut égarer le lecteur tant il sème à foison des traces – n’en relevons que quelques-unes des chanteuses de jazz comme Jeanne Lee ou Billie Holliday et sa chanson « my man », des groupes ou chanteur de rock alternatif comme Sonic Youth, PJ Harvey en passant par des paysages comme ceux de la route des claps sur les Hauts de Grasse ou ce « paysage de la route d’Uzès » de Nicolas de Stael, des références littéraires à Ossip Mandelstam et à son « verbe à cheval » ou encore à Maurice Blanchot et à sa « folie du jour », à Sandro Penna, Pier Paolo Pasolini… - mais il peut le conduire aussi bien, de lueurs en lueurs, d’obscurité levée en obscurité renouvelée à se trouver dans la situation de qui aime et tombe, perd ses marques en face de l’aimée. Peut-être n’est-il même pas écrit du tout ce texte, peut-être « n’est-il pas là pour être lu, comme l’écrivait Samuel Beckett à propos du Finnegans Wake de Joyce, ou plutôt (…) pas là seulement pour être lu. » Mais « regardé et écouté. »
On ne lit pas Emmanuel Laugier les yeux fermés mais bandés et les oreilles attentives. Ainsi appréhende-t-on une singularité, l’intensité d’une langue en acte, une écriture qui est du côté de la frape, qui cogne et casse ce qui dans la langue est du côté du signe, des représentations, des idées toutes faites associées trop vite et trop aisément .
Il y a dans l’écriture d’Emmanuel Laugier comme un dynamisme immobile, une alternance d’accélérations et de ralentis, de rythmes et de contre-rythmes, des arrêts, des suspensions…Il y a là une manière de tourner autour d’émi, de jouer avec ses courbes. Une ronde.
Couper/recouper/mailler moins les faits que leurs traces. Certaines expressions, certains vers font tourniquet, ils reviennent en ritournelle.
Ainsi voit-on l’écriture d’Emmanuel Laugier se jeter à côté et en avant. Accélérer la langue, la déplacer : mots retournés, agglutinés ; phrases dis-jointes, concassées ou allongées ; stolons qui enjambent les lignes. C’est dans ces avancées aux fréquents arrêts, aux silences d’arrière que la langue d’Emmanuel Laugier prend sous sa sauvegarde les traces des regards perdus à l’avant et du corps qui les porte.
Importe l’intensité d’une langue en acte et, pour nous, de ne pas réduire les individualités, les singularités… méfions-nous de nous-mêmes, de notre paresse qui vite file à l’oubli des textes eux-mêmes. ltmw exige de nous une posture. Il faut rouvir ses yeux comme on remonte ses épaules. Il faut se ressaisir pour le lire. Ressaisissons-nous !
( article paru dans la revue Europe )
09:53 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lmtv, emmanuel laugier, nous




