28/08/2025
LU 118 - Damages de Christian Viguié, éditions Rougerie, 2021
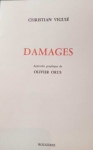 Pour « sanglant » que soit toujours « le dernier acte » selon les mots de Blaise Pascal, le peu de terre sur la tête, la crémation et ses cendres loin de fermer la question sur elle-même, l’ouvre au contraire. Quoi faire de la douleur ? Avec la douleur ? En faire l’aiguille qui va coudre les mots, un manteau de mots non pour recouvrir, pour suturer le trou ouvert par la mort mais pour entourer comme on le fait quand il fait froid et que l’on pose un manteau sur les épaules de ceux que l’on aime.
Pour « sanglant » que soit toujours « le dernier acte » selon les mots de Blaise Pascal, le peu de terre sur la tête, la crémation et ses cendres loin de fermer la question sur elle-même, l’ouvre au contraire. Quoi faire de la douleur ? Avec la douleur ? En faire l’aiguille qui va coudre les mots, un manteau de mots non pour recouvrir, pour suturer le trou ouvert par la mort mais pour entourer comme on le fait quand il fait froid et que l’on pose un manteau sur les épaules de ceux que l’on aime.
C’est avec cette tendresse que Christian Viguié sait déplacer la douleur vers ce « point d’équilibre entre ce qui a toujours été de l’ordre du prévisible et celui qui relève à tout jamais de l’inconcevable » comme il l’écrit dans son propos liminaire.
« La mort déclare chaque fois la fin du monde en totalité » a écrit Jacques Derrida. Comment ceux qui sont morts, les morts aimés, participent-ils à l’approche, au travers du langage et contre ses lois de langage, que tente ici Christian Viguié ? Qu’en est-il de cet adieu du fils ?
On le sait, parler est souvent peu de choses, c’est toujours très tôt que l’on ressent l’insuffisance du langage, son « infirmité native » disait Jean-Baptiste Pontalis, mais se taire serait éteindre le chant du monde , « faire mourir les choses / détacher tous les noms du monde / jusqu’à effacer la couleur d’un papillon / qui se pose sur un brin d’herbe / et sur les mots », se taire serait ne pas prendre soin du trou creusé par la mort pour le garder vivant, chose parmi les choses du monde
Ainsi Damages est-il un « chant de deuil, un presque murmure, la ligne brisée d’un horizon ». Ceux que l’on aimait et qui nous aimaient sont morts, père et mère notamment. A la minute de silence, Christian Viguié préfère celle du poème. Deux poèmes : le premier dédié à son père ; le second à sa mère, la reproduction d’un dessin de l’ami Olivier Orus faisant charnière, coupure et lien. Deux poèmes mais un chant qui « relierait / le sommeil et le silence des choses » et qui porterait leur mort avec cet amour qui ne retient pas ceux qui sont partis mais qui les accompagnent avec cette délicatesse qui nous voit « (attacher) un soleil / à une patte d’oiseau ».
Ceux qui sont morts sont passés de l’autre côté non dans un ailleurs mais bien ici, de l’autre côté d’ici, dans « le monde du dehors » écrit Christian Viguié. Cette mort du père comme de la mère est invite à « ouvrir une nuit dans la nuit », une parole dans la parole pour parler de leur mort « aux ruisseaux / qui vont suivre leur cours / au vent quand il s’affole dans l’herbe / à cette pierre que je tiens dans la main » parce que c’est de ce côté-là que sont passés ceux qui sont morts.
Christian Viguié sait ne pas ajouter de la mort à la mort. Il sait porter la mort de ceux qui « ont emmené avec eux le plancher et le plafond d’une incroyable maison, lieu où nous avions appris à marcher, à rêver, à combattre la fatalité du monde ». Il les sait là dans « la matérialité des choses » qui fait paysage. Cela suppose une inversion du regard, « une autre façon de regarder / apprendre l’absence et le rien / qui commencent à naître / à l’intérieur de chaque chose ». Dès lors c’est comme enfanter les morts aimés, les « (désolidariser) du brouillard et de l’ombre » et les « (confier) au nuage / qui se défait pour être nuage / et mémoire de nuage » ou « à la patience d’une pierre » ou encore « à ce filet d’eau qui coule de la montagne » bref au monde. C’est les marier avec « la matérialité des choses ».
Deux poèmes, un chant, disions-nous, un chant qui parle de la mort d’un père et d’une mère qui « relierait / le sommeil et le silence des choses », qui « annulerait la sentence lente / de naître ou de mourir ».
Un chant à écouter comme on se surprend à écouter « celui d’un merle / ou d’un rouge-gorge » ou encore celui plus ténu d’« un froissé de coquelicot ». La poésie de Christian Viguié est rouge-gorge. Elle porte « son chant / et son silence » ensemble comme « un immense soleil rouge ».
On pose le livre. On écoute. Le monde est sauf.
(Note parue dans la revue Europe)
19:15 Publié dans Du côté de mes interventions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian viguié, europe
03/05/2015
In Memoriam Charles Dobzynski (1929 - 2014)-III
Notre ami Michel Ménaché nous avait envoyé cette note parue depuis dans la revue Europe que Charles Dobzynski avait écrite à l'occasion de la parution du livre de Michel Ménaché et Josette Vial : Istanbul –Kilim des sept collines paru à La Passe du vent en 2014.
Que la reprendre ici soit notre manière de rendre un nouvel hommage à l'immense passeur de poèmes que fut Charles Dobzynski.
"C’est un album à trois têtes, ou plutôt à trois cœurs : photographie, poésie, correspondance, dans un élégant format à l’italienne qui s’accorde à son sous titre : Kilim des sept collines. Le Kilim est un tapis d’Orient qui inclurait ici, dans son dessin, les sept fameuses collines de la mégapole Istanbul, chevauchant par le Bosphore à la fois l’Europe et l’Asie. Cette ville fabuleuse - misère et merveille souvent juxtaposées - le poète Michel Ménaché en compagnie de la photographe Josette Vial, en parcourt non seulement les apparences, prises dans leur actualité en saisissants instantanés, mais les strates de mémoire. Celles-ci se trouvent entrecroisées en réseaux d’émotions, de remémorations, de reconstitutions mentales infusées d’une nouvelle vie. Ce n’est pas le journal de bord ou le bloc-notes de voyageurs curieux, de touristes avides de pittoresque, de témoins circonstanciels, mais un roman qui s’invente sous nos yeux en réseaux multiples de langages : celui de l’image illustrante et illuminante, celui de la poésie en vers ou en prose, tantôt dans des séquences brèves et intenses, tantôt dans l’alternance des missives adressées par son grand-père Marcos, juif sépharade et stambouliote, à son petit-fils supposé être alors âgé de deux ans. C’est le petit-fils qui reconstruit et nous restitue, à partir d’ échos d’un vécu sans doute familialement transmis, l’expérience singulière d’un homme heureux dans son cadre natal, mais très tôt victime d’une condition trop précaire, de suspicions et de persécutions, conduit à contrecœur à émigrer jusqu’en ce carrefour de l’Argentine, Buenos Aires, alors refuge privilégié de cohortes d’Européens démunis et parmi eux beaucoup de juifs plus ou moins hispanophones, en quête d’une terre d’asile où règne enfin la tolérance et la possibilité de vivre et de travailler dans la dignité.
La vie de cet homme est un puzzle que Ménaché s’emploie à rendre déchiffrable, sensible, attachant, à commencer par cette histoire d’amour et de mariage suspendu, reporté de deux ans par les exigences d’une époque où la pauvreté accablante est le ressort de l’émigration. Le roman de son grand-père Marcos, l’imagination de Ménaché, constamment gouvernée par le souci de la vérité des faits, des détails, et la tendresse générique qui l’irradie, nous le restitue miraculeusement de lettre en lettre. Cette correspondance-fiction semble transiter dans l’espace avec les ailes des oiseaux migrateurs. Mais c’est surtout l’histoire qu’elle traverse et transcrit molécule par molécule, mot par mot. L’histoire légendaire de Constantinople, devenue Istanbul, l’évocation de son quotidien, de son ancienne communauté juive dont le judéo-espagnol, depuis l’expulsion d’Espagne en 1492, demeure la langue d’expression, l’histoire de l’arrivée et de la prise de pouvoir des Jeunes-Turcs, puis de Mustapha Kemal qui tentent de tirer du marasme et de l’effondrement de l’empire ottoman, après la première guerre mondiale, « l’homme malade de l’Europe». Marcos a suivi les cours en français de l’Alliance israélite. C’est un homme d’intelligence, de culture, d’irréductible passion pour la vie, qui rejette des « superstitions ridicules et des préjugés pernicieux » et pour qui la France est un phare : « L’exposition universelle de 1900 n’en finissait pas de nous enthousiasmer. A cette même époque, un officier juif injustement condamné bouleversait nos quartiers. J’accuse d’Emile Zola avait fait l’effet d’une bombe sur les deux rives de la Corne d’or…» Histoire tumultueuse et complexe où se conjuguent les antagonismes des Grecs, des Arméniens, des Musulmans. Et des juifs assignés au recommencement de leur diaspora…
Le Kilim biographique du poète est tissé des commentaires et des pérégrinations incessantes de son Grand Père, d’Istanbul à Buenos Aires et Barcelone, puis en France où il connaîtra, à l’heure de l’occupation nazie, de nouvelles et dramatiques tribulations. Lettres admirables de justesse et de véracité dans leur réalisme. Mais il importe de souligner qu’elles participent d’une subtile orchestration, constamment ponctuée par les photographies qui piègent pour nous des moments, des sites surprenants (tel ce fronton rescapé d’une synagogue incrusté de caractères hébraïques) des visages, des personnages furtifs mais réels. Ponctuée d’autre part comme d’une mélodie qui remonterait du fond des temps et des êtres, par les vers limpides de Ménaché, fils conducteurs – petits-fils conducteurs aussi – de ce livre. Par exemple lorsqu’ils servent de filigranes à l’image de la synagogue retrouvée :
La langue hébraïque
Survit dans un théâtre d’ombres
Tant de livres ont brûlé
Tant de cris se sont perdus
dans les cendres.
La pierre se souvient
elle signe
le passage d’une main amie
au bord d’une pierre tombale.
Oui, il est vrai que tant, que trop de cris se sont perdus. Mais la voix du grand père Marcos persiste et signe, gravée dans l’écriture lumineuse d’un héritier qui possède l’art et le don d’un diamantaire de la mémoire."
Charles Dobzynski
09:26 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charles dobzynski, ménac hé, europe




