28/08/2025
LU 118 - Damages de Christian Viguié, éditions Rougerie, 2021
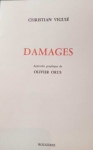 Pour « sanglant » que soit toujours « le dernier acte » selon les mots de Blaise Pascal, le peu de terre sur la tête, la crémation et ses cendres loin de fermer la question sur elle-même, l’ouvre au contraire. Quoi faire de la douleur ? Avec la douleur ? En faire l’aiguille qui va coudre les mots, un manteau de mots non pour recouvrir, pour suturer le trou ouvert par la mort mais pour entourer comme on le fait quand il fait froid et que l’on pose un manteau sur les épaules de ceux que l’on aime.
Pour « sanglant » que soit toujours « le dernier acte » selon les mots de Blaise Pascal, le peu de terre sur la tête, la crémation et ses cendres loin de fermer la question sur elle-même, l’ouvre au contraire. Quoi faire de la douleur ? Avec la douleur ? En faire l’aiguille qui va coudre les mots, un manteau de mots non pour recouvrir, pour suturer le trou ouvert par la mort mais pour entourer comme on le fait quand il fait froid et que l’on pose un manteau sur les épaules de ceux que l’on aime.
C’est avec cette tendresse que Christian Viguié sait déplacer la douleur vers ce « point d’équilibre entre ce qui a toujours été de l’ordre du prévisible et celui qui relève à tout jamais de l’inconcevable » comme il l’écrit dans son propos liminaire.
« La mort déclare chaque fois la fin du monde en totalité » a écrit Jacques Derrida. Comment ceux qui sont morts, les morts aimés, participent-ils à l’approche, au travers du langage et contre ses lois de langage, que tente ici Christian Viguié ? Qu’en est-il de cet adieu du fils ?
On le sait, parler est souvent peu de choses, c’est toujours très tôt que l’on ressent l’insuffisance du langage, son « infirmité native » disait Jean-Baptiste Pontalis, mais se taire serait éteindre le chant du monde , « faire mourir les choses / détacher tous les noms du monde / jusqu’à effacer la couleur d’un papillon / qui se pose sur un brin d’herbe / et sur les mots », se taire serait ne pas prendre soin du trou creusé par la mort pour le garder vivant, chose parmi les choses du monde
Ainsi Damages est-il un « chant de deuil, un presque murmure, la ligne brisée d’un horizon ». Ceux que l’on aimait et qui nous aimaient sont morts, père et mère notamment. A la minute de silence, Christian Viguié préfère celle du poème. Deux poèmes : le premier dédié à son père ; le second à sa mère, la reproduction d’un dessin de l’ami Olivier Orus faisant charnière, coupure et lien. Deux poèmes mais un chant qui « relierait / le sommeil et le silence des choses » et qui porterait leur mort avec cet amour qui ne retient pas ceux qui sont partis mais qui les accompagnent avec cette délicatesse qui nous voit « (attacher) un soleil / à une patte d’oiseau ».
Ceux qui sont morts sont passés de l’autre côté non dans un ailleurs mais bien ici, de l’autre côté d’ici, dans « le monde du dehors » écrit Christian Viguié. Cette mort du père comme de la mère est invite à « ouvrir une nuit dans la nuit », une parole dans la parole pour parler de leur mort « aux ruisseaux / qui vont suivre leur cours / au vent quand il s’affole dans l’herbe / à cette pierre que je tiens dans la main » parce que c’est de ce côté-là que sont passés ceux qui sont morts.
Christian Viguié sait ne pas ajouter de la mort à la mort. Il sait porter la mort de ceux qui « ont emmené avec eux le plancher et le plafond d’une incroyable maison, lieu où nous avions appris à marcher, à rêver, à combattre la fatalité du monde ». Il les sait là dans « la matérialité des choses » qui fait paysage. Cela suppose une inversion du regard, « une autre façon de regarder / apprendre l’absence et le rien / qui commencent à naître / à l’intérieur de chaque chose ». Dès lors c’est comme enfanter les morts aimés, les « (désolidariser) du brouillard et de l’ombre » et les « (confier) au nuage / qui se défait pour être nuage / et mémoire de nuage » ou « à la patience d’une pierre » ou encore « à ce filet d’eau qui coule de la montagne » bref au monde. C’est les marier avec « la matérialité des choses ».
Deux poèmes, un chant, disions-nous, un chant qui parle de la mort d’un père et d’une mère qui « relierait / le sommeil et le silence des choses », qui « annulerait la sentence lente / de naître ou de mourir ».
Un chant à écouter comme on se surprend à écouter « celui d’un merle / ou d’un rouge-gorge » ou encore celui plus ténu d’« un froissé de coquelicot ». La poésie de Christian Viguié est rouge-gorge. Elle porte « son chant / et son silence » ensemble comme « un immense soleil rouge ».
On pose le livre. On écoute. Le monde est sauf.
(Note parue dans la revue Europe)
19:15 Publié dans Du côté de mes interventions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian viguié, europe
Lu 119 - Christian Viguié - Comme une lune noire sur ma table, éditions La table ronde, 2024
 On entre dans ce livre par son titre, comme de juste, et c’est une comparaison qui s’offre à nous Comme une lune noire sur ma table. Immédiatement, c’est une absence qui nous arrête, celle du comparé : on ne peut pas ne pas se demander ce qui pourrait ressembler à une lune noire sur (sa) table ! On se dit que quelque chose a été perdu. Très vite on s’aperçoit que lire, c’est ouvrir un chemin de lecture et ainsi, chemin faisant, nous saurons - le mystère se tient ailleurs chez Christian Viguié - que c’est l’ombre, bien plus grande que celle d’un arbre ou d’une montagne, l’ombre « de (son) bol (…) sur la table » qui est « comme une lune noire ». C’est ce plus proche, cette ombre de peu que la banalité quotidienne grandit et illumine. C’est bien le banal qui intéresse Christian Viguié - le mot est récurrent dans ce livre - il affirme clairement que son objectif est de « préserver / l’extraordinaire banalité du monde », sachant que « la banalité est l’écriture la plus claire du réel ». Je vois cette « impitoyable banalité » comme une Dame, celle du Camion de Marguerite Duras. Dans son livre, Marguerite Duras, La noblesse de la banalité, de l’incidence éditeur, Mireille Calle-Gruber s’attache à la mettre en lumière sa « noblesse » : « Elle est cette noblesse de la banalité. Elle est invisible ». Elle est dans les choses, parmi les choses du monde leur intelligence. Elle est en intelligence avec tous ses entours. Comment faire voir cet invisible, là à même le vivant ; Non pas derrière, au-delà, caché en quelque arrière-monde - « Il n’y a pas besoin de métaphysique / pour voir ce que je vois / il suffit d’ouvrir une fenêtre / de regarder le pommier au milieu du pré » - mais là, banalement là dans « le mystère du jour ». Telle est la « noblesse de la banalité », un regard qui ne conquiert pas, qui se laisse dessaisir de son saisissement et passe derrière les mots qui font écran. Ainsi Christian Viguié ose-t-il écrire que les mots qui sauvent sont les mots qui manquent ! Mais, et c’est merveille, une nouvelle phrase arrive plutôt que rien, un pas de plus se propose et c’est la marche, ce bégaiement des enjambées poudreuses qui nous mène là où on ne sait pas devoir aller, si ce n’est dehors, là où sont les choses du monde.
On entre dans ce livre par son titre, comme de juste, et c’est une comparaison qui s’offre à nous Comme une lune noire sur ma table. Immédiatement, c’est une absence qui nous arrête, celle du comparé : on ne peut pas ne pas se demander ce qui pourrait ressembler à une lune noire sur (sa) table ! On se dit que quelque chose a été perdu. Très vite on s’aperçoit que lire, c’est ouvrir un chemin de lecture et ainsi, chemin faisant, nous saurons - le mystère se tient ailleurs chez Christian Viguié - que c’est l’ombre, bien plus grande que celle d’un arbre ou d’une montagne, l’ombre « de (son) bol (…) sur la table » qui est « comme une lune noire ». C’est ce plus proche, cette ombre de peu que la banalité quotidienne grandit et illumine. C’est bien le banal qui intéresse Christian Viguié - le mot est récurrent dans ce livre - il affirme clairement que son objectif est de « préserver / l’extraordinaire banalité du monde », sachant que « la banalité est l’écriture la plus claire du réel ». Je vois cette « impitoyable banalité » comme une Dame, celle du Camion de Marguerite Duras. Dans son livre, Marguerite Duras, La noblesse de la banalité, de l’incidence éditeur, Mireille Calle-Gruber s’attache à la mettre en lumière sa « noblesse » : « Elle est cette noblesse de la banalité. Elle est invisible ». Elle est dans les choses, parmi les choses du monde leur intelligence. Elle est en intelligence avec tous ses entours. Comment faire voir cet invisible, là à même le vivant ; Non pas derrière, au-delà, caché en quelque arrière-monde - « Il n’y a pas besoin de métaphysique / pour voir ce que je vois / il suffit d’ouvrir une fenêtre / de regarder le pommier au milieu du pré » - mais là, banalement là dans « le mystère du jour ». Telle est la « noblesse de la banalité », un regard qui ne conquiert pas, qui se laisse dessaisir de son saisissement et passe derrière les mots qui font écran. Ainsi Christian Viguié ose-t-il écrire que les mots qui sauvent sont les mots qui manquent ! Mais, et c’est merveille, une nouvelle phrase arrive plutôt que rien, un pas de plus se propose et c’est la marche, ce bégaiement des enjambées poudreuses qui nous mène là où on ne sait pas devoir aller, si ce n’est dehors, là où sont les choses du monde.
Christian Viguié a l’audace de celui qui ne sait pas écrire « simplement parce que parler ou écrire / sont des mots orphelins / qui cherchent les autres ». Ainsi je bégaie, dit-il, « comme si à travers ce bégaiement pouvait recommencer l’histoire nouvelle / des choses. » Pour Christian Viguié, le bégaiement est une manière / d’être, de passer / et de répéter l’inachevé » et « marcher n’est pas une porte / mais une fenêtre épiant le près et le lointain ». En fait, marcher/ écrire est une « fenêtre » tant que l’on écrit - écrire, c’est faire avancer une fenêtre - et mettre un point final à un poème, c’est voir la « fenêtre » se transformer en « porte », battant sur un dehors d’où nous vient ce « soleil » et ce « vent » dont parle CV, qui rendent vivants les vers du poème.
Christian Viguié est un chinois de l’Aveyron si c’est être chinois que de penser « en termes d’influx, de corrélation, de circulation, de respiration » selon François Jullien, si c’est s’intéresser moins à ce que sont les choses qu’à ce qu’elles font, à comment elles se branchent sur du vital, comment elles réveillent notre sentiment d’exister quand se défait la coupure entre le sensible et le spirituel et que nous oubliant nous-mêmes, perdus enfin, on comprenne que « ce que nous nommions la réalité / est le plus implacable des masques »,.
La poésie de Christian Viguié nous élève à du spirituel mais depuis le cœur même du monde et des choses. C’est à partir du physique que se dégage le spirituel, au sein du fini s’ouvre l’in-fini. Voir le monde se dépasser au sein même du monde, s’évaser en buées musicales, vapeurs tièdes, ombres sur les contours qui vont se dissipant. Passages des souffles.Quelque chose chemine sans bruit, va discrètement son chemin et avec lenteur chez celui qui déclare : « avec mes mots / j’apprends à marcher ».
Lire Christian Viguié, c’est marcher et moins pour se trouver que pour se perdre « coudre l’or d’une route » et « enfermer le soleil dans une larme ». C’est aimer une écriture attachée en bannière aux poteaux d’angle de l’existence et « au jour le jour » en dire le vent, le grand vent qui bégaie en ses rafales tous les mots qui manquent pour que le jour « (ajoutant) une couleur / pour que les autres couleurs / ne meurent pas » ressemble au jour où « (pourrait) recommencer l’histoire nouvelle des choses ». Là est le travail de Christian Viguié : écarter et mettre à distance le silence, déplacer la mort et, comme il l’écrivait dans un livre d’il y a vingt ans déjà, Juste le provisoire paru aux éditions Rougerie, « donner chance aux pas de l’homme / ou à l’oiseau ».
(Note parue dans la revue Europe)
19:14 Publié dans Du côté de mes interventions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian viguié




