20/11/2011
Lu 72 - Mon beau navire ô ma mémoire, Un siècle de poésie française - Gallimard 1911-2011
 Encore une anthologie ? Une anthologie consacrée à la poésie d’expression française du siècle dernier dans toute sa diversité et sa richesse ? Ici, nul axe de rencontre n'est privilégié - tous les choix formels et esthétiques, tous les tons se côtoient - le seul critère est éditorial: en effet, tous les poètes – 100 poètes, 100 poèmes pour 100 ans de poésie! – appartiennent au fonds poétique Gallimard, Antoine Gallimard se chargeant d’ailleurs lui-même de la préface.
Encore une anthologie ? Une anthologie consacrée à la poésie d’expression française du siècle dernier dans toute sa diversité et sa richesse ? Ici, nul axe de rencontre n'est privilégié - tous les choix formels et esthétiques, tous les tons se côtoient - le seul critère est éditorial: en effet, tous les poètes – 100 poètes, 100 poèmes pour 100 ans de poésie! – appartiennent au fonds poétique Gallimard, Antoine Gallimard se chargeant d’ailleurs lui-même de la préface.
Insistons sur le fait qu’ à l’exception de quelques noms toutes les grandes voix d’encre de ce temps sont là suivant un ordre alphabétique aussi simple qu’efficace.
Le vers d’Apollinaire qui fait titre invite à une odyssée: retour à quelques grands textes comme à quelques autres oubliés. Poésie, fille de mémoire !
Cet ouvrage témoigne de la présence importante, essentielle de la poésie dans la fondation et le développement des éditions Gallimard qui fêtent leur centenaire et de cette belle vitalité de la poésie, si l'on entend par là cette écriture acharnée à travailler la langue pour lui arracher une parole qui, sur fond d'abîme, tente de dire le présent, cette question.
21:56 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anthologie, nrfgallimard, poésie
Lu 71- Vladimir Maïakovski, L’amour, la poésie, la révolution, Collages d’Alexandre Rodtchenko,Traduction d’Henry Deluy
 Henri Deluy, le poète fondateur de la toujours jeune revue Action Poétique – On fêtait l’été dernier à Lodève la parution de son N°200 ! – et de la manifestation La Poésie en Val-de-Marne, récidive. Il nous redonne le grand poème de Maïakovski De ça (1923) qu’il avait publié aux éditions Inventaire / Invention, précédé de La flûte des vertèbres (1915), poème d’amour dédié à Lili Brik ; de J’aime (1921-1922) où l’amour brûle sans consumer le désir et son Lénine (1924) commencé avant la mort de celui-ci et achevé peu après où son attachement à la révolution bolchevique va de pair avec son refus d’un culte de la personnalité qui se met pourtant déjà en place .
Henri Deluy, le poète fondateur de la toujours jeune revue Action Poétique – On fêtait l’été dernier à Lodève la parution de son N°200 ! – et de la manifestation La Poésie en Val-de-Marne, récidive. Il nous redonne le grand poème de Maïakovski De ça (1923) qu’il avait publié aux éditions Inventaire / Invention, précédé de La flûte des vertèbres (1915), poème d’amour dédié à Lili Brik ; de J’aime (1921-1922) où l’amour brûle sans consumer le désir et son Lénine (1924) commencé avant la mort de celui-ci et achevé peu après où son attachement à la révolution bolchevique va de pair avec son refus d’un culte de la personnalité qui se met pourtant déjà en place .
Quatre grands poèmes que Le temps des cerises réunit dans la collection commun'art, accompagnés d’une riche iconographie : reproductions de collages du constructiviste Rodtchenko et de couvertures d’éditions originales des poèmes de Maïakovski.
Rien n’y fera : le vers de Maïakovski, comme il l’avait prévu, déchire encore « la masse des ans » et c’est une « arme ancienne / mais terrible » que, lecteurs, nous découvrons – lire et fouiller entretiennent bien des rapports ! Cette arme est celle des questions. De celles que l’homme ne pose pas mais qui ben plutôt le posent comme homme dans son humanité même. Ces questions sont celles par lesquelles Henri Deluy clôt son « adresse à Vladimir (II), Lettre ouverte à V.I Lénine aux bons soins de V.Maïakovski ». Ces questions perdurent par delà les statues, les momies, une révolution « qui va devenir le panier percé de la mort / ce que découvrent (les) archives » , pour celui qui dans une « adresse à Vladimir (I) », au mépris de toute chronologie, met son cœur à nu, laissant percer une tendresse que les années, les coups de l’histoire, ont quelque peu crispées ; après les déceptions, après « Marina l’autre poète », ces questions pour celui qui continue à écrire, qui signe Henri Deluy, sont toujours celles du poème et du communisme. Ces questions ne sont toujours pas réglées pour lui.
Ces questions demeurent à l’avant de toute écriture. Ces questions ne sont pas de celles que posent une « commande pratique » mais relèvent bien de cette « commande sociale » qui est liée à l’existence « dans la société d’un problème dont la solution n’est imaginable que par une œuvre poétique ». L’enjeu alors n’est pas celui de l’actuel mais du présent qui se laisse entrevoir et difficilement nommer, présent qui ne trouve plus sa mesure dans le temps comme il va. C’est dans cette mesure là qu’il y a encore à interroger les vers de cet homme déchiré de poésie qui en appelait à une langue nouvelle, Vladimir Maïakovski. Oui, « c’est dur le futur » ! Surtout quand on a décidé, une fois pour toutes, que la vie devait triompher de la mort, qu’il fallait pour cela l’accélérer toujours – « camarade la vie / au trot / plus vite » - voire sauter dans l’avenir d’un bond, instaurer par là origine nouvelle. Où ? Sinon dans le poème. Là où la poésie existe. Se met à exister. Ce poème qu’Henri Deluy interroge dans sa traduction, matière verbale qu’il arpente fort de ce savoir qui lui faisait écrire que « la frappe du vers est une frappe de sens ».
Oui, il y a encore à lire ces « quatre grands poèmes épiques et lyriques » de Maïakovski, on y entend mugir encore « les coursiers / haletants / du temps ». Ils nous mordent la nuque !
21:45 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : deluy, maïakovski, poésie
01/11/2011
Tomas Tranströmer prix Nobel de littérature 2011 - Poète!
Dans le très beau numéro que la revue Europe consacrait au philosophe Jacques Derrida en mai 2004 – quelques mois avant sa mort – celui-ci disait à Evelyne Grossman qui l’interrogeait sur la vérité blessante propre à tout acte d’interprétation ceci : « traduire, c’est perdre le corps. La traduction la plus fidèle est une violence : on perd le corps du poème ».Et certes, mais on gagne aussi un poète[1], soit quelqu’un qui ne se contente pas de venir avec des mots, alourdis de significations figées – comme tant d’hommes de ce temps misérable – mais avec un langage soit un acte de parole où la langue se trouve remuée, retournée, mise à mal parfois mais amoureusement toujours, un langage comme ces « traces de pattes d’un cerf dans la neige » sur lesquelles tombe le poète un jour de grand écart.
Tomas Transförmer est né à Stockholm en 1931. Ce suédois, par ailleurs grand voyageur, est l’homme d’un espace et d’un temps , il est d’ici et de maintenant, pris dans le mystère des signes, la présence massive et têtue des choses, l’ombre portée des actes des hommes. Poète, il se débat en plein réel au moyen de l’image qu’il n’utilise jamais comme le double fantômatique des choses, mais comme le procès qui permet à l’homme de se situer dans le monde parmi les choses, les cercles dans lesquels elles trouvent à se répartir et qui chez lui interfèrent : la ville et la forêt par exemple, ces deux données de la réalité suédoise :
« Le ciel éclatant s’incline contre la muraille.
C’est comme une prière qu’on adresse au vide.
Et le vide tourne son visage vers nous
Et murmure :
« Je ne suis pas vide, je suis ouvert ».
On comprend que Tomas Transförmer ait été conduit tout naturellement à la pratique du haïku, cette forme brève japonaise qui s’efforce non d’habiller le monde d’images et de figures mais de le laisser être sans peser sur lui du bout de quelques mots. Mots poreux – véritables puits artésiens – par où remonte le « ah ! » des choses quand, étonnées, elles surgissent comme elles sont dans leurs rapports mutuels :
« On marche longtemps et on écoute et on arrive à un moment
où les frontières s’ouvrent
ou plutôt
où tout devient frontière »
La lecture des haïkus de Tomas Transförmer transporte entre les choses, là où c’est la chair du monde qui palpite entre diastole et systole. Son énigme. Ce silence tout vibrant d’intensité. Cela qui nous faut !
[1] Saluons à ce propos Le Castor astral – Et à travers lui les petites maisons d’édition dans leur rôle irremplaçable de passeur de littérature vivante ! – qui dès 1966 s’est attaché à publier ses œuvres. Signalons que si les haïkus de La grande énigme sont bien repris dans Baltiques, Les souvenirs m’observent restent disponibles au Castor astral.
21:53 Publié dans Du côté de mes interventions, Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0)
Lu 70 - Jean-Vincent Verdonnet - Dernier Fagot (Rougerie)
L’âge avance. Le soir descend sur une vie en poésie. Celle de Jean-Vincent Verdonnet qui selon les mots d’Yves Bonnefoy « (aida) la terre à continuer d’être, le langage à ne pas être seulement le gravât des mots dans ses retombées indifférentes », fut en tout point exemplaire.
Il nous apporte aujourd’hui grâce à la fidélité des éditions Rougerie son Dernier fagot. J’aime cette image  des poèmes/sarments que le poète à liés, javelle qu’il offre au lecteur pour qu’il y porte le feu d’une lecture fervente. Chaleur et lumière contre tous les froids, au cœur de toutes les nuits.
des poèmes/sarments que le poète à liés, javelle qu’il offre au lecteur pour qu’il y porte le feu d’une lecture fervente. Chaleur et lumière contre tous les froids, au cœur de toutes les nuits.
J’ai toujours au détour d’un poème entendu « cette voix de la lumière absente ». Quand les yeux se taisent, on peut l’entendre. Et l’entendre, c’est l’entrevoir. Les yeux quittent le livre, s’ouvre alors comme la porte du jardin de derrière sur l’image mentale d’un oiseau « ivre de ciel (…) ouvrant de son aile le soir » ou ce travail au rouge du soleil « dans l’eau du lac » à l’aide de son « tisonnier » invisible ou encore cette « pâleur automnale / qui (s’attarde) dans les allées / en deuil du clos à l’abandon ». Et c’est la porte du temps qui s’entrouvre l’espace d’un instant où se brise jusqu’au silence. Entre l’éternité, ce Fugitif éclat de l’être comme l’écrivait Jean-Vincent Verdonnet en 1987, pour une visite où être et vision s’épousent l’espace d’un saisissement qui se dérobe déjà. Règne à nouveau la séparation, la distance, le chemin devant, toute piste perdue.
Si « rien ne saura mieux dire l’âme / que le feu menacé d’une rose / annonce de tous les départs », dans ce Dernier fagot, c’est la mélodie d’une âme qui se trouve renouée et se donne à entendre. L’âme est sur la route disait Gilles Deleuze. On l’entend marcher dans ce dernier livre de Jean-Vincent Verdonnet, apaisée, assurée de son pas vers « les terres / où n’a pas de fin le sommeil » et où « la compassion des neiges » attend le voyageur.
21:43 Publié dans Du côté de mes interventions, Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0)
Lu 69 - In Memoriam Jorge Semprun - L’écriture ou la vie, Gallimard, 1996
Jorge Semprun, l’intellectuel, le rescapé des camps de la mort, l’homme politique –membre du PCE – clandestin sous Franco, le scénariste de Resnais ou Costa-Gavras ; plus tard, ministre de la Culture dans le gouvernement de Felipe Gonzales, l’écrivain - Maurice Nadeau, l’éditeur, le découvreur, le directeur de la « Quinzaine Littéraire », dont on fête le centenaire de son vivant cette année, parlait d’autant de déguisements – vient de mourir. La mort dont il était revenu, rescapé du camp de Büchenvald où il avait été interné après son arrestation par la Gestapo en 1943, l’a rattrapé le 07 juin 2011 à Paris.
 Quel autre hommage rendre à cet homme sculpté par tous les vents de la deuxième moitié du XX siècle, cet homme qui a eu, selon les mots du poète Jean Cayrol, arraché lui du camp de Mauthasen, « l’étrange privilège d’être né deux fois », que d’engager à lire ce livre « essentiel, nécessaire, vital » selon les mots de Thierry Guichard dans « Le Matricule des anges » : L’écriture ou la vie.
Quel autre hommage rendre à cet homme sculpté par tous les vents de la deuxième moitié du XX siècle, cet homme qui a eu, selon les mots du poète Jean Cayrol, arraché lui du camp de Mauthasen, « l’étrange privilège d’être né deux fois », que d’engager à lire ce livre « essentiel, nécessaire, vital » selon les mots de Thierry Guichard dans « Le Matricule des anges » : L’écriture ou la vie.
Survivre à 18 mois de Büchenvald, avoir traversé l’expérience du « mal radical », être plein de l’odeur de la mort, avoir dans les yeux la fumée des crématoires, les cadavres entassés…choisir d’abord la vie contre l’écriture. Choisir la voie de l’oubli, l’amnésie. Pour se garder en vie, «éviter les mots sur le papier. L’écriture ramenait hier, traînait hier jusqu’à aujourd’hui, emplissait le jour de la nuit d’hier. Semprun choisira le chemin inverse de Primo Levi qui, lui, crut se sauver par les chemins de l’encre. Il choisira d’échapper au passé, de l’enfouir sous des pelletées de vie – Et combien furent risquées les 10 années de militantisme clandestin en Espagne dans les rangs du PCE !
Mais telle est la ruse de l’oubli que d’avoir fait de tout ce passé le sang même de sa vie. Il suffira d’un heurt, d’un coup, d’un hasard, d’une rencontre pour fasse retour la vérité - Et ce sera la conjonction de deux occasions en 1987 : la commémoration de la libération des camps et la mort de Primo Levi qui rendront possible la réappropriation des souvenirs, la tâche d’écrire un récit où l’informulable pourrait prendre forme, trouver « le taux d’artifice nécessaire pour élever mon livre au rang d’œuvre d’art », trouver « un je de la narration, nourri de mon expérience mais la dépassant, capable d’y insérer de l’imaginaire, de la fiction, une fiction qui serait aussi éclairante que la vérité ».
C’est cela que Semprun réalise dans L’écriture ou la vie : montrer qu’ « il n’y a que l’écriture, il n’y a que les écrivains qui soient capables de maintenir vivante la mémoire de la mort ». Et c’est libérer de la vie cela.
Fabriquer de la vie à partir de la mort, l’écriture le peut. Fabriquer de l’humain.
C’est là la force des poèmes. Vous ne pourrez pas lire le récit de la mort de Maurice Halbwachs, philosophe, ou celle de Morales, militant communiste espagnol sans être jeté à la renverse. Bouleversé. Ils meurent, réduits par la dysenterie à n’être plus que viande pestilentielle et le jeune Semprun, perdu, ne trouvera que les mots de Baudelaire pour l’un et ceux de Cesar Vallejo pour l’autre. Et aux lèvres comme dans les yeux des mourants une étincelle, un sourire par où toute l’humanité réussit à passer.
A quoi sert la poésie ? à ça !
21:41 Publié dans Du côté de mes interventions, Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0)
31/07/2011
Lu 68 - Francisco de Quevedo, Les furies et les peines, 102 sonnets, choix, présentation et traduction de Jacques Ancet édition Bilingue Poésie / Gallimard, cat 4
 Le monde est toujours « la branloire pérenne » dont parlait Montaigne. Peindre le passage ; tout ce qui vacille ; tout ce qui tourne et retourne ; tout ce qui plie, se déplie, se replie et échappe n’offrant que peu ou pas de prise relève de cet esprit baroque contemporain d’un monde en voie de dislocation. Aujourd’hui comme hier. Ici ou là-bas quand il s’agit de résister à la langue imposée toujours plus affadie, abâtardie en quelques représentations visant à toujours plus bloquer la pensée sur elle-même.
Le monde est toujours « la branloire pérenne » dont parlait Montaigne. Peindre le passage ; tout ce qui vacille ; tout ce qui tourne et retourne ; tout ce qui plie, se déplie, se replie et échappe n’offrant que peu ou pas de prise relève de cet esprit baroque contemporain d’un monde en voie de dislocation. Aujourd’hui comme hier. Ici ou là-bas quand il s’agit de résister à la langue imposée toujours plus affadie, abâtardie en quelques représentations visant à toujours plus bloquer la pensée sur elle-même.
Pour cela saluons avec bonheur les poèmes choisis, présentés et traduits par Jacques Ancet du grand poète espagnol Francisco de Quevedo (1580 – 1645). Les furies et les peines, publiées dans la collection Poésie / Gallimard, reprennent 102 sonnets répartis en quatre parties : les sonnets métaphysiques, religieux et moraux ; les éloges, épitaphes et tombeaux ; les sonnets amoureux et les sonnets satiriques et burlesques, disposition qui reprend de manière plus ramassée l’organisation initiale qui classait ces poèmes en neuf chapitres correspondant aux neufs muses.
Les furies et les peines, ce choix de Jacques Ancet renvoie au cœur même du poète, creuset de toutes les contradictions, déchiré entre amour et mort, écartelé de finitude. Ce maître du sonnet fut un maître dans l’ordre de la langue qu’il travaillera au sein même d’une imagerie baroque qu’il partageait avec bien des poètes de son temps, notamment son contemporain et grand rival Luis de Gongora. Ainsi le voit-on passer du langage rauque et dépouillé des poèmes métaphysiques aux jeux de mots les plus subtils, aux images les plus précieuses dans ses poèmes d’amour relevant de cette agudeza, de cet art de la pointe et des figures de l’esprit qui en fit un maître du conceptisme sans que jamais il n’ait sombré dans une froide rhétorique. Au contraire, le plus souvent ses vers nous touchent car sa poésie est toujours incarnée, d’une part dans ce que tout corps peut avoir de mortel et d’autre part dans celui d’une société que le poète espagnol passe au crible de ses mots, de son humour dévastateur sans ménager ni les ruffians ni les monarques.
Comment traduire ces sonnets sans les perdre ? Sans que la « parole juste » ne se perde sous « les mots justes » selon la distinction proposée par Jose Luis Borges - Rappelons à ce propos La proximité de la mer, cette anthologie de 99 poèmes du poète argentin que Jacques Ancet a publié chez Gallimard l’an passé - Lisez Les furies et les peines ! Lisez ces 102 sonnets ! Vous verrez, cela s’entend même si vous ignorez tout de la langue espagnole.
19:24 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (1)
Lu 67 - Fabio Scotto, Sur cette rive, L'Amourier, Fonds Poésie, 16 euros
 Fabio Scotto, professeur de langue et de littérature française à Bergame vit à Varèse en Italie. Il est, pour ce pays, le spécialiste et le traducteur des poètes Bernard Noël et Yves Bonnefoy. Poète lui-même, il est l’auteur de plusieurs ouvrages traduits en français et notamment Le corps du sable aux éditions de l’Amourier en 2006. Ces mêmes éditions publient aujourd’hui Sur cette rive. Patrice Dyerval-Angelini en a assuré la traduction et Yves Bonnefoy l’a préfacé.
Fabio Scotto, professeur de langue et de littérature française à Bergame vit à Varèse en Italie. Il est, pour ce pays, le spécialiste et le traducteur des poètes Bernard Noël et Yves Bonnefoy. Poète lui-même, il est l’auteur de plusieurs ouvrages traduits en français et notamment Le corps du sable aux éditions de l’Amourier en 2006. Ces mêmes éditions publient aujourd’hui Sur cette rive. Patrice Dyerval-Angelini en a assuré la traduction et Yves Bonnefoy l’a préfacé.
C’est un ensemble de 17 proses. De courts récits qui tournent tous autour de la question essentielle de notre présence au monde. Tout se passe comme si la figure du lac qui en est la plaque tournante, comme si cette étendue d’eau, ce miroir était occasion de penser au plus fondamental de la vie et au sens à lui donner.
Chez Fabio Scotto, le lac dans sa réalité multiple est toujours « lago del cor » selon les mots de Dante – « lac du cœur », instrument de connaissance profonde. Point de mélancolie ici mais une alchimie poétique. Sur cette rive est un livre écrit par un poète qui cherche à rendre dans ces récits une lumière qui serait celle des jours à venir. Ecoutons Yves Bonnefoy qui fait de Fabio Scotto « un de ces vigilants grâce auxquels la poésie italienne perçoit clairement de nouvelles voies » : « Le lac, la rive du lac, les clartés au loin sur ses eaux mais aussi les maisons du bord, les paroles qu’on y a dites, les êtres qui y ont été désirés, aimés, est-ce seulement le décor de la vie présente, avec de quoi s’orienter à seulement la surface de sa conscience de soi, non, c’est ce qui a tâche d’être dans un nouveau sol un nouveau germe. Le lieu même de l’impossible mais attestable nouvelle terre. »
19:07 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (2)
20/06/2011
Lu 66 - Pierre Reverdy, oeuvres complètes , Tome I et II, Flammarion
Ça y est, nous les avons les Œuvres Complètes de Pierre Reverdy ! Deux volumes chez 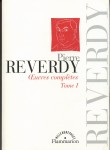 Flammarion! En lieu et place des 14 tomes de l’ancienne édition Flammarion – Poésie / Gallimard assurant la présence de ses principaux titres dans l’horizon éditorial de ce temps : La plupart du temps, Sources du vent, Main d’œuvre plus récemment…Deux tomes, soit quelques 3000 pages comme autant de chemins dans l’œuvre et la vie de Pierre Reverdy au fil des jours et des ans : le tome I, c’est Paris jusqu’au retrait à Solesmes ; le tome II, celui de la maturité poétique.
Flammarion! En lieu et place des 14 tomes de l’ancienne édition Flammarion – Poésie / Gallimard assurant la présence de ses principaux titres dans l’horizon éditorial de ce temps : La plupart du temps, Sources du vent, Main d’œuvre plus récemment…Deux tomes, soit quelques 3000 pages comme autant de chemins dans l’œuvre et la vie de Pierre Reverdy au fil des jours et des ans : le tome I, c’est Paris jusqu’au retrait à Solesmes ; le tome II, celui de la maturité poétique.
Nous les avons ces « pièces détachées », ces notes – si importantes aux yeux de Pierre Reverdy qui disait : « je ne pense pas, je note » - ces articles, ces récits, ces recueils, tous ces poèmes.
Nous les avons avec un appareil critique discret mais d’une rigueur et d’une précision magnifiques. Merveilleux travail d’Etienne-Alain Hubert qui a assuré la mise au net de cette édition.
Nous les avons et pouvons prendre la mesure de l’importance, de la richesse et de la place de cette œuvre dans la première moitié du XX siècle par rapport aux avant-gardes picturales et poétiques : cubisme et surréalisme.
« Comme Phrynis de Mitylène qui ajouta deux cordes à la cithare grecque, Pierre Reverdy sera loué plus tard d’en avoir ajusté une à la lyre française », nous étions alors en 1918, Louis Aragon signait un court article sur Les ardoises sur le toit dans la revue Sic. On peut aujourd’hui avec ces deux tomes louer le poète qui a fait de l’image la chair et le sang du poème, image qui n’est pas, à ses yeux, « moyen de quitter le réel » mais au contraire d’ « en retrouver la saveur profonde, âcre », image creusant de tout son air la réalité, ce que nous croyons savoir du monde et qui ne le rend lisible que parce qu’il l’obscurcit et l’opacifie. Louer, l’analyste de cette émotion appelée poésie qui ébranle la sensibilité et l’esprit plaçant au lieu où se fomentent les grandes révélations qui précèdent toujours les grandes transformations. Louer, l’homme à la vie traversée de passions, soleils et orages mêlés, d’une fidélité à soi-même aussi rugueuse dans la vie que dans le poème conformément à cette sentence selon laquelle « l’éthique est l’esthétique du dedans » qui sut être à la hauteur de ce signe ascendant du désir qui toujours se dégage, se désentrave, se désembourbe, émerge tout ruisselant encore des terres où « l’on aligne les cadavres ». Et avec lui cette saveur du réel qui nous porte à « aimer le poids qui nous fait tomber ». Et plus qu’accepter, aimer notre finitude. Aimer la saveur mortelle de notre condition humaine. Déchirures comprises. Tragique porté à bout de langue comme à bout de formes par un « art de création et non de reproduction ».
Il faut garder près de soi ces deux pierres levées. Il faut lire les poèmes de Pierre Reverdy comme ceux d’un qui n’hésitait pas à affirmer « ce n’est que la vie qui m’intéresse », vous y trouverez toujours sur les devants ce « parti pris de la vie » dont parle Jacques Ancet dans ce Vingt-trois poètes et Reverdy vivants qu’ont publié les éditions Tarabuste en 2007 sous la direction d’Antoine Emaz, et entre les mots, les images, les vers, vous y verrez venir la lumière depuis ce « noir derrière les étoiles », ce vide où le vent tient sources et réserve.
15:36 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : pierre reverdy, poésie, flammarion, oeuvres complètes
Lu 65 - André Velter, Paseo Grande, Gallimard
 On sait que la belle querelle d’André Velter depuis Poésie sur parole émission créée en 1987 sur France Culture avant de rendre l’antenne quelque 20 ans après a été et est toujours de réconcilier musique et poésie, qu’il n’est pour lui de poésie qu’orale, qu’ « un poème qui ne peut se dire, qui n’engage ni le souffle ni le corps ressemble à un violon dont l’âme a été volée ou faussée », qu’il est « pour la parole haute et vive, pas pour le papier mâché ».
On sait que la belle querelle d’André Velter depuis Poésie sur parole émission créée en 1987 sur France Culture avant de rendre l’antenne quelque 20 ans après a été et est toujours de réconcilier musique et poésie, qu’il n’est pour lui de poésie qu’orale, qu’ « un poème qui ne peut se dire, qui n’engage ni le souffle ni le corps ressemble à un violon dont l’âme a été volée ou faussée », qu’il est « pour la parole haute et vive, pas pour le papier mâché ».
On se souvient du premier livre des éditions Alphabet de l’espace (Annecy, 2007) Tant de soleils dans le sang d’André Velter, livre-récital composé dans la résonance de la guitarra flamenca de Pedro Soler. On se souvient qu’il y avait là un beau livre avec les dessins d’Ernest Pignon Ernest et le DVD du récital intégré en 3ème de couverture.
Tant de soleils dans le sang, quelle belle traduction pour ce mot espagnol que l’on doit à Federico Garcia Lorca, ce duende que toujours tente de rejoindre et d’éveiller André Velter dans son écriture.
C’est lui que l’on retrouve dans ce Paseo grande qui vient de paraître aux éditions Gallimard. Nouveau livre-récital avec Olivier Deck augmenté de 7 poèmes-talismans avec Antonio Segui, 7 quatrains qui « (relèvent) le défi / d’être toujours vivant ». C’est un livre-conséquence d’un acte, d’un événement artistique : le mano a mano – ce tête à tête qui dit le polemos, cette harmonie des contraires comme contraires dans la tension du face à face – entre André Velter et Olivier Deck lors du festival de jazz d’ Orthez. C’est un livre-passerelle qui invite à se rendre sur internet pour entendre le chant d ‘Olivier Deck et visionner quelques séquences filmées sur le site www.gallimard.fr/paseogrande.
Furieusement espagnol, son titre qui renvoie à l’entrée des toreros à las cinco de la tarde, heure de vérité où l’inconnu entame son creusement avec la sortie des toros, « heure exacte / où l’ombre et la lumière / s’en vont d’un même pas » jusqu’à « tutoyer les anges ou les dieux / et la mort les yeux ouverts », le montre. Toutefois, ce Paseo est Grande de courir les horizons et les arènes de la terre « sur les chemins de grand vent », sur les versants des montagnes afghanes, du côté du Pamir et du Taklamakan d’asie centrale, vers Samyé, sur la rive gauche du Tsang-Po. Avec l’arène, ces lieux fournissent tous l’occasion d’une part, de se trouver « au centre, le plus vif, le plus vivant / dans la distance la plus gale / de la blessure à la beauté » ; d’autre part, d’être point de passage « au bord du précipice / où la mort est fugace / où le souffle est lumière » comme entre les cornes du toro avant l’estocade et enfin, d’être comme autant d’instants suspendus, hors du monde comme hors du temps, possibilité de « s’en sortir sans sortir » selon les mots de Gherasim Luca.
L’écriture d’André Velter est toujours de main légère, d’enjambée allègre. Elle cite. Citar- je me permets d’ajouter ce mot à ceux que mobilise André Velter : Sitio, llamada, temple –c’est appeler le toro suite à un infime mouvement du pied vers la gauche et qui amène le torero à se présenter de frente, face au toro et non de profil. C’est le moment du risque maximun. Peu visible, il fait le silence sur la faena comme sur le poème images et rythme s’approchent par saccades, alternant lenteur et vitesse, délicatesse et violence. Citer ainsi, c’est appeler l’indicible à se montrer dans le dire comme indicible. C’est là comme un instant d’éternité, un moment suspendu, hors du temps des horloges. C’est le moment du duende qui selon la définition de Lorca dans Théorie et jeu du duende ne vient pas du dehors comme la muse ou l’ange mais s’éveille depuis « les ultimes demeures du sang ». Par ouches fragiles mais aussi parfois violentes, André Velter sait dans ses poèmes le réveiller. C’est lui qui blesse le poème t y fait lever un soleil qui ne se couche jamais . Là est l’originalité de la poésie d’André Velter, là se trouve sa capacité à renouer et élargir la mélodie de notre âme, là la vie trouve ses ressorts secrets pour toujours partir, toujours aller, « pour rester en partance » et « vivre sur le qui-vive / et dans un cri d’amour / comme un amour perdu ».
15:25 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : velter, paseo grande, duende, poésie
02/03/2011
Raphaël Monticelli - L'écriture en bribes, livres d'artiste, oeuvres croisées & autres bricoles
40 ans que Raphaël Monticelli creuse son regard sur l’art et la littérature.
40 ans qu’il traque l’origine du sens dans cette mise en objet – physique et symbolique – de notre présence au monde.
40 ans d’amitiés – on ne saurait toutes les citer ! – de Marcel Alocco aux éditions de l’Amourier en passant par Martin Miguel, Max Charvolen, Henri Maccheroni et les écrivains : Michel Butor, Martin Winckler, Jean-Marie Barnaud…
40 ans que cette amitié – cet autre nom que je donne à la création quand elle se pense comme question ! – d’une part, interagit avec son travail spécifique d’écrivain – On sait que Raphaël Monticelli est l’homme des « bribes » ( 4 tomes des Bribes tirées de la mort de Dom Juan sont parues à ce jour aux éditions de l’Amourier), ces restes d’une expérience du monde, des êtres et des œuvres tels qu’ils se mêlent dans l’histoire, expérience vouée à l’éclatement et à la dispersion et qu’il s’efforce de recueillir en mendiant errant à la poursuite de quelque issue – et d’autre part, a pris la forme de livres particuliers qui naissent de la rencontre entre un artiste et un écrivain que l’on désigne aujourd’hui sous l’expression peu claire de « livre d’artiste ». Ce sont eux qui vont être montrés du 2 mars au 8 mai 2011 à la Bibliothèque à Vocation Régionale Louis Nucera de Nice (Vernissage le 3 mars à 11h). Plus d’une centaine de livres d’artiste et d’œuvres croisées à quoi Raphaël Monticelli n’hésite pas à rajouter le terme de « bricoles ». Oui, « bricoles », ces livres improbables, nés de l’intimité, du croisement des recherches d’un artiste d’un artiste et d’un poète, de la volonté de donner à ces croisements un lieu spécifique d’expression qui ne soit plus tout à fait un livre ni tout à fait un tableau, une toile ou une gravure. La « bricole » est là dans cet entre deux – Avec parfois en tiers, l’intervention d’un éditeur ! – ni tout à fait ceci, ni tout à fait cela. Allant quelque part, les acteurs du livre d’artiste ne savent pas où ils vont. Ils inventent les routes au sein de ce lieu plastique, sorte d’utopie en acte, présente et agissante, dit parfois Raphaël Monticelli. Le livre, cet objet tangible, manipulable qui a une forme et des limites, ici se transforme, s’ouvre. De messager d’un ailleurs – cet auteur inconnu - il devient rôdeur de crêtes, éclaireur de lisières, veilleur aux confins mal assurés.
La randonnée sera belle. De vitrine en vitrine, d’écart en écart, toujours à côté des livres avec Martin Miguel, Max Charvolen, Serge Maccaferri, Henri Maccheroni, marcel Alocco à ceux avec Leonardo Rosa, Jean-Jacques Laurent, Gérard Serée, Gérard Duchêne en passant par François Goalec, Gilbert Pedinielli, Armand Scholtès, Luc Warneck, Martine Orsoni, Monique Thibaudin, Yves Popet, Valérie Sierra, Anne-Marie Lorin, Max Partezana, Giuseppe Becca, Fernanda Fedi, Eric Massholder, Claudio Casavacca, Giorgio Robustelli, Renato Bonardi, Giacomo Lusso…
On n’oubliera pas les mots de Claude Levi-Strauss : « la poésie du bricolage lui vient aussi et surtout, de ce qu’il ne se borne pas à accomplir ou exécuter ; il raconte (…) le caractère et la vie de son auteur. » Ce sont des vies, des bribes de vie que vous viendrez voir à la BMVR de Nice, si vous passez par là. D’infinis @font-face { font-family: "Cambria"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 { page: Section1; }paysages – Tiens, le libellé du Printemps des poètes 2011 ! – d’amitié.
A cette occasion, la BMVR publie un catalogue dans lequel j'ai publié le texte qui suit:
Je lis les écrits de Raphaël Monticelli comme…
1) ceux de quelqu’un qui tente une approche effilochée de la réalité. Toujours à l’écoute de cette polyphonie des voix du monde, de la littérature et de la langue.
2) ceux de quelqu’un toujours dans le déséquilibre, la rupture tant je le vois, je le sais debout, essayant de tenir les deux bouts entre transmission et création : 2 rives, 2 arches d’un pont…dans le danger d’un effondrement sans cesse remis. Toujours possible !
3) ceux de quelqu’un toujours en route. Une sorte de Don Quichotte, ce chevalier du désir. L’homme qui disait « el camino es siempre mejor que la posada » tant c’est sur le chemin que se produisent les rencontres essentielles
4) ceux d’un qui aime se laisser dérouter. Par les œuvres en général, celles des artistes en particulier ceux-là dont il aime la fréquentation depuis les années 1970. Et pour qui il écrit et c’est toujours manière de reprendre pied…dans les mots.
5) Ceux de quelqu’un qui essaye d’intégrer dans la pratique de la littérature les problématiques qu’il partageait dans les années 70 avec ses amis peintres : soit écrire comme on peint quand on pratique le commage/décollage (Charvolen, Miguel) ; écrire comme on tisse quand on pratique le patchwork (Alocco) ; écrire comme on sculpte quand on compose comme Pagès.
6) Ceux d’un crocheteur et donc comme autant de rossignols – Voyez ces rossignols d’un crocheteur ! – oui, ceux d’un voleur. Quelqu’un qui aime à faire chanter les serrures. Sauter les verrous. Qui aime entrer par effraction – voir ses intrusions – là où il n’était pas attendu.
7) Ceux de quelqu’un qui multiplie les pistes au lieu de les fermer. Quelqu’un qui ouvre les possibles du regard. Qui pratique une écriture d’expansion.
8) Ceux de quelqu’un qui a formé ce projet un peu fou de tenter de rendre par le texte littéraire la complexité de ce que nous vivons et pensons. Ce train qui toujours nous emporte. Dans le quotidien. En quoi il retrouvait ses auteurs de prédilection : son ami, Michel Butor mais aussi Joyce, Simon, Pound et Proust bien sûr…
9) Ceux de quelqu’un dont on sent battre l’inquiétude sous les pages. Celle d’une insatisfaction comme si le compte n’était jamais bon – et il ne l’est jamais, on le sait ! – toujours il y a de l’inassimilable, du réel. Mais quelqu’un qui sait que c’est avec ça qu’il lui faut vivre. Et donner ce qu’on peut donner.
10) Ceux de quelqu’un qui joue là sa vie – la bribe plus qu’un nouveau genre littéraire ( ce qu’elle pourrait être) est un mode d’existence – et ce sur le mode mineur du mendiant. Il y a un héroïsme de l’humilité chez RM.
11) Ceux de quelqu’un qui pousse l’humilité jusqu’à dire que s’il écrit de Bribes c’est pour personne. Surtout pas pour que ses amis écrivains et/ou peintres lui disent en retour que c’est bien, et ceci et cela mais « pour comprendre et aimer ce qu’écrivent ou peignent des gens comme eux ». RM est un homme de la praxis. Quelqu’un qui a besoin de passer par la pratique pour assimiler la théorie.
12) Ceux de quelqu’un qui entend ne se couper jamais de la communauté des hommes. Même si en apparence le risque est celui d’une certaine illisibilité, celle d’une parole vive contre la parole morte qui dévide la clarté morne et hébétée de son évidence et dont on bout du compte on finit par se dire : « Ah ! ce n’était que ça… ! »
13) ceux de quelqu’un qui embrouille, s’empègue moins par perversité que parce que c’est là notre position d’être parlé/parlant, d’êtres jetés dans la langue et le sens, à partir d’une blessure première, cela autour de quoi nous tournons moins pour la cacher ou la suturer que pour la tisser autrement. Toujours autrement !
14) Ceux de quelqu’un qui pratique une écriture de la Reversion, soit le fait de tirer la vie de la mort et donner par là présence à l’absence
15) Ceux d’un ami fauteur de troubles et fauteur d’échanges. Un passeur généreux.
16) Ceux de quelqu’un avec qui je partage l’essentiel. Et c’est une Dame. RM et moi l’appelons Madame !
+1
Ceux de quelqu’un d’empêché. Quelqu’un qui aurait aimé être romancier mais qui n’a pas pu. « Les bribes sont un impossible roman. »
Quelqu’un qui a toutes les qualités pour l’être mais quelqu’un dont l’expérience de vie passera dans la pratique littéraire. Or celle-ci implique l’abandon de l’hypothèse de Dieu, le passage de jeune catholique au matérialiste d’âge mûr. Et rejeter la fiction de Dieu, c’était rejeter toute fiction. Tout récit supposant un être tel que Dieu comme garant de la continuité, de la chronologie, donc du sens.
La pratique du roman n’est possible que si on croit – consciemment ou non – en la fiction d’un Dieu, que si l’on se met face à la fiction comme Dieu face au monde.
Où trouver un référent en l’absence de Dieu sinon dans la langue aussi sacrée que le monde qu’elle figure ?
La langue comme métaphore du monde. Lieu du symbolique « cerveau hors de nous, dans lequel nous naissons, vivons, sans cesse ».
Travailler la langue, c’est nous travailler nous-mêmes et le monde.
11:32 Publié dans Du côté de mes publications, Mes ami(e)s, mes invité(e)s | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : monticelli raphaël, livres d'artiste, poésie, littérature
Lu 62 - Jorge-Luis Borges, Proximité de la mer, traduction de Jacques Ancet, NRF, Gallimard
 L’avait-on oublié ? C’est le premier mérite de cette anthologie de 99 poèmes, La proximité de la mer, choisis et traduits par Jacques Ancet, de nous rappeler le fait : Jose-Luis Borges fut d’abord et avant tout poète. El hacedor, le poïetes, celui qui fait avec et dans la langue partager « cette imminence d’une révélation qui ne se produit pas », cela même qui définit le « fait esthétique » pour Borges et qui se tient là, à côté, Buenos Aires dans Buenos Aires, « l’autre rue, celle où je n’ai jamais été, c’est le centre secret des pâtés de maisons, les patios reculés, c’est ce que dérobent les façades (…) c’est cet air de milonga sifflé que nous ne reconnaissons pas et qui nous touche, c’esty ce qui s’est perdu et ce qui sera, l’ultérieur, ce qui nous est étranger, le latéral (…) ce que nous ignorons et chérissons. »
L’avait-on oublié ? C’est le premier mérite de cette anthologie de 99 poèmes, La proximité de la mer, choisis et traduits par Jacques Ancet, de nous rappeler le fait : Jose-Luis Borges fut d’abord et avant tout poète. El hacedor, le poïetes, celui qui fait avec et dans la langue partager « cette imminence d’une révélation qui ne se produit pas », cela même qui définit le « fait esthétique » pour Borges et qui se tient là, à côté, Buenos Aires dans Buenos Aires, « l’autre rue, celle où je n’ai jamais été, c’est le centre secret des pâtés de maisons, les patios reculés, c’est ce que dérobent les façades (…) c’est cet air de milonga sifflé que nous ne reconnaissons pas et qui nous touche, c’esty ce qui s’est perdu et ce qui sera, l’ultérieur, ce qui nous est étranger, le latéral (…) ce que nous ignorons et chérissons. »
Se lancer dans la mise sur pied d’une anthologie, c’est forcément prendre parti. L’affaire redouble lorsqu’il s’agit bien évidemment de traduction, ce corps à corps des langues, puisqu’on sait combien un poète inflige un traitement particulier à sa propre langue. De cela, Jacques Ancet s’en explique dans une forte préface : belle et, à mes yeux, si juste !
Ici, nulle fidélité, toujours prétendue et qui finalement se résout toujours soit en une plate restitution du sens, soit en une poétisation forcée qui vise à faire du poème traduit quelque chose qui ressemble à l’idée préconçue que le traducteur se fait de la poésie mais bien « une infidélité sainte » - Et pardon en passant pour l’emprunt de ces mots à Hölderlin et utilisés hors contexte ! – puisque Jacques Ancet dit avoir choisi « la voie de la recréation ou trans-création, selon la belle formule d’Haroldo de Campos ». N’oublions jamais ce que disait Borges : « la palabra justa n’est pas le mot juste ». C’est pour cela que c’est plus l’oreille que le savoir qui a guidé Jacques Ancet. Se trouvent alors privilégiées, les vibrations, cela qui se joue entre les mots, cette résonance. Et c’est alors « l’intraduisible d’un autre corps » qui se trouve traduit, soit cela seul qui mérite de l’être.. Voie risquée mais la seule belle ! On l’aura compris, pour moi, Jacques Ancet a réussi magnifiquement sa traversée.
Dans ce livre, il y a du savoir et donc de la saveur. Le plaisir y est partout palpable, celui qui a su « être (lui)-même en l’autre et l’autre en (lui)-même ». La préférence de Jacques Ancet est allée aux « poèmes méditatifs et élégiaques en vers comptés et rimés ». On y rencontre des Haïkus, des tankas, des milongas, des hommages à Keats, Joyce, Spinoza, Emerson…et à Buenos Aires, « éternelle ainsi que l’eau et l’air ». On y retrouve des labyrinthes, des tigres, des miroirs, des « petites frappes », des guitares, des couteaux…On y goûte la pratique de ce double amour dont parlait Georges Braque qui disait aimer « la règle qui corrige l’émotion et l’émotion qui corrige la règle », cela qui fait le ton propre de la poésie de Borges. On y comprend enfin que certes la mer importe mais que compte surtout son approche, ces chemins qui mènent jusqu’à la proximité de ses abords. Ces chemins là sont poèmes et comme tels à vivre ! Par chacun d’entre nous. À vivre et donc inépuisables. Toujours proche la mer, comme le dernier mot ! Celle qui « unit et sépare » ne s’atteint pas. Dans le vers !
11:26 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : borges, ancet jacques, anthologie, poésie
Lu 61 - Jérôme Bonnetto - Le dégénéré, éditions de l'Amourier
Comment parler du malheur quand le malheur est ce qui comme heurt arrive et jette dans ce quelque chose de brutal, le désespoir ? Comment longer la ligne, la plier et « s’en sortir sans sortir » selon les mots de Ghérasim Luca ?
Le nouveau roman de Jérôme Bonnetto est le compte-rendu d’une tentative de sortie « hors du rang des meurtriers » - les mots cette fois sont de Kafka – le narrateur échouera mais comme nous apprendrons qu’il est aussi l’auteur du texte que nous venons de lire, il parviendra à desserrer l’étau de l’abjection, cet aimant noir d’un état du monde. La littérature ne sauve que d’être cette contre-attaque là !
Quelque chose d’absolument inattendu va arriver au narrateur de Jérôme Bonnetto. Il vivra cette expérience, comme un trait, une flèche qui le transperce provoquant en résonance une secousse de tout l’être : il doit soudain un jour prouver qu’il est français ! Avec l’identité qui vacille, un trou se creuse où souffle le vent terrible du désordre, celui qui va faire tomber le premier domino qui le mènera d’aveu en aveu jusqu’à l’écriture de ce livre que nous lisons qui doit précéder son oralisation à un certain Victor – masque autre ici de la première personne – avant celle devant la police car nous apprendrons qu’il y a eu meurtre d’une jeune femme dans les jardins du conservatoire.
Jamais mieux qu’ici on ne voit aussi clairement que l’écriture, ce remuement de langue, ne traduit pas une expérience préalable mais qu’elle est le lieu même où elle s’élabore.
Tel est le paradoxe : ce qui vous a coupé le souffle, cela vous donne celui nécessaire à l’écriture d’un roman. Jérôme Bonnetto n’en manque pas. C’est ce souffle-architecte qui lui permet de construire ce labyrinthe de « l’abjection niçoise » dans lequel son narrateur sombrera jusqu’à rejoindre le nom que lui avaient donné les enfants de l’école primaire : « le dégénéré ». Ce naufrage se fera selon le scénario suivant : mise en place d’une part, d’un « processus Victor », cet « imbécile parfait », double du narrateur, servira d’ « oie » à gaver de vérités que le narrateur lui déversera jusqu’à devenir, une « vessie parfaitement plate » ; d’autre part, de l’invention du « principe Luna », Luna, une « idée », une « synthèse » de femmes à qui le narrateur va donner corps et qui va apparaître comme une voie possible de sortie hors de ce lieu mental qu’est, dans ce texte, la ville qui a nom Nice. Cette porte finira par se refermer sur le narrateur rejetant au néant son « mouvement de résistance individuelle et égoïste ».
Décidément, non, on ne part pas. L’enfant de Charleville le savait déjà. On reste pris dans la « boite » - « niçoise », ici – dans le monde comme il va, drôle d’usine qui ne recycle pas mais récupère, c’est-à-dire transforme les mensonges en vérités, les vérités en légende. Avec la honte d’être plongé dans ce que la réalité à d’abject et « la mort Luna » commence la dégénérescence. Et avec le mal, l’écriture.
Comment quelque chose qui se termine par « la vérité enfin déballée » - même si on se déchiquette à ses bords déchiquetés – comment la fin d’une mascarade ne serait-elle pas réjouissante ? Comment en passer par la mort n’exalterait-il pas la passion de la vie ?
Désormais quelque chose peut commencer. Un trait vient d’être tiré en bordure de ce qu’est devenu le narrateur. Le passé étant rendu au passé, le jeu étant débloqué, quelque chose comme un commencement est possible. Nice, sa beauté pourra à nouveau étourdir ; sa lumière, faire descendre la paix et l’harmonie, avec les larmes. La vie, à nouveau. Enfin ?
11:07 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0)




