14/02/2009
Les Cahiers du Museur - Collection "À côté"
J’ai ouvert une nouvelle collection aux Cahiers du Museur : format un feuillet A3, papier Moulin du coq, grain torchon, 325 g plié en deux. Tirage 21 exemplaires. Je l’ai intitulée À côté .
« À côté » est un nom de pays. Celui du regard qui bondit du texte à l’image à moins que ce ne soit l’inverse, contredisant la « belle page » typographique ! Un regard qui comme le lièvre opérerait par bond, histoire de toujours se jeter hors de la ligne droite, du chemin bien tracé, du rang. Geste d’esquive certes mais aussi de saisie comme au vol, saisie de nouveaux appuis pour un nouveau bond.
« Être du bond. N’être pas du festin. Son épilogue » disait Char. Être du décalage, de la distorsion, de la disjonction, aussi léger, aussi minime soit-il. Affaire de ruse. Être de tout ce qui effaçant les traces ouvre une brèche qui intrigue, une meurtrière qui donne envie d’aller y voir, se pencher et penser. Un peu.
Paru(s) :
- Alain Freixe & Frédéric Lefeuvre
- Alain Freixe et Joël Frémiot
- Alain Freixe et Martin Miguel
- Jeanne Bastide et Alain Million
- Alain Freixe et Daniel Mohen
- Alain Freixe et Alix de Massy
- Alain Freixe et Béatrice Englert
- Alain Freixe et Yves Picquet
( Me contacter pour tous renseignements complémentaires)
19:37 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, poésie
Lu 34 - La poésie palestinienne contemporaine
Lodève, juillet. Les voix de la Méditerranée. Un matin où nous discutions avec quelques ami(e)s du fait que les visas n’avaient pas été accordés aux poètes palestiniens et syriens invités au festival alors même que nos gouvernants appelaient de leurs vœux à une Union de la Méditerranée, Francis Combes qui dirige la maison d'éditions Le temps des cerises, m’apporta, tout chaud sorti des presses, la réédition de ce choix de textes traduits par Abdellatif laâbi, La poésie palestinienne contemporaine, paru en 1990. 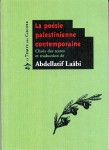
Quelques jours après, le 8 août mourait celui qui y occupe une place centrale, Mahmoud Darwich. On le sait, les superlatifs ne manquent pas à son sujet. A juste titre. Je me contenterais de saluer le poète qu’il s’efforça d’être, le poète d’une Palestine qui n’est pas qu’un espace géographique délimité – Et mis à mal par la politique agressive et meurtrière de l’état israélien, faut-il évoquer ici ce que viennent de vivre dans la bande de gaza hommes, femmes et enfants ? Inutile, n’est-ce pas ? – mais une quête de justice, de liberté, d’indépendance, de pluralité culturelle, un territoire où les voix juives, grecques, chrétiennes, musulmanes pourraient coexister et la poésie voyager entre elles avec l’homme pour enjeu, homme, fruit d’une exigence, et comme tel toujours à venir (voir Balise 39)
C’est dire si cette réédition importe. Le lecteur découvrira dans cette anthologie des voix multiples, des écritures diverses de quoi témoigner de la vitalité de cette poésie confrontée à l’une des pires tragédies qui soit où, excepté le sang et l’injustice, rien n’est neuf ! Dans sa préface, Abdellatif Laâbi remet en perspective les différentes étapes de l’évolution de cette poésie depuis sa naissance dans les années 30 à la génération de 67, date à laquelle c’est moins de génération qu’il convient de parler selon lui que d’une « constellation en mouvement » tant le foisonnement poétique est grand et le chantier ouvert en permanence aux soubresauts de l’histoire, en passant par la génération de 36 et celle de 48, début de l’exode vers les pays arabes voisins.
Saluer cette réédition, c’est aussi prendre date pour un second tome à venir qui porterait jusqu’à nous les poètes nés dans les années 60/70, leurs livres, leurs revues, leurs maisons d’édition.
Capable de travailler une langue, une culture nationale et celles qui, voisines, jouent avec elle, la poésie creuse jusqu’en ce point où source d’énergie « elle s’arme de fragilité humaine pour résister à la violence du monde » selon les mots du traducteur de Mahmoud Darwich, Elias Sanbar.
(cet article est paru dans L'Humanité du jeudi 5 février 2009)
19:15 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie
08/01/2009
Lu 33 - Du rouge aux lèvres (Haïjins japonaises)
Ce qui plaît en général dans le haïku, c’est son trait, soit l’aigu d’une brièveté qui a force d’évidence. Plaît ce quelque chose qui traverse ce peu de mots vers les choses du monde dans leur frémissement, leur vacillement, leur légèreté. Quelque chose qui ouvre ces mots à l’espace même de l’énigme de cette présence, de ce souffle qui caresse les yeux. Et passe – 5/7/5 – dans ces trois vers :
« beni soita kuchi mo wasururu shimizu kana
Je bois à la source
Oubliant que je porte
Du rouge aux lèvres »
Ce haïku de Chyo-ni qui vivait au XVIII donne son titre à l’ anthologie bilingue élégamment présentée que publient les éditions de La Table Ronde, Du rouge aux lèvres, Haïjins japonaises (21 euros). Makoto Kemmoku et Dominique Chipot ont ainsi choisi et traduit quelques 40 haïjins japonaises. Et telle est bien l’originalité de ce livre ! Forts des quelques grands livres parus sur le haïku – Et je pense à celui paru chez Fayard en 1983 et réédité récemment dans la collection Points-Poésie du Seuil dont le texte français est de Roger Munier et la préface d’Yves Bonnefoy et à l’Anthologie du poème court japonais de Corinne Atlan et Zéno Bianu en Poésie/Gallimard – on a toujours tendance à réduire la pratique du haïku aux noms de quelques grands maîtres : Basho (1644-1694), Buson (1715-1783), Issa (1763-1827), Shiki (1866-1902). Ce faisant, on oublie les hajins, ces poètes femmes à qui cette anthologie aujourd’hui rend justice. Elle laisse également entrevoir, d’une part, cette seconde branche du haïku qui tourne ses feuilles vers le quotidien et les gestes qui lui donnent sens jusqu’à réserver un chapitre aux haïkus de la bombe atomique, à côté de celle toujours présente bien sûr des choses comme elles chantent dans le cours des saisons. Et, d’autre part, combien la pratique du haïku est aujourd’hui particulièrement vivace chez les poètes femmes japonaises. Ainsi de Ayaka Sato, née en 1985, dont ce poème termine le livre :
« tachiuo ya toki kikari o hanekaeshi
une ceinture d’argent
reflète la lumière
lointaine. »
(Note parue dans le Patriote Côte d'Azsur du )
19:19 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, poésie
06/01/2009
Lu 32 - Georges Bataille - L'archangélique et autres poèmes
Georges Bataille poète ?
On pensait que l’auteur de L’érotisme, du Bleu du ciel, de L’histoire de l’œil, de Madame Edwarda, l’homme du Collège de sociologie et de La part maudite, de La Somme athéologique qui regroupe L’expérience intérieure, Le coupable et Sur Nietzsche, bref l’inclassable, tout à la fois romancier, essayiste, philosophe, sociologue, ethnologue, penseur religieux… qui n’écrivait peut-être que toujours la même chose à propos de champs aux objets spécifiques, cet homme toujours sulfureux n’avait que dégoût pour la poésie !
On se souvient de ses polémiques avec André Breton à propos du surréalisme, de l’accusation d’idéalisme qu’il lui portait alors et de son livre de 1947, Haine de la poésie.
Mais on avait peut-être oublié l’épisode de Carpentras entre mai 1949 et juin 1951, années durant lesquelles, Georges Bataille, bibliothécaire à Carpentras, renforcera ses liens avec René Char, liens datant de 1946 alors que dans la revue IIIème convoi, il dédie à René Char sa suite d’aphorismes, Apprendre ou à laisser.
 On avait peut-être oublié cet Archangélique que Bernard Noël nous avait donné à lire en 1967 au Mercure de France et qu’il reprend aujourd’hui dans la collection Poésie/Gallimard, augmenté « d’autres poèmes » et d’une préface, Le bien du mal, si éclairante à partir de la lumière qui émane des questions qu’il nous offre à méditer, la moindre n’étant pas que « la poésie (soit) le contraire de ce qu’annonce le mot qui la désigne » !
On avait peut-être oublié cet Archangélique que Bernard Noël nous avait donné à lire en 1967 au Mercure de France et qu’il reprend aujourd’hui dans la collection Poésie/Gallimard, augmenté « d’autres poèmes » et d’une préface, Le bien du mal, si éclairante à partir de la lumière qui émane des questions qu’il nous offre à méditer, la moindre n’étant pas que « la poésie (soit) le contraire de ce qu’annonce le mot qui la désigne » !
On avait oublié que cette expression si souvent citée aujourd’hui encore, Georges Bataille l’avait très vite trouvée obscure. C’est que c’est moins le poème qu’il entendait contester – poème en lutte contre lui-même, sacrifiant ce qu’il pourrait y avoir de poétique en lui – que cette tentation du lyrisme où il est toujours menacé de se complaire ; aussi il lui substituera, quelques années plus tard, en 1962, le titre « L’impossible », manière de faire signe vers « ce qui restera hors d’atteinte », hors explication, irreprésentable et qui cependant reste l’orient de toute littérature et de cette poésie qui est « le contraire de ce qu’annonce le mot qui la désigne ». Révolte dans la langue à partir du désir et de la mort en vue d’une vérité qui serait « représentation de l’excès ».
Or l’excès n’est pas médiatisable. Il ne saurait loger dans les mots. Les articulations du langage les assèchent. Les poèmes de L’archangélique sont marche forcée dans l’impossible. Déchaînement, délit, crime : « le couteau du boucher dans la langue (belle, noble, élevée), écrit Michel Surya dans son Georges Bataille, la mort à l’œuvre (Gallimard, 1992).
A la voie icarienne surréaliste, à son « signe ascendant », Georges Bataille oppose le creusement de la « vieille taupe » entre pierres, racines, vieux os et vers. Là où ça peut germer !
D’aucuns saluaient en l’animal aveugle, la révolution.
C’était hier . Et c’est demain !
(article paru dans le Patriote Côte d'azur du )
19:56 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, poésie
13/12/2008
Voix du Basilic - 28 entretiens conduits par Alain Freixe
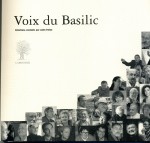 Dans leur collection Voix d'écrits, les éditions de l'Amourier viennent de faire paraître ces Voix du Basilic. Il s'agit de donner à lire les entretiens qu'en l'espace de 10 ans j'ai pu mener avec 28 auteurs des éditions de l'Amourier:
Dans leur collection Voix d'écrits, les éditions de l'Amourier viennent de faire paraître ces Voix du Basilic. Il s'agit de donner à lire les entretiens qu'en l'espace de 10 ans j'ai pu mener avec 28 auteurs des éditions de l'Amourier:
Olympia Alberti, Marcel Alocco, Marie Claire Bancquart, Jean-Marie Barnaud, Daniel Biga, Serge Bonnery, Michel Butor, Michel Cosem, Daniel De Bruycker, Charles Dobzynski, Colette Deblé, Sylvie Fabre G., Claudine Galea, Michaël Gluck, Bernadetre Griot, Werner Lambersy, Henri Maccheroni, Jean MailIanJ, Anna Prucnal, Marcel Migozzi, Martin Miguel, Raphaël Monticelli, Bernard Noël, Florence Pazzottu, René Pons, Leonardo Rosa, Paolo Ruffilli, Fabio Scotto, Michel Séonnet, Yves Ughes, Martin Winckler.
On peut commander l'ouvrage (25 euros) sur le site des éditions : amourier.com
Pour ceux qui l'ignoreraient le Basilic est la gazette que publient 3 fois par an l'Association des Amis de l'Amourier. Ces 8 pages sontdiffusées à 1800 exemplaires en France et à l'étranger. Animal mythologique, plante méditerranéenne, que sais-je encore...notre Basilic est mode d'approche de ce qui est en jeu dans la littérature et la poésie, espaces de vie, d'expression et d'expérimentation. Si vous souhaitez le recevoir, envoyez vos adresses postales à mon adresse mel.
19:04 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie
10/12/2008
Lu 31: Gaston Puel - L'âme errante et ses attaches
L’âme errante fut publié au Dé bleu en coédition avec Le Noroît en 1992. Dans L'âme errante & ses attaches que publie quelques quinze ans plus tard les éditions de l'Arrière-Pays (15 euros), Gaston Puel revisite son ancien livre et hormis quelques corrections de détail, une suppression  ou autre, rien de bien notable.
ou autre, rien de bien notable.
Rien, sinon notre joie de lecteur de retrouver un texte aimé. Et le voir repris par son auteur comme amoureusement c’est en soufflant qu’on ravive les couleurs d’un objet aimé qu’on croyait perdu et qu’on retrouve d’une manière inattendue.
Rien de notable donc. Si ce n’est, et c’est l’essentiel, que l’homme-de-Veilhes a touché à sa composition. L’architecture du livre en est changée comme l’indique avec justesse le titre. Gaston Puel a regroupé dix-neuf poèmes de son livre de 1992 pour en faire « dix-neuf attaches » autant d’agrafes pour cette « âme » qui entre mémoire et parole demeure « errante ».
A la vilaine voix qui dirait que finalement il n’y a rien là de nouveau, j’opposerai la protestation de Pascal affirmant haut et fort « mais la disposition des matières est nouvelle ! ». Il est vrai que cela change tout !
Cette nouvelle économie du texte mais en évidence ces dix-neuf poèmes non seulement comme ensemble qui donne sens à ces fines terres des poèmes qui les précèdent, ensemble divisé en trois parties : « L’invivable ; La vie émiettée ; La nuit plus loin ». Mais encore comme ce qui nous attache au monde jusque dans sa finitude, qui nous assure de notre « lien mortel » avec la terre dans toutes ses déclinaisons, ainsi retrouve-t-on les figures aimées du scarabée, du rouge-gorge ; du merle ; des ormeaux, des collines… Et enfin comme ce qui met en évidence ce vent du désir, « souffle d’énigme et d’évidence » qui vient raviver le texte jusqu’à le rendre à sa fraîcheur première.
Dès lors que peut-on faire d’autre que d’accepter ce remuement auquel il se prête ? Je suis heureux de retrouver la poésie de Gaston Puel sous sa forme d’ « art des nuages », métaphore d’une création sans clôture, sans fin ni finalité, ouverture sur l’ouvert et n’en désignant jamais que l’ « insaisissable présence ». Ce vent de poésie pousse au devenir, à la série infinie de transformations infinies, élan perpétuellement renaissant.
Il faut lire Gaston Puel comme il regarde les choses du monde - le rouge-gorge, par exemple – d’un « regard vrai ». Cela « rend l’âme légère ». Revient alors l’espoir, cette « grâce de recommencer ». Et donc de poursuivre. Homme debout sous les coups du dehors.
C’est cela que l’on entend dans les poèmes de Gaston Puel, cette voix de l’espoir qui sait acquiescer au temps comme il vient, qui nous délie, nous brasse, nous fait gerbes. Cette voix de l’espoir vient d’où vient le vent et qui souffle entre les attaches que nous offre le monde, elle est l’âme errante qui hante le poème.
© Alain Freixe
20:10 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, littérature
Lu 30: En présence...de Bernard Noël
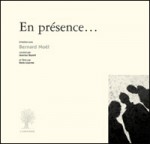 En présence... que publient les éditions de l'Amourier dans leur collection Voix d'écrits (30 euros) est un livre d’entretiens de Bernard Noël avec Jean-Luc Bayard auquel est joint le DVD d’un film réalisé par Denis Lazerme, En présence d’un homme, tourné à propos du livre géant que Bernard Noël a réalisé avec le peintre Geneviève Besse et le sculpteur Olivier Seguin pour la maison Rabelais à la Devinière.
En présence... que publient les éditions de l'Amourier dans leur collection Voix d'écrits (30 euros) est un livre d’entretiens de Bernard Noël avec Jean-Luc Bayard auquel est joint le DVD d’un film réalisé par Denis Lazerme, En présence d’un homme, tourné à propos du livre géant que Bernard Noël a réalisé avec le peintre Geneviève Besse et le sculpteur Olivier Seguin pour la maison Rabelais à la Devinière.
Jean-Luc Bayard parle volontiers de voyage à propos de ce projet : voyage dans une vie de création, traversée du temps de la vie d’un homme qui fait surgir aussi bien le passé que ce que ce que l’on pourrait faire si l’on croyait à l’avenir mais voilà si l’on est bien en présence d’un homme – et les questions de Jean-Luc Bayard n’y sont pas pour rien tant elles cherchent moins le renseignement, les anecdotes qu’à se joindre au propos par où s’affirme une solidarité entre questionneur et questionné- c’est que l’homme y est au présent !
Vous ne trouverez dans ce livre ni inventaire, ni somme, ni un Bernard Noël empaillé au passé, ni un Bernard Noël ennuagé de futur, soucieux à mourir de son œuvre !
Le poète Bernard Noël – et c’est là à mon sens la grande leçon de ce livre – s’efforce d’être moins poète et toujours plus homme. Un homme que « l’écriture engage gravement », un homme ouvert dans sa division, toujours rendu à ce qui le dessaisit de toute prise et le jette au présent sur les routes où écrire désespère certes dans le présent des mots tant il sait ne pouvoir sauver le vif mais qui d’un autre côté s’offre comme la seule voie possible où poursuivre jusqu’à ce qu’arrive la fin avec pour moteur un désir, inventeur de chemins, et une soif qui ne peut s’étancher que dans de nouvelles fièvres. Un homme que toujours quelque chose pousse dans l’inachevé, le vouant à l’interminable, dimension ouverte par la désertion des noms en lieu et place de Dieu, « vide vivant » dirait Jacques Dupin, vide germinatif où naît le vent qui anime la traversée. L’impossible traversée. Pour que ce soit « la fin qui signe ». Un homme au “non” résistant qui sait que “c’est la guerre”, “guerre avec la société dans laquelle nous vivons. C’est la guerre de continuer à écrire. C’est la guerre de ne pas se plier au commerce, à la consommation”. Un homme pour qui “la poésie est le foyer de résistance de la langue vivante contre la langue consommée, réduite, univoque”, poésie qui ne seprend jamais les pieds à ses propres miroirs. Un homme engagé en tant qu’écrivain moins par les sujets de ses textes que par son engagement dans l’écriture, engagement grave du côté de la vie.
( Article publié dans le Patriote Côte d'Azur du 17-23 octobre 2008 )
19:36 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, littérature
Lu 29: Alvaro Mutis - Et comme disait Maqroll el Gaviero
Vous aimez les histoires ? Les romans ? Les romans latino-américains, cette littérature de ports perdus et misérables des Caraïbes avec leurs perroquet criards, leurs crocodiles furtifs, ces brumes sur les fleuves, cette humidité dévastatrices, ces personnages typiques - femmes dangereuses, hommes interlopes - pris dans un univers animiste et primitif, popularisés par Gabriel Garcia Marquez ? Alors vous avez sûrement aimé la saga narrative d’Alvaro Mutis, les aventures et tribulations de Maqroll et Gabiero : La neige de l’Amiral, Ilona vient avec la pluie, un bel morir et suite à ce tryptique, La dernière escale du tramp steamer, Ecoute-moi Amirbar, Abdul Bashur, le rêveur de navires et le rendez-vous de Bergen, tous publiés chez Grasset et tous tournant autour de ce personnage Maqroll et Gabiero, marin aux aventures terrestres,homme de vigie, veilleur aux confins, arpenteur des frontières, familier des précipices…figure même du poète.
 Il n’est pas inutile de savoir que tous ces romans sont comme des excroissances de la poésie d’Alvaro Mutis, qu’ils sont sortis de son œuvre poétique, celle-là même que la collection Poésie / Gallimard nous donne aujourd’hui à lire avec ce volume Et comme disait Maqroll el gaviero. En effet, Alvaro Mutis est le poète qui contribua à sortir dans les années cinquante la poésie colombienne d’un lyrisme traditionnel, prisonnier de vers à la structure et au rythme convenus sous l’influence conjuguée du surréalisme et de Pablo Neruda.
Il n’est pas inutile de savoir que tous ces romans sont comme des excroissances de la poésie d’Alvaro Mutis, qu’ils sont sortis de son œuvre poétique, celle-là même que la collection Poésie / Gallimard nous donne aujourd’hui à lire avec ce volume Et comme disait Maqroll el gaviero. En effet, Alvaro Mutis est le poète qui contribua à sortir dans les années cinquante la poésie colombienne d’un lyrisme traditionnel, prisonnier de vers à la structure et au rythme convenus sous l’influence conjuguée du surréalisme et de Pablo Neruda.
Dès 1953 avec Les éléments du désastre, l’univers poétique d’Alvaro Mutis est en place, univers de désespérance où terminer importe peu, où il faut toujours poursuivre avec l’échec pour aiguillon . Le personnage de Maqroll et Gabiero en occupe déjà le centre nerveux. Il y tient la place du conteur : « Il déversait sur ses auditeurs la mélancolie de ses longs voyages et la nostalgie des lieux qui étaient chers à sa mémoire, et dont la distillation lui donnait la raison de sa vie ». Celle aussi de l’errant, toujours battu mais jamais abattu dont le désespoir n’est jamais un renoncement à vivre tant il tient de partout à la « réalité rugueuse » d’ici-bas mais force levée contre le monde et son cours.
Il est une figure de la poésie, celle qui ne vit que du désir et de la mort, forces qui la soulèvent et la dressent, l’adressant à l’autre de tout lecteur, celle qui se tient dans « l’imminence d’une révélation qui ne se produit pas » selon l’affirmation de Borgès, attente de ce miracle entrevu quand l’âme est invitée à la fête des sens ; la même qui rend ses amours transparents et libres avec Flor Estevez , Ilona, Ampara maria ou Dora estella ou qui préside à ces rencontres improbables avec ce qui en lui attend « l’effondrement de son être » dans les gorges d’Aracuriante par exemple ou ce sentiment de plénitude où « tout (serait) accompli pour lui » comme dans une rue de Cordoue, moments où « échapper au trafic des ports et de l’étoile toujours contraire de son errance insasiable », moments où s’opère un changement intérieur lui permettant de gagner en lumière, en lucidité.
Les routes du gabier sont géographiques, elles s’enfoncent dans le continent américain mais enlacent aussi bien les autres continents et les peuples d’Europe, d’orient comme du Moyen-Orient. Spatiales, elles sont aussi temporelles. Sur les routes de Maqroll, le passé et l’histoire sont présents. À ces routes du monde et de l’histoire, Alvaro Mutis ajoute les routes du sacré tant il sait mêler approche rationnelle et approche mythique du monde. Si l’âme est ce qui se joue entre les mots, les routes de Maqroll et Gabiero, en la poésie, cette propédeutique aux romans, sont routes de l’âme. Routes qui jamais ne sont de simples moyens mais toujours fin en elles-mêmes. Comme pour Antonio Machado : « caminante, no hay camino / se hace camino al andar ». Marcher fait le chemin. En route !
© Alain Freixe
18:50 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie
11/11/2008
Lu 28 - Philippe Jaccottet - Ce peu de bruits
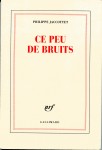 Ce peu de bruits (NRF, Gallimard, 12 euros), dernier livre de Philippe Jaccottet s’ouvre sur un « obituaire », ce registre où l’on écrit le nom des morts. Entrer par la mort, faire d’elle le guide sombre de cet âge cassant dans lequel est entré le poète avec le siècle nouveau, c’est faire d’elle l’éclaireuse de ce qui reste. Comme c’est mettre sous sa lumière les pages qui suivent ces saluts aux ami(e)s disparus.
Ce peu de bruits (NRF, Gallimard, 12 euros), dernier livre de Philippe Jaccottet s’ouvre sur un « obituaire », ce registre où l’on écrit le nom des morts. Entrer par la mort, faire d’elle le guide sombre de cet âge cassant dans lequel est entré le poète avec le siècle nouveau, c’est faire d’elle l’éclaireuse de ce qui reste. Comme c’est mettre sous sa lumière les pages qui suivent ces saluts aux ami(e)s disparus.
Suivent au fil des pages des brins d’existence comme de langue : « des bribes ultimes sauvées dans un ultime effort du désastre » par un survivant. Soit des miettes, des touches, des fragments de choses vues, des bouts d’images, autant de mots que l’on peut dire quand on revient des contrées de l’absence et de la perte, quand on remonte du « ravin » ces « notes » tirées de la mort comme de l’oubli et du silence pour, grimpant, se sentir encore un peu léger à parier toujours pour la transparence et le délié et « jusqu’au bout, dénouer, même avec des mains nouées ».
Ce peu de bruits est donc celui que fait cet ensemble de notes, de citations, de morceaux de poèmes, d’impressions de lectures. C’est un murmure que l’on entend. Quelque chose de rasant, une lumière de bas de porte mais qui insiste et trouve à passer, à faire encore danser les poussières. Un chuchotis endurant, cette musique même de l’âme quand elle défroisse ses plis sous les souffles des mots que tisse encore ce « vieux chinois anonyme » sous les traits duquel se peignait le jeune poète Philippe Jaccottet dans ses Remerciements pour le prix Rambert, toujours là, dans sa cave, à peindre des « riens », « débris » qui seraient comme d’un « nouveau livre des Morts » et tels que nous pourrions les brandir au moment de franchir le mince ruisseau de la fin. Et passer « sans peur ni regrets le seuil du très sombre espace qui (nous) attend pour nous engloutir ou nous changer ».
On est là, dans ce livre, comme sur un site archéologique, ces fragments épars ici rassemblés sont autant de témoignages que la fouille a arraché au silence et à la nuit de la terre des jours et qui, de façon terriblement intempestive à mesure que le pas se fait plus « caduc », comme le dit Luis de Gongora, affirment qu’il y a encore bien des occasions d’être surpris par cet insaisissable qu’est la beauté lorsque nous en faisons l’expérience dans une rencontre soudaine et hasardeuse.
Je ne me lasserai jamais de remercier Philippe Jaccottet de nous apprendre à « être ouvert » aussi bien à l’enfer et au malheur qu’à ce qui devant nous, persiste, dans le cours du monde, cette lumière qui coule comme l’eau d’un ruisseau inverse – « Cela ruisselle vers le haut », écrit Jaccottet - dans le chant du rossignol.
Mon ami Hans Freibach sait que « les beaux chemins » de Philippe Jaccotet – son étude parue dans le N°110/111 de la revue Sud en 1995, a été reprise sur le blog lapoesieetsesentours.blogspirit.com le 12/09/2006 - sont des chemins de vie. Mon salut au seuil de l’été pour lui. Et vous !
(article paru dans le Patriote Côte d'Azur N°2128 du 11-17 juillet 2008))
20:23 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (1)
Jean-Max Tixier - Les chants de l'évidence (entretien avec Alain Freixe)
Cet entretien devait paraître dans la collection "Visages de ce temps" que dirigeait Jean Digot chez Subervie. La mort de ce dernier remit tout en question. Thierry Renard et ses "Paroles d'aube" voulut reprendre le projet. Mais l'économie eut raison de cette maison d'édition. Les années passaient. Enfin, les éditions "Autre temps" accueillirent ce qui était devenu, au fil des lettres échangées, des questions posées, des réponses engrangées et discutées, un vrai livre. Il vient de paraître (Autre temps éditions, Parc d'activités de la plaine de Jouques,200 avenue de Coulins, 13420 Gémenos - 16 euros).
Je reproduit ci-dessous la quatrième de couverture signée par notre ami Jacques Lovichi:
"Pour qui croit vraiment le connaître, Jean-Max Tixier apparaît, poétiquement, politiquement, affectivement, comme le lieu privilégié d'un affrontement permanent, d'une inextricable et inconcevable mais féconde contradiction qui le fonde et le meut dans une effervescence continue dont il domine les sursauts et les apparentes incohérences par l'usage constant d'une implacable logique.
Son humour est celui du doute qu'il doit à son maître Montaigne, sa violence est celle de l'éternelle jeunesse domptée par un cartésianisme très relatif et spécifique, sa poésie - diverse et multiple en sa
somptuosité verbale - n'appartient qu'à lui. Refermant le présent livre, dans lequel Alain Freixe (il y fallait un autre poète) exerce une maïeutique serrée qui tente de cerner l'homme et l'œuvre, en saura- t-on davantage sur le phénomène Tixier ?
Oui, sans nul doute. Mais le cœur du mystère résiste à toute investigation. Dans cette « mise en scène » qu'organise subrepticement le principal intéressé, on frôlera parfois de si près la vérité (existe-t-elle
en ces matières, du moins n'est-elle pas multiple, insaisissable ?) que l'on croira avoir tout compris de la poésie, des poètes, et spécialement de celui-là.
Fort heureusement, il n'en est rien.
Peut-être même l'énigme s'épaissit-elle dans l'ambiguïté qui fouaille, constitue, détermine le funambule, lui tenant lieu de balancier.
Ci-gît l'éternel paradoxe.
Et c'est très bien ainsi."
18:31 Publié dans Du côté de mes publications, Mes ami(e)s, mes invité(e)s | Lien permanent | Commentaires (0)
Lu 27 -"La poésie, c'est autre chose", sous la direction de Gérard Pfister
 La poésie, mais qu'est-ce ? Une inconnue délaissée ? Il faut dire qu'elle joue perdant. Rebelle à tous les attributs dont on voudrait l'affubler, on ne peut la saisir. Les poètes ne se sont pas privés de lui proposer, parfois de manière péremptoire, des définitions. Mais voilà, elle est toujours autre chose !
La poésie, mais qu'est-ce ? Une inconnue délaissée ? Il faut dire qu'elle joue perdant. Rebelle à tous les attributs dont on voudrait l'affubler, on ne peut la saisir. Les poètes ne se sont pas privés de lui proposer, parfois de manière péremptoire, des définitions. Mais voilà, elle est toujours autre chose !
Oui, Gérard Pfîster a raison de rappeler le mot de Guillevic : "la poésie, c'est autre chose » et d'en faire le titre de son anthologie où sont recensées « 1001 définitions de la poésie », publié dans la collection « Les Cahiers d'Arfuyen », éditions Arfuyen (15 euros). Bien sûr tout tient dans ce « 1000 + 1 » qui maintient la voie ouverte vers quelque soleil futur !
C'est ce vacillement que nous donne à lire Gérard Pfîster. On feuillettera ce livre comme on tournerait un cristal. Huit facettes, huit approches défînitionnelles : Affirmation, Connaissance, Emotion, Licorne, Musique, Objet, Révélation, Vie. Le tout réunissant quelques 650 citations de quelques 250 auteurs d'époques, de langages et de sensibilités très diverses.
C'est un sacré service que Gérard Pfîster rend à la poésie contemporaine tant il est vrai que ce livre aide à nous la faire comprendre et aimer. Les passionnés sont toujours passionnants ! Gérard Pfîster est de ceux-là !
Parce que nous fêtons cette année le centenaire de sa naissance dans un silence assourdissant, j'aimerais souligner ce chemin ouvert par René Daumal dans ce toujours fameux débat entre prose et poésie : « la prose parie de quelque chose, la poésie fait quelque chose par des paroles ». Le poète est celui qui fait. Que ce sens grec du mot reste à notre horizon et nous comprendrons que là où l'on a « rythmé la langue dans l'émoi », comme le rappelait Pierre Michon, à Mouans-Sartoux le 5 octobre dernier, là se trouve la poésie.
© Alain Freixe
16:54 Publié dans Du côté de mes interventions, Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0)
02/06/2008
Lu 25 - Coleridge, La ballade du vieux marin
( Vient de paraître, Samuel Taylor Coleridge, La ballade du vieux marin et autres textes, Poésie/Gallimard, Cat 7)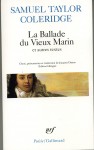
Oui, et pour plusieurs raisons. Dans une très éclairante préface Jacques Darras qui a assuré la traduction de ces textes – l’essentiel de l’œuvre poétique de Coleridge - s’attache à mettre en évidence ses errances de marcheur puissant – Il faut l’imaginer en « voyageur perdu au-dessus d’une mer de nuage », de dos, les yeux perdu au loin surplombant la nature sauvage du pays de Galles et des Lacs du côté de son ami le poète Wordsworth avec qui il composera durant l’année 1797 ces Lyrical ballads, publiées sans nom d’auteur, qui vont « révolutionner la sensibilité poétique » d’alors – ou de voyageur – Avant les deux années passées à Malte entre 1804 et 1806 d’où il reviendra profondément changé physiquement, ce sera l’Allemagne où il séjournera entre septembre 1798 et décembre 1799, année de rupture où il découvre les philosophies de Kant, Schelling et Hegel et d’où il reviendra profondément changé intellectuellement.
Romantique, certes, mais avec un pied déjà dans la modernité comme en témoigne son amour pour les grandes villes, Londres notamment où il retournera toujours pour ses lieux de parole : cafés, salles de conférence.
Pour Jacques Darras, il est la figure exemplaire de « l’esprit européen (…) pionnier, découvreur de langues, de littératures et de sensibilités », figure malheureuse tant il eut à vivre la césure entre sensibilité et rationalité, poésie et philosophie. De fait, les grands poèmes de Coleridge sont tous d’avant son séjour en Allemagne. Tout se passe comme si à 26/27 ans il « s’opérait vivant » de la poésie comme Mallarmé le dira plus tard pour Arthur Rimbaud !
Il faut lire ces poèmes dont la célèbre Ballade du vieux marin, cette errance maritime d’un vieux marin coupable d’avoir tué un jour un albatros, « l’oiseau par qui le vent soufflait ». C’est dans ses mots qu’erre le vieux marin. Et nous avec lui, pris au filet de sa parole, renvoyés à notre propre errance de sujet sans place. À l’image d’un souffle sur la mer, ainsi allons-nous !
21:57 Publié dans Du côté de mes interventions, Du côté de mes publications, Inédits | Lien permanent | Commentaires (0)





