24/04/2013
Michel Ménaché à propos de Dort en lièvre de Marie Huot, Editions Le bruit des autres
Dormir les yeux ouverts et toujours guetter, tel est le sens de l’expression ancienne donnée en titre à son dernier recueil par Marie Huot : Dort en lièvre. Trois courts recueils sont rassemblés dans ce livre : Animal, Poisson et lilas, Corsage de guêpe.
L’affût des sens, animalité et humanité au diapason de la précarité, le monde sensible est perçu et restitué à petites gorgées, à l’entaille du poème, dans sa chair, au contact de la terre, de l’air et de l’eau…
En exergue d’Animal, une citation de Beppe Fenoglio, au féminin ici revendiqué, ouvre la voie, abolit la frontière symbolique et culturelle entre l’humain et l’animal : « Si je n’étais pas une femme – dit-elle –, je voudrais être une femme. Et puis encore une femme. Mais si ce n’était pas possible, je voudrais être un héron. » Etat de fusion de vif à vif, non de confusion. L’écriture est à la fois quête et révélateur de l’être, cérémonial intime des sens en éveil : « J’avance dans la nuit vacillante / J’appuie ma joue contre des maisons chaudes / Mes paupières s’abaissent sur des insectes / morts // Dans le bruit du gravier / Je cherche une parole humaine. » Mais l’accueil des sensn’est là ni béat ni passif. A la violence du monde fait écho la révolte du corps qui peut faire mal au dehors, brûler au-dedans : « Je dépèce ma colère animale à deux mains / Du museau aux talons // Je garde dans les poches de mes robes à fleurs / Les griffes et les dents / Intactes et blanches. »
Les instincts, les émotions, en éclats d’encre, égrènent le sens, tirent la langue par tous les bouts, exacerbent les papilles, entre onirisme et introspection métaphorique, jouent d’analogies insolites : « Au rebord des verres / Le vent glisse son doigt mouillé // Les oiseaux dans les joncs / Poussent aussi leurs cris / En cercles de cristal. » Découpage à vif dans l’écheveau des sensations. Jubilation et souffrance. Ambivalence, ricochets de signes dans le blanc sans fond de la page : « Je voudrais crier / Avec la fluidité du sable / Et que l’insecte de mon cri / Coule avec. » Ou encore, plus douloureusement explicite : « Je suis parfois / Cette fille au poignet taillé / Et le porte à ma bouche. »
Dans Poisson et lilas, l’exergue de Pierre Peuchmaurd est partie intégrante du recueil et vaut tout commentaire : « Mes bêtes ne sont pas des allégories, des personnages de fable ; elles ne désignent qu’elles-mêmes, ne renvoient pas à l’homme qui est l’une d’elles, circulant parmi elles, pas particulièrement privilégiée. » Le poème dit l’équilibre précaire et le manque, les carences affectives inapaisées : « La fille qui porte le poisson et le lilas / Trébuche / Elle dit que ce n’est pas assez / Qu’elle voudrait aussi / Qu’on l’attache à l’histoire / Qu’on lui épelle chaque serrure en signe / d’amour. » La clé du mystère existentiel toujours échappe, tourne parfois comme un couteau dans la plaie quand l’être aimé n’entend pas, esquive l’attente : « Et déjà elle ramasse le bois mort / Le verre pilé / Et se coupe le visage / Elle est un Indien / Sa peau lacérée / Rouge / Ses peintures de guerre sont plus belles / A l’instant de la rage où il ne la voit pas / Que dans tous les mouvements / De la lutte où il l’entraîne. » Posture de guerrière, jusqu’à l’autodestruction : « Elle cogne / Elle cogne à poings durs / Somnambule immobile / Dans ce mouvement de la mort / Qui passe / Le rauque dans sa gorge pousse en lierre / Recouvre sa rage taiseuse. »
Enfin Corsage de guêpe s’ouvre sur un vers de Jean-Baptiste Para : « Sa voix est une eau douce où les guêpes se noient. » L’angoissante et permanente question du rapport au monde et aux autres taraude, retourne la mémoire, arrache les masques et les paravents ouverts à demi du paraître : « Il faudrait parler / De cette lisière-là / Entre nos visages et le monde / Des plis serrés qui s’y lisent / Où un silence bleu s’insinue parfois / Tandis que l’on a une grande voile blanche / Dans la tête. »
Ce livre des questions et des affûts s’achève sur une interrogation existentielle, la nécessité de dire, raison ou déraison du poème : « Se pourrait-il / Que le visage d’une femme / Cent fois recomposé / Jamais ne parle // Pas même la nuit / Pas même à l’équateur de la nuit / Dans un souffle blanc / Comme d’insecte ? »
Cris et chuchotements à la source, lyrisme elliptique à la saignée sensible du poème.
( article paru dans la revue EUROPE )
17:14 Publié dans Mes ami(e)s, mes invité(e)s | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : ménaché, marie huot, revue europe
Lu 90 - Bagdad Jerusalem, à la lisière de l'incendie de Salah Al Hamdani et Ronny Someck, éditions Bruno Doucey
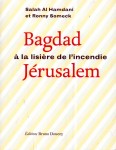 Deux hommes, deux destins. Salah Al Hamdani et Ronnie Someck sont nés la même année (1952) dans un même pays, l’Irak. Tous deux vont avoir à connaître l’exil, l’un, dans son enfance, pour Israël, sous les pressions des nationalistes irakiens ; l’autre, en 1975, en France – à cause de la lecture d’Albert Camus ! – après avoir connu les geôles du dictateur Saddam Hussein. La rencontre a lieu à Sète au cours du festival de poésie Les voix vives de la Méditerranée en Méditerranée, édition 2011. Le projet de ce livre improbable où un poète arabe et un poète israélien décident d’entrecroiser leurs écritures est né là au hasard d’une écoute et d’un partage de voix. Bagdad Jérusalem, à la lisière de l’incendie et la poésie comme lumière que portent, chacun à sa manière, selon son rythme, ces deux poètes.
Deux hommes, deux destins. Salah Al Hamdani et Ronnie Someck sont nés la même année (1952) dans un même pays, l’Irak. Tous deux vont avoir à connaître l’exil, l’un, dans son enfance, pour Israël, sous les pressions des nationalistes irakiens ; l’autre, en 1975, en France – à cause de la lecture d’Albert Camus ! – après avoir connu les geôles du dictateur Saddam Hussein. La rencontre a lieu à Sète au cours du festival de poésie Les voix vives de la Méditerranée en Méditerranée, édition 2011. Le projet de ce livre improbable où un poète arabe et un poète israélien décident d’entrecroiser leurs écritures est né là au hasard d’une écoute et d’un partage de voix. Bagdad Jérusalem, à la lisière de l’incendie et la poésie comme lumière que portent, chacun à sa manière, selon son rythme, ces deux poètes.
Deux voix, trois langues dans ce livre, jamais la fameuse affirmation du poète allemand Paul Celan – « Je ne fais pas de différence entre un poème et une poignée de mains» - ne fut plus vraie. C’est à propos de ce genre d’ouvrage qu’on peut arriver à se dire que l’autre nom de la poésie pourrait être l’amitié, cette aptitude à tisser des liens entre les êtres et les cultures : « Tu murmures en hébreu, dit Salah Al Hamdani à Ronny Someck, à propos de Bagdad / des mots émigrés de mon cœur ».
Ce qui émeut dans ces voix certes différentes, c’est qu’on y entend, étroitement mêlés, d’une part, un sujet en exil, soit quelqu’un qui « se couche seul / entre les lignes de l’Histoire » (Salah Al Hamdani), quelqu’un qui a eu à subir la violence de l’Histoire, l’exclusion forcée d’une terre, « ô Tigre, ô Euphrate serpents d’agrément sur la première carte / de ma vie, / vous avez mué en vipères » (Ronnie Someck) et d’autre part, l’exil de tout sujet humain en tant qu’ « arraché au grand Tout, comme le dit Octavio Paz, (il tombe) en terre étrangère », cette aliénation qui structure tout être humain dès lors qu’il a affaire aux mots qui au moment même où ils nous donnent le monde, nous en dessaisissent. On y voit aussi une posture, cette cambrure propre aux hommes de parole qui savent se dresser, lancer leurs poèmes « épine(s) / dans la gueule du néant », demeurer debout alors que tout sous eux s’est dérobé, que tout n’est encore et toujours que séparation et rupture, ces fruits de l’exil et s’appeler : « viens, rejoins-moi, dit Salah Al Hamdani à Ronny Someck, pour abattre les murs / et chérissons les cendres / de nos morts (…) Déchirons ensemble les langues / qui mentent sur la paix / Incitons-les à la révolte. »
17:11 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bagdad, jerusalem, salal al hamdani, ronny someck, bruno doucey éditions
22/03/2013
Balise 83 -
"Nous autres sans patrie. Nous autres étrangers sur la terre étrangère nous sommes chacun dans notre propre asile comme un sanglier apeuré, perdu au centre de la grande ville à l'heure où les chevaux vont boire, à l'heure où les assassins s'éveillent. Mais nous ne dormons pas, nous n'avons pas le droit de dormir: le sommeil serait l'apprentissage de la mort et il faut que nous mourions debout dans l'innocence du devenir".
Maurice Blanchard
17:37 Publié dans Balises | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : maurice blanchard
05/03/2013
Lu 89 - André Velter, Zingaro suite équestre et autres poèmes pour Bartabas avec des dessins d'Ernest Pignon-Ernest, Gallimard
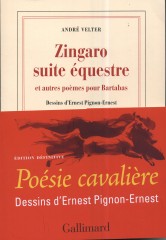 Il fallait lever la plume comme on lève le camp quand en est sur la route où c’est de l’âme qu’il s’agit. Il fallait cesser de tourner autour de cette « édition définitive » des poèmes d’André Velter pour Bartabas, Zingaro, suite équestre, qui va en quelques douze poèmes de la « violence cavalière » qui ouvre Cabaret , premier texte, à cette « vie en cavale » qui clôt Calacas, dernier texte. Il fallait s’engager sur ces « territoires fauves », passer de l’un à l’autre, au rythme des chevaux et de leurs cavaliers. Il fallait suivre les chevauchées de Bartabas, les mots d’André Velter et les dessins d’Ernest Pignon-Ernest. Suivre, oui, car c’est de de rythme qu’il s’agit, bien sûr. Ceux qui ont déjà assisté à ce qui n’est jamais simple spectacle mais ont partagé cette « forme de communion », ces rituels que met en jeu Bartabas, ses cavaliers, ses musiciens, ses danseurs et, bien sûr, en tout premier lieu, ses chevaux, ceux-là savent comment ces poudreuses chevauchées, ces syncopes, ces silences, ce martèlement du sol lèvent un printemps derrière eux. Ils savent avec André Velter que, comme le disait Joë bousquet, « le rythme est le père du temps » et qu’ « habiter cavalièrement le monde », comme le fait Bartabas et ceux de sa tribu, c’est l ‘habiter poétiquement, comme le voulait l’autre nomade enfermé dans sa tour sur le Neckar. Ils sauront combien les nombreux dessins d’Ernest Pignon-Ernest dans leur disposition même ne se contentent pas d’aérer les pages de ce livre mais en sont le souffle et la pulsation intime. De même que dans les représentations du « théâtre équestre » de Bartabas s’entend soudain cette « note bleue » qu’entendait George Sand quand Chopin jouait la nuit pour ses amis et qu’elle en faisait comme le moment où le temps semble se suspendre et la nuit se faire transparente, de même, dans ce livre, se tiennent dans l’harmonie de leurs irréductibles différences, les poèmes d’André Velter et les dessins d’Ernest Pignon-Ernest.
Il fallait lever la plume comme on lève le camp quand en est sur la route où c’est de l’âme qu’il s’agit. Il fallait cesser de tourner autour de cette « édition définitive » des poèmes d’André Velter pour Bartabas, Zingaro, suite équestre, qui va en quelques douze poèmes de la « violence cavalière » qui ouvre Cabaret , premier texte, à cette « vie en cavale » qui clôt Calacas, dernier texte. Il fallait s’engager sur ces « territoires fauves », passer de l’un à l’autre, au rythme des chevaux et de leurs cavaliers. Il fallait suivre les chevauchées de Bartabas, les mots d’André Velter et les dessins d’Ernest Pignon-Ernest. Suivre, oui, car c’est de de rythme qu’il s’agit, bien sûr. Ceux qui ont déjà assisté à ce qui n’est jamais simple spectacle mais ont partagé cette « forme de communion », ces rituels que met en jeu Bartabas, ses cavaliers, ses musiciens, ses danseurs et, bien sûr, en tout premier lieu, ses chevaux, ceux-là savent comment ces poudreuses chevauchées, ces syncopes, ces silences, ce martèlement du sol lèvent un printemps derrière eux. Ils savent avec André Velter que, comme le disait Joë bousquet, « le rythme est le père du temps » et qu’ « habiter cavalièrement le monde », comme le fait Bartabas et ceux de sa tribu, c’est l ‘habiter poétiquement, comme le voulait l’autre nomade enfermé dans sa tour sur le Neckar. Ils sauront combien les nombreux dessins d’Ernest Pignon-Ernest dans leur disposition même ne se contentent pas d’aérer les pages de ce livre mais en sont le souffle et la pulsation intime. De même que dans les représentations du « théâtre équestre » de Bartabas s’entend soudain cette « note bleue » qu’entendait George Sand quand Chopin jouait la nuit pour ses amis et qu’elle en faisait comme le moment où le temps semble se suspendre et la nuit se faire transparente, de même, dans ce livre, se tiennent dans l’harmonie de leurs irréductibles différences, les poèmes d’André Velter et les dessins d’Ernest Pignon-Ernest.
J’aime que ce livre réunisse trois hommes pour qui « la vie est la seule source » comme le voulait Reverdy, trois gardiens des révoltes fertiles qui savent « (tenir) la ténèbre en respect », qui savent « cabrer l’âme et le corps », « (allier) fureur et mystique ». Trois hommes de l’éphémère. Trois hommes qui savent accueillir ce quelque chose qui vient d’ailleurs - « là-bas déboule soudain / et c’est ici le cœur plus vaste » - quelque chose du côté de l’éternité quand elle se prend à aimer l’ici, la peau des hommes, des animaux et des choses. Trois hommes de l’acte, de ce qui reste vierge jusque dans la répétition. Quand le corps se risque dans la voix à telle ou telle occasion en compagnie de tel ou tel musicien pour André Velter, quand Ernest Pignon-Ernest parcourt telle ou telle ville de Soweto à Ramallah en passant par Nice, Alger, Durban, Naples…pour coller ses dessins là où ils s’ajustent à ce qui est et je ne dis rien de Bartabas, de son art, ce « théâtre équestre », où se conjuguent art équestre, musique et danse, de son nomadisme à travers les cultures et le monde, de ses plongées dans l’autrefois et ses marges, où c’est la vie que l’on chevauche, « à la verticale de soi ». Trois grands coureurs d’horizons qui n’existent pas. Trois témoins d’une cambrure, d’une posture : oui, on peut encore se tenir droit, debout sur les heures. Sur le seuil. Ses lueurs. Contre toutes les douleurs du monde, les froids, la mort !
11:25 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0)
Turbulence 59 - A propos du poète qatari Al Ajami
1 poème = 15 vers = 15 ans de prison
Démocratique, le Qatar ?
Le Qatar, troisième producteur de gaz au monde, s’occupe d’à peu près tout ce qui peut s’acheter : club de foot (le PSG) ; immeubles (Il se murmure même que les magasins Printemps seraient les prochains sur une liste déjà longue comprenant par exemple le Palais de la Méditerranée à Nice!).
Drôle de régime que celui de Doha ! D’une main – la corde qui soutient le pendu ? – il soutient le « printemps arabe » ; de l’autre, il condamne le poète Mohamed Ibn Al Dhib Al Ajami pour un poème dans lequel il avait écrit : « nous sommes tous la Tunisie face aux castes répressives ». Celle du cheikh Hamad Ben Khalifa Al Thani qui dirige le Qatar a dû se sentir tout particulièrement visé. Le 29 novembre 2012, Al Ajami était condamné à la prison à vie pour critique contre l’émir et incitation à la révolte. Ce jugement a été ramené à 15 ans d’emprisonnement il y a quelques jours. Quelle mansuétude !
On aimerait voir nos dirigeants politiques se montrer moins timorés dans leur critique. Même Delfeil de ton dans son billet du Nouvel Observateur du 14 février 2013 qui dénonce le qatar et ses pratiques n’en souffle mot !
Rappelons ces mots de Serge Pey : « Dans un pays où l’on emprisonne les poètes , seules les prisons sont libres » ! Ne laissons pas le Qatar et son or se payer la vie d’un poète !
Il faut relaxer et libérer le poète Al Ajami injustement condamné !
11:21 Publié dans Dans les turbulences | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : qatar, al ajami
04/03/2013
Lu 88- Ahuc, poèmes stratégiques de Serge Pey
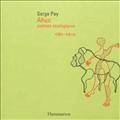 Ahuc, vous l’entendez ? Redoublez et faites bien sonner, dans les graves avec raucité, les « i » que l’on ne voit pas dans la graphie. C’est un cri. Sur l’Aubrac. Un cri vertical. Il monte depuis la terre d’avant. Dans la marge du monde, il se tient. Et résonne. Un cri qui ouvre les bouches et laisse passer de vieilles voix. C’est ainsi que du dessous surgit le vrai pays, un pays sans patrie égal à « une vieille fontaine de lumière » où l’homme, ce remous, aussi déroutant, aussi incertain qu’aux premiers jours, est toujours à venir.
Ahuc, vous l’entendez ? Redoublez et faites bien sonner, dans les graves avec raucité, les « i » que l’on ne voit pas dans la graphie. C’est un cri. Sur l’Aubrac. Un cri vertical. Il monte depuis la terre d’avant. Dans la marge du monde, il se tient. Et résonne. Un cri qui ouvre les bouches et laisse passer de vieilles voix. C’est ainsi que du dessous surgit le vrai pays, un pays sans patrie égal à « une vieille fontaine de lumière » où l’homme, ce remous, aussi déroutant, aussi incertain qu’aux premiers jours, est toujours à venir.
Ahuc, poèmes stratégiques…Diable, ce serait donc la guerre dans la langue ! Quelque chose de l’ordre de ce combat spirituel aussi brutal que la bataille d’hommes dont parlait le jeune homme depuis ses Ardennes ? Car enfin s’il y a stratégie c’est bien qu’il y a combat et objectif à la clef.
Défenseur de la poésie – celle qui se moque de la poésie, comme disait l’autre – « résistant du sens » et de l’homme, « guerrillero du poème sans espérance historique, » « ouvreur du sens, gardien et casseur du sens » tant les mots dans le poème fuient, échappent et filent devant en quête de leur signification et c’est là tout leur sens, tel est Serge Pey. Tel il se montre dans cette constellation de textes publiés entre 1985 et 2012 que reprennent aujourd’hui les éditions Flammarion qui ont la bonne idée d’accompagner cette reprise d’un DVD où l’on pourra entendre et voir Serge Pey écraser des tomates, dénoncer la torture en plaçant avec la lenteur qui convient à ces horreurs des erzats d’électrodes à cru sur un poulet, briser des vitres en proclamant que « dans un pays où les poètes sont enfermés dans les prisons, seules les prisons sont libres » - N’est-ce pas Messieurs du Quatar qui tenez dans les fers le poète Al Ajami !... 8 chapitres, 8 performances – on dit ça encore ? oui, on aime bien répéter…mais gare à la farce ! – Ici, et à chaque fois 8 actes. Et qu’est-ce qu’un acte sinon une affaire vitale, une expérience, cette traversée risquée, que l’on fait moins qu’elle ne nous fait et défait, où se risque de l’ homme le sujet qu’il ne se sait pas être !
La question, la seule peut-être, est celle qui tourne et retourne le fait de savoir comment se tenir debout. C’est la question même de la résistance. Avec Serge Pey, on sait. C’est par les pieds que ça commence ! - Les pieds comme fondement de la pensée, voire ? – Par le zapateado quand les pieds du danseur martèlent le sol jusqu’à déchirer l’âme pour laisser sa chance au duende, tapi au plus profond du sang, duende qui ouvre la bouche pour que passent ces « mots de passe pour la lumière » qui voient une porte dégondée devenir table pour les amis et cette même table devenir porte par où passera l’amour et l’amitié.
J’aime à imaginer Serge Pey demandant comme Emily Dickinson à Mr. Higginson à propos de ses vers, « sont-ils vivants ? » ? Eh bien oui, c’est dans la vie que déboulent les vers de Serge Pey, une vie où le poème est « toujours un souvenir de l’avenir ». Henri Meschonnic avait bien raison lorsqu’il affirmait que toute la poétique de Serge Pey était une poétique de la vie. D’une vie battante, combattante, en lutte contre toutes les semblances, les contrefaçons, les fétiches de la marchandise généralisée.
Que celui qui dit venir « des lisière de la Révolution Permanente et du soleil noir des anarchies » soit le bienvenu ! Qui dirait que nous n’avons pas besoin aujourd’hui de tels guerriers de l’imaginaire dont Patrick Chamoiseau disait qu’ils savaient que « la bataille sera sans fin, et de tout instant », qu’ »il ne devra jamais baisser la garde », que « c’est seulement cette veille qui fait de ce pacifique non-dominateur, un guerrier. »
Serge Pey, Ahuc, poèmes stratégiques (1985-2012), Flammarion, 25 euros
16:31 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : serge pey, ahuc, poésie, oeésie action, dvd
03/03/2013
Michel Ménaché à propos de Bienvenue à l'Athanée de Daniel Biga
 Avec son dernier recueil, Bienvenue à l’Athanée publié par les éditions de l'Amourier, collection Poésie (13 euros), Daniel Biga n’a rien perdu de sa pugnacité langagière, mêlant désinvolture et provocation avec une jubilation roborative (sinon ostentatoire !). Deux plaquettes antérieures sont reprises en ouverture : Histoire de l’air et Sept anges. Bigarraies, big Arrures et autres jeux de langue se dévident, démystifient les codes sociaux et culturels, brocardent « la dérisoire grandeur du poète ». Au vitriol, Biga se parodie lui-même dans le Praeambulus, intègre à ses élucubrations et fulgurances des bribes décrochées des textes d’auteurs tutélaires : « le vieux scribe convie ses frères et sœurs humains au partage des souffles, gâteuseries, bouffitudes de son existence jusqu’au bout du fini, se -et leur- souhaitant affectueusement cette inéluctable, et pour ce qui le concerne proche, « bienvenue à l’Athanée... » Dans les turbulences familières d’un Verre Again (Jean-Pierre Verheggen), « entre zut et zen », Dany Bibigaga désarticule les mots et la syntaxe, dynamite joyeusement son propre vécu revisité sous le feu de cocktails de mots Molotov… Toutefois la gravité et l’émotion percent sous le sarcasme, l’angoisse existentielle surgit au détour du calembour. L’auteur est « entré en écriture comme on entre en religion […] Quand la page et moi nous unissons - là est l’utopie et là est l’espoir - notre communion tend à l’absolu…» Et il se livre ou se masque à travers d’illustres voix tragiques dans le brouillage des pièces détachées de son puzzle bibliographique, sans ménagement excessif pour les gloires du panthéon universel : « sur la Route durant Cent années de Solitude moi aussi suis allé au Bout de ma nuit sur la page moi aussi Né et Mort à Venise moi aussi enculé par Notre-Dame des Fleurs moi aussi j’ai hurlé avec le Grizzli sur la Montagne Magique Lourde Lente moi aussi Possédé moi aussi Âme morte […] moi aussi Au-dessous du Volcan lisant l’écriture écrivant la lecture page noire comme page blanche ont l’Eternel à révéler. »
Avec son dernier recueil, Bienvenue à l’Athanée publié par les éditions de l'Amourier, collection Poésie (13 euros), Daniel Biga n’a rien perdu de sa pugnacité langagière, mêlant désinvolture et provocation avec une jubilation roborative (sinon ostentatoire !). Deux plaquettes antérieures sont reprises en ouverture : Histoire de l’air et Sept anges. Bigarraies, big Arrures et autres jeux de langue se dévident, démystifient les codes sociaux et culturels, brocardent « la dérisoire grandeur du poète ». Au vitriol, Biga se parodie lui-même dans le Praeambulus, intègre à ses élucubrations et fulgurances des bribes décrochées des textes d’auteurs tutélaires : « le vieux scribe convie ses frères et sœurs humains au partage des souffles, gâteuseries, bouffitudes de son existence jusqu’au bout du fini, se -et leur- souhaitant affectueusement cette inéluctable, et pour ce qui le concerne proche, « bienvenue à l’Athanée... » Dans les turbulences familières d’un Verre Again (Jean-Pierre Verheggen), « entre zut et zen », Dany Bibigaga désarticule les mots et la syntaxe, dynamite joyeusement son propre vécu revisité sous le feu de cocktails de mots Molotov… Toutefois la gravité et l’émotion percent sous le sarcasme, l’angoisse existentielle surgit au détour du calembour. L’auteur est « entré en écriture comme on entre en religion […] Quand la page et moi nous unissons - là est l’utopie et là est l’espoir - notre communion tend à l’absolu…» Et il se livre ou se masque à travers d’illustres voix tragiques dans le brouillage des pièces détachées de son puzzle bibliographique, sans ménagement excessif pour les gloires du panthéon universel : « sur la Route durant Cent années de Solitude moi aussi suis allé au Bout de ma nuit sur la page moi aussi Né et Mort à Venise moi aussi enculé par Notre-Dame des Fleurs moi aussi j’ai hurlé avec le Grizzli sur la Montagne Magique Lourde Lente moi aussi Possédé moi aussi Âme morte […] moi aussi Au-dessous du Volcan lisant l’écriture écrivant la lecture page noire comme page blanche ont l’Eternel à révéler. »
Dans la relation amoureuse, la femme à visage multiple, évanescent, interchangeable, s’inscrit dans la précarité de l’union, avec cette difficulté permanente pour l’auteur à s’identifier comme à se situer par rapport à l’autre, à lui reconnaître son autonomie et éprouver ou partager son ressenti : « là haut nous avons regardé vers le monde et les siècles dessous nous / ensemble / (moi qui ne suis qu’un homme seul et séparé ho sceso milioni di scale dandoti il braccio ( Eugenio Montale))… » Ou encore, quand le mystère s’obscurcit, tel Verlaine en son rêve étrange et familier, la confusion des sentiments s’ajoute à la crise identitaire : « une jeune femme m’accompagnait souvent différente / je m’en apercevais à peine / (mais moi aussi je n’étais pas toujours le même : qui étais-je ? plutôt qui était-il ? qui était-elle…) »
Dans Sept Anges, entre dérision et lyrisme distancié, Biga évoque « la merveilleuse mécanique du monde » et s’interroge entre détresse et tendresse sur le mode métaphorique : « L’homme serait-il la chrysalide de l’Ange ? »
Surtout, dans Bienvenue à l’Athanée, la causticité s’exacerbe sur le mode carnavalesque, avec des fantaisies langagières plus ou moins heureuses mais qui le plus souvent touchent juste. Ainsi sont débusquées (et non embouchées) « les tromperies de la renommée », épinglés « vents et vanités des zespoirs et zescroqueries », mis à nu « les zuts-topistes », réduits en pièces les « bouledogmes zinzintégristes » ou encore expéditivement vitupérés les « zinzin-quisiteurs… » Le discours s’égrène, grenade dégoupillée, en tornade ou par rafales, au risque de déboussoler et d’étourdir le lecteur…
Cette troisième séquence du recueil s’achève sur la fuite du temps et l’énumération des figures naguère familières de notre culture fourre-tout, celles de la scène et de l’écran ou de toutes les mythologies intimes, éclectiques, de notre génération : « En cinquante ans j’ai vu mourir un Monde… »
Depuis Les Oiseaux Mohicans, Daniel Biga a publié une trentaine de recueils. Ses jeux de langue insolents et décomplexés, en langue d’aïl, en rital, en pingouin, et autres zidiomes, apportent un souffle ravageur, à la diable, et redonnent le goût du rire (rabelaisien ?) dans notre paysage poétique qu’encombrent trop souvent des Pléiades de Trissotins désincarnés…
19:12 Publié dans Mes ami(e)s, mes invité(e)s | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ménaché, daniel biga, athanée, poésie
Balise 82 - à propos de la signification poétique
"Dans l'usage de la vie pratique, le langage est un instrument et un moyen de compréhension, il est la voie qu'emprunte la pensée et qui s'évanouit au fur et à mesure que s'accomplit le parcours. Mais, dans l'acte poétique, le langage cesse d'être un instrument et il se montre dans son essence qui est de fonder un monde, de rendre possible le dialogue authentique que nous sommes nous-mêmes et, comme dit Hölderlin, de nommer les dieux. En d'autres termes, le langage n'est pas seulement un moyen accidentel de l'expression, une ombre qui laisse voir le corps invisible, il est aussi ce qui existe en soi-même comme ensemble de sons, de cadences, de nombres et, à ce titre, par l'enchaînement des forces qu'il figure, il se révèle comme fondement des choses et de la réalité humaine."
Maurice Blanchot
18:53 Publié dans Balises | Lien permanent | Commentaires (2)
07/01/2013
Lu 87 - Bernard Noël, Le livre de l'oubli, P.O.L
 Le livre de l’oubli dont on avait pu lire des fragments dans le N°981-982 de la revue Europe de Janvier/février 2011 vient de paraître aux éditions P.O.L (10 euros). Cet ensemble de notes écrites en 1979 fait long feu d’une affirmation que l’on va répétant qui voudrait que la poésie soit fille de mémoire sans que jamais l’on ne s’interroge sur ce qu’il en est de ce qui pourrait bien n’être qu’un sépulcre. Il y a quelque chose de revigorant dans ce livre aux fusées aussi vives qu’éclairantes. Quelque chose du côté de la vie dans ce qu’elle a de moins recraché. Quelque chose qui arrache l’écriture à tous les enregistrements, toutes les reproductions imaginables pour la jeter du côté de « l’invention au sens archéologique du terme, c’est-à-dire de découverte. » Le Livre de l’oubli y insiste, il y a dès qu’il y a écriture, mise en route. Dès les premiers pas, la question du terreau sur lequel lève l’écriture se pose. Quel est ce sol où se trouve jeté celui qui écrit ? Lisant ce livre de Bernard Noël me revenait moins L’attente, l’oubli de Maurice Blanchot que le passage célèbre des Cahiers de Malte Laurids Brigge où Rilke fait dire à Malte que les vers ne sont pas des sentiments mais des expériences. On se souvient que Rilke insistait sur le fait que ce n’était pas encore assez d’avoir des souvenirs mais qu’il fallait surtout savoir les oublier ! Savoir les porter en terre d’oubli et qu’ils y perdent jusqu’à leur nom, ajoutait-il, afin qu’ils « deviennent en nous sang, regard, geste ». C’est alors qu’ étincelait le beau paradoxe que lançait Bernard Noël: « l’oubli est notre pays natal. »
Le livre de l’oubli dont on avait pu lire des fragments dans le N°981-982 de la revue Europe de Janvier/février 2011 vient de paraître aux éditions P.O.L (10 euros). Cet ensemble de notes écrites en 1979 fait long feu d’une affirmation que l’on va répétant qui voudrait que la poésie soit fille de mémoire sans que jamais l’on ne s’interroge sur ce qu’il en est de ce qui pourrait bien n’être qu’un sépulcre. Il y a quelque chose de revigorant dans ce livre aux fusées aussi vives qu’éclairantes. Quelque chose du côté de la vie dans ce qu’elle a de moins recraché. Quelque chose qui arrache l’écriture à tous les enregistrements, toutes les reproductions imaginables pour la jeter du côté de « l’invention au sens archéologique du terme, c’est-à-dire de découverte. » Le Livre de l’oubli y insiste, il y a dès qu’il y a écriture, mise en route. Dès les premiers pas, la question du terreau sur lequel lève l’écriture se pose. Quel est ce sol où se trouve jeté celui qui écrit ? Lisant ce livre de Bernard Noël me revenait moins L’attente, l’oubli de Maurice Blanchot que le passage célèbre des Cahiers de Malte Laurids Brigge où Rilke fait dire à Malte que les vers ne sont pas des sentiments mais des expériences. On se souvient que Rilke insistait sur le fait que ce n’était pas encore assez d’avoir des souvenirs mais qu’il fallait surtout savoir les oublier ! Savoir les porter en terre d’oubli et qu’ils y perdent jusqu’à leur nom, ajoutait-il, afin qu’ils « deviennent en nous sang, regard, geste ». C’est alors qu’ étincelait le beau paradoxe que lançait Bernard Noël: « l’oubli est notre pays natal. »
Oui, ce que nous appelons mémoire est bien du côté du savoir, du côté de l’espace, un beau palais du genre « nécropole où reposent le déjà vu, le déjà pensé, le déjà vécu ». Avec l’oubli commence le temps, s’ouvre le labyrinthe des pièces disjointes, les lignes brisées d’un dédale où descendre. Là brille un autre soleil, « celui d’en bas. Le soleil d’en dessous » écrit Bernard Noël. C’est dans cette terre là que l’écriture fouille. Là est son chantier. C’est là qu’elle invente chemins et lieux tels qu’ « apparaisse là ce qui n’a jamais existé ailleurs et n’existera jamais autrement. »
« Rentrer dans l’oublié », c’est affronter l’inconnu, cela qui en nous est « lié au plus vif ». De l’oubli, Bernard Noël écrit qu’ « il est la vie même ». La vie et son désordre. Cela qui ramené au jour et même dérobé, confisqué par sa trop grande lumière, vient déranger ce monde où l’on sait, croit savoir, fait semblant de savoir. Notre monde ! Monde où « le pouvoir est assuré du présent ». Du temps sur lequel il règne en propriétaire, en contrôleur qui à le tourner toujours vers l’avenir, ne le tourne jamais que vers la mort. C’est bien ce qui nous bouleverse dans la lecture de ces textes où « l’écriture est l’expérience de l’oubli ». On y rencontre des mots qui « sont un regard / ils sortent du noir en cherchant des yeux / ils voudraient voir ce qu’ils disent ». On y entend battre de l’humain en formation. Il y a là des « (textes) qui ne sont pas dans les mots, bien qu’il n’y ait pas de texte sans mots. ». Ce sont les textes que nous aimons. Ils ont toujours un ton. Il ne trompe jamais. Il est celui d’une « écriture poétique » qui nous « mène au plus loin, vers un là-bas qui est aussi ce qui vient ».
10:12 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (1)
Balise 81 - Walter Benjamin et l'Angelus Novus de Paul Klee
« L’ange de l’histoire […] a le visage tourné vers le passé… Il voudrait s’attarder,réveiller les morts,  rassembler ce qui fut détruit. Mais une tempête souffle du paradis […] qui l’entraîne irrésistiblement vers ce futur auquel il tourne le dos. […] Cette tempête, voilà ce que nous appelons le progrès. »
rassembler ce qui fut détruit. Mais une tempête souffle du paradis […] qui l’entraîne irrésistiblement vers ce futur auquel il tourne le dos. […] Cette tempête, voilà ce que nous appelons le progrès. »
Et nous restons là pris dans les vents contraires...
10:09 Publié dans Balises | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : walter benjamin, paul klee, angelus novus
Turbulence 58 - Revenir au livre...
« Je représente l'humanité telle que ses maîtres l'ont faite. L'homme est un mutilé. Ce qu'on m'a fait, on l'a fait au genre humain. On lui a déformé ldroit, la justice, la vérité, la raison, l'intelligence, comme à moi les yeux, les narines et les oreilles ; comme à moi, on lui a mis au coeur un cloaque de colère et de douleur, et sur la face un masque de contentement. Où s'était posé le doigt, de Dieu, s'est appuyée la griffe du roi. Monstrueuse superposition. Évêques, pairs et princes, le peuple c'est le souffrant profond qui rit à la surface. Mylords, je vous le dis, le peuple, c'est moi. Aujourd'hui vous l'opprimez, aujourd'hui vous me huez. Mais l'avenir, c'est le dégel sombre. Ce qui était pierre devient flot. L'apparence solide se change en submersion. Un craquement, et tout est dit. Il viendra une heure où une convulsion brisera votre oppression, où un rugissement répliquera à vos huées. (...) Tremblez. Les incorruptibles solutions approchent, les ongles coupés repoussent, les langues arrachées s'envolent, et deviennent des langues de feu éparses au vent des ténèbres, et hurlent dans l'infini ; ceux qui ont faim montrent leurs dents oisives, les paradis bâtis sur les enfers chancellent, on souffre, on souffre, on souffre, et ce qui est en haut penche, et ce qui est en bas s'entrouvre, l'ombre demande à devenir lumière, le damné discute l'élu, c'est le peuple qui vient, vous dis-je, c'est l'homme qui monte, c'est la fin qui commence, c'est la rouge aurore de la catastrophe, et voilà ce qu'il y a dans ce rire, dont vous riez ! »
Victor Hugo, L'Homme qui rit (1869)
10:03 Publié dans Dans les turbulences | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : victor hugo
Michel Ménaché à propos de Benjamin fondane: 2 livres
Benjamin Fondane, poète juif assassiné, a porté vivant sa mort en bandoulière : « La mort était somnolente, oublieuse, / oubliée nappe d’eau enfouie dans l’âme - / et SOUDAIN elle vint, elle coula en moi / comme le lait vivant dans le sein de la femme. » (Ulysse) La mort carnassière et l’errance apatride, comme destin ou comme malédiction : « Tout seul je suis la route humaine. » La métaphore creuse son sillon dans toute l’œuvre poétique, tragiquement interrompue en 1944 : « Juif, naturellement, tu étais juif Ulysse… » De la mystique juive à la révolte existentielle, suivre Fondane, c’est d’abord se garder des raccourcis à l’emporte pièce, aller au-delà des lectures fragmentaires du poète de « l’expérience du gouffre. » (Publication posthume : Baudelaire et l’expérience du gouffre). Et c’est désormais possible.
Après Le mal des fantômes, ouvrage réunissant l’œuvre poétique écrite en français, préfacé par Henri Meschonnic (éd. Verdier, 2006), les premiers poèmes en roumain, suivis de Le Reniement de Saint-Pierre sont enfin disponibles. Ces textes concernent la période 1917 – 1923.
La Bible est le creuset des premiers thèmes développés par le jeune poète habité par le destin singulier des populations juives depuis la diaspora et les mythes fondateurs. Dans Ultima verba – Le chant de Samson : « dans mon sang bouillonnant, tel un torrent de lave, / jaillissait, suave, / l’impérieuse verve de mon aïeul Adam. » Le poète prête à Samson un lyrisme effervescent, charnel, pour célébrer, avant la mort, sans la nommer, le corps éblouissant de celle qui le livra aux Philistins : « Oh ! / tu as dans le corps le parfum des nefs océanes, / dans tes yeux et, tels la fleur du citronnier, tes cheveux, / dans tes yeux, / ensanglanté, le crépuscule embrase son corail. / Dans ton corps, comme en automne, les bourgeons souverains / ont rompu tant de digues, ont éclaté plus vivants, / comme les grappes rouge sang / du raisin. » Solitude encore, sentiments d’exclusion et d’humiliation, son propre corps perçu comme souillure de la terre, dans Le psaume du lépreux : « Qu’ai-je fait, Seigneur, pour que tu ravages d’abcès / tout mon corps, comme les crapauds de pustules - / en quoi ai-je péché - […] pour que même tes petits enfants me jettent des pierres, / et pour que les vierges aux hanches fermes, / avec effroi détournent leur visage de moi. » Symbolisme sombre ou lumineux dans des monologues intenses, tel celui de Balthasar, ce roi qui veut donner sa fille à Daniel mais s’adresse à un interlocuteur absent : « Les hommes sont-ils devenus des illusions ? / Ou bien mon cerveau engendre-t-il des hommes ? / […] j’en suis venu à converser / avec les ombres ? » Images paradoxales, oxymores insolites, comme dans Le Psaume d’Adam : « Ma terre est encore mouillée de soleil… »
Fondane est Samson révolté, Adam, acceptant le sacrifice d’Abel, Balthasar dans l’obscurité, David amoureux, le lépreux dans sa détresse, etc. Prophétique, il questionne l’Univers, apostrophe Dieu, comment se peut-il que « le plus cruel des fauves, / il le gorge de chair humaine… »
La série des Paysages développe des élans panthéistes comme autant de miroirs intimes, la pluie, l’argile et l’âme en abyme, la solitude en archipel : « Je n’attends que la pluie et personne d’autre à ma porte. » Ou encore, privé des quatre fleuves coulant autour du jardin d’Eden, il les évoque jusqu’au dernier : « L’Euphrate soufflant dans les narines des crocodiles. » Des images somptueuses émaillent les évocations : « Sur les emblavures le maïs roussit / dans la fournaise d’or de la sécheresse. »
Riche de symboles forts, de tournures anaphoriques, lancinantes parfois, cette écriture toute pénétrée de culture biblique n’en est pas moins chargée d’émotions intime, d’angoisses existentielles vécues à travers les voix mythiques de l’Ancien Testament. La traduction rend compte de ces connotations mystiques en fusion avec la tonalité charnelle des poèmes. Toutefois était-il nécessaire d’imposer la rime dans la version en français de quelques uns des poèmes de facture plus traditionnelle. Cela aboutit parfois à des choix artificiels ou pour le moins contestables : « les arbres… oblongs » pour rimer avec « étalon » ! ou encore « la démarche monotone » pour rimer avec « automne. »
Les Evangiles puisant dans le même terreau historique et mythologique nourrissent aussi ces premiers écrits de Fondane en roumain. Fondane se réclame alors de l’art pour l’art et prétend composer Le Reniement de Saint-Pierre comme une exégèse, voire un essai d’« éclaircissement sur le symbolisme. » Le triple déni de Pierre d’être un disciple de Jésus l’amène à se comparer à Judas. Si Judas a trahi Jésus pour trente pièces d’argent, Pierre confie : « Moi, je t’ai vendu pour rien. » L’œuvre qui se veut « amorale » est un monologue entrecoupé de dialogues mettant en scène l’apôtre avec des serviteurs, puis Simon, en incluant l’épisode de l’oreille de celui-ci tranchée par Pierre lors de l’arrestation de Jésus et qu’il vient lui réclamer ! S’il veut sauver Pierre, c’est qu’il est convaincu que le miracle de la restitution est possible… Ce qui intéresse ici Fondane est moins le point de vue évangélique que ce qui est en train de basculer à l’intérieur même du judaïsme ébranlé par l’occupation romaine.
Le court essai de Jérôme Thélot : Ou l’irrésignation / Benjamin Fondane (l’inversion des termes du titre constitue une première interrogation en suspens !) présente Fondane, penseur existentiel, insurgé contre la mort, s’inscrivant dans la grande tradition prophétique juive, prenant parti pour Artaud contre Breton, poète avant d’être philosophe, « au plus près de sa fureur, » ami et disciple de Léon Chestov. Le philosophe, Léon Chestov, en effet, guida les lectures du poète, son unique disciple, lit-on parfois, tant le destin de ces deux exilés solitaires fut proche. Jérôme Thélot précise que la « conscience malheureuse » exaltée qui caractérise toute l’œuvre de Benjamin Fondane, est une formule détournée de l’œuvre de Hegel. La condition humaine, telle que la perçoit le poète est « bornée par la mort, vouée à l’impuissance, condamnée à l’insatisfaction du désir et de la volonté, privée de plénitude et de liberté, soustraite à la vérité. » Pensée paradoxale qui vise à se libérer du malheur par la conscience même du malheur. Jérôme Thélot désigne les textes de Fondane comme des « torpilles bricolées de nuit » ou encore, réduit-il sa pensée éruptive à la « forme égarée d’un pénible entêtement, » et sa démarche intellectuelle, « au malheur comme méthode. » Si de telles affirmations sont pertinentes pour éclairer certaines facettes de l’œuvre, reformuler ainsi une pensée poétique est une gageure, aussi n’est-il pas étonnant qu’on se heurte là aux limites mêmes de l’analyse textuelle et que l’auteur de l’essai s’enlise quelque peu lui-même dans « le piège des postures antithétiques » du poète. En revanche, nous le suivons mieux quand il reconnaît en Fondane « l’héritier le plus juste » de Baudelaire et Rimbaud : « La sollicitude saura voir en particulier dans les coups de bélier du poète contre le mur des évidences, dans ses précipitations tête haute contre le principe de réalité, non pas des équivoques de sa colère ni des butées de son ressentiment, mais les suppliques fragiles – religieuses – et les sanglots d’une prière à la fin bouleversante. » La balance sensible de la prosodie et de l’affectivité mesure mieux dans l’œuvre de Fondane ce que les limites de l’exégèse systémique conduisent à appréhender parfois sur un mode réducteur, voire écrasant.
Fondane a exploré l’intranquillité permanente, il a ressenti (comme René Char) les limites de l’ascension furieuse du poème : « J’ai voulu être de cœur avec mon temps, de chair avec l’histoire. Pourquoi cette pente me fut-elle refusée ? » Son temps lui a arraché le cœur, l’histoire a réduit sa chair en cendres… Il avait vu très tôt monter la déferlante des périls.
Benjamin Fondane : Poèmes d’autrefois (traduits du roumain par Odile Serre), Ed. Le temps qu’il fait 17 euros
Jérôme Thélot : Ou l’Irrésignation / Benjamin Fondane, Ed. Fissile – Cendrier du voyage 8 euros
Note de lecture paru dans la Revue EUROPE n° 974-975 (juin-juillet 2010)
09:57 Publié dans Mes ami(e)s, mes invité(e)s | Lien permanent | Commentaires (0)




