01/11/2011
Tomas Tranströmer prix Nobel de littérature 2011 - Poète!
Dans le très beau numéro que la revue Europe consacrait au philosophe Jacques Derrida en mai 2004 – quelques mois avant sa mort – celui-ci disait à Evelyne Grossman qui l’interrogeait sur la vérité blessante propre à tout acte d’interprétation ceci : « traduire, c’est perdre le corps. La traduction la plus fidèle est une violence : on perd le corps du poème ».Et certes, mais on gagne aussi un poète[1], soit quelqu’un qui ne se contente pas de venir avec des mots, alourdis de significations figées – comme tant d’hommes de ce temps misérable – mais avec un langage soit un acte de parole où la langue se trouve remuée, retournée, mise à mal parfois mais amoureusement toujours, un langage comme ces « traces de pattes d’un cerf dans la neige » sur lesquelles tombe le poète un jour de grand écart.
Tomas Transförmer est né à Stockholm en 1931. Ce suédois, par ailleurs grand voyageur, est l’homme d’un espace et d’un temps , il est d’ici et de maintenant, pris dans le mystère des signes, la présence massive et têtue des choses, l’ombre portée des actes des hommes. Poète, il se débat en plein réel au moyen de l’image qu’il n’utilise jamais comme le double fantômatique des choses, mais comme le procès qui permet à l’homme de se situer dans le monde parmi les choses, les cercles dans lesquels elles trouvent à se répartir et qui chez lui interfèrent : la ville et la forêt par exemple, ces deux données de la réalité suédoise :
« Le ciel éclatant s’incline contre la muraille.
C’est comme une prière qu’on adresse au vide.
Et le vide tourne son visage vers nous
Et murmure :
« Je ne suis pas vide, je suis ouvert ».
On comprend que Tomas Transförmer ait été conduit tout naturellement à la pratique du haïku, cette forme brève japonaise qui s’efforce non d’habiller le monde d’images et de figures mais de le laisser être sans peser sur lui du bout de quelques mots. Mots poreux – véritables puits artésiens – par où remonte le « ah ! » des choses quand, étonnées, elles surgissent comme elles sont dans leurs rapports mutuels :
« On marche longtemps et on écoute et on arrive à un moment
où les frontières s’ouvrent
ou plutôt
où tout devient frontière »
La lecture des haïkus de Tomas Transförmer transporte entre les choses, là où c’est la chair du monde qui palpite entre diastole et systole. Son énigme. Ce silence tout vibrant d’intensité. Cela qui nous faut !
[1] Saluons à ce propos Le Castor astral – Et à travers lui les petites maisons d’édition dans leur rôle irremplaçable de passeur de littérature vivante ! – qui dès 1966 s’est attaché à publier ses œuvres. Signalons que si les haïkus de La grande énigme sont bien repris dans Baltiques, Les souvenirs m’observent restent disponibles au Castor astral.
21:53 Publié dans Du côté de mes interventions, Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0)
Lu 70 - Jean-Vincent Verdonnet - Dernier Fagot (Rougerie)
L’âge avance. Le soir descend sur une vie en poésie. Celle de Jean-Vincent Verdonnet qui selon les mots d’Yves Bonnefoy « (aida) la terre à continuer d’être, le langage à ne pas être seulement le gravât des mots dans ses retombées indifférentes », fut en tout point exemplaire.
Il nous apporte aujourd’hui grâce à la fidélité des éditions Rougerie son Dernier fagot. J’aime cette image  des poèmes/sarments que le poète à liés, javelle qu’il offre au lecteur pour qu’il y porte le feu d’une lecture fervente. Chaleur et lumière contre tous les froids, au cœur de toutes les nuits.
des poèmes/sarments que le poète à liés, javelle qu’il offre au lecteur pour qu’il y porte le feu d’une lecture fervente. Chaleur et lumière contre tous les froids, au cœur de toutes les nuits.
J’ai toujours au détour d’un poème entendu « cette voix de la lumière absente ». Quand les yeux se taisent, on peut l’entendre. Et l’entendre, c’est l’entrevoir. Les yeux quittent le livre, s’ouvre alors comme la porte du jardin de derrière sur l’image mentale d’un oiseau « ivre de ciel (…) ouvrant de son aile le soir » ou ce travail au rouge du soleil « dans l’eau du lac » à l’aide de son « tisonnier » invisible ou encore cette « pâleur automnale / qui (s’attarde) dans les allées / en deuil du clos à l’abandon ». Et c’est la porte du temps qui s’entrouvre l’espace d’un instant où se brise jusqu’au silence. Entre l’éternité, ce Fugitif éclat de l’être comme l’écrivait Jean-Vincent Verdonnet en 1987, pour une visite où être et vision s’épousent l’espace d’un saisissement qui se dérobe déjà. Règne à nouveau la séparation, la distance, le chemin devant, toute piste perdue.
Si « rien ne saura mieux dire l’âme / que le feu menacé d’une rose / annonce de tous les départs », dans ce Dernier fagot, c’est la mélodie d’une âme qui se trouve renouée et se donne à entendre. L’âme est sur la route disait Gilles Deleuze. On l’entend marcher dans ce dernier livre de Jean-Vincent Verdonnet, apaisée, assurée de son pas vers « les terres / où n’a pas de fin le sommeil » et où « la compassion des neiges » attend le voyageur.
21:43 Publié dans Du côté de mes interventions, Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0)
Lu 69 - In Memoriam Jorge Semprun - L’écriture ou la vie, Gallimard, 1996
Jorge Semprun, l’intellectuel, le rescapé des camps de la mort, l’homme politique –membre du PCE – clandestin sous Franco, le scénariste de Resnais ou Costa-Gavras ; plus tard, ministre de la Culture dans le gouvernement de Felipe Gonzales, l’écrivain - Maurice Nadeau, l’éditeur, le découvreur, le directeur de la « Quinzaine Littéraire », dont on fête le centenaire de son vivant cette année, parlait d’autant de déguisements – vient de mourir. La mort dont il était revenu, rescapé du camp de Büchenvald où il avait été interné après son arrestation par la Gestapo en 1943, l’a rattrapé le 07 juin 2011 à Paris.
 Quel autre hommage rendre à cet homme sculpté par tous les vents de la deuxième moitié du XX siècle, cet homme qui a eu, selon les mots du poète Jean Cayrol, arraché lui du camp de Mauthasen, « l’étrange privilège d’être né deux fois », que d’engager à lire ce livre « essentiel, nécessaire, vital » selon les mots de Thierry Guichard dans « Le Matricule des anges » : L’écriture ou la vie.
Quel autre hommage rendre à cet homme sculpté par tous les vents de la deuxième moitié du XX siècle, cet homme qui a eu, selon les mots du poète Jean Cayrol, arraché lui du camp de Mauthasen, « l’étrange privilège d’être né deux fois », que d’engager à lire ce livre « essentiel, nécessaire, vital » selon les mots de Thierry Guichard dans « Le Matricule des anges » : L’écriture ou la vie.
Survivre à 18 mois de Büchenvald, avoir traversé l’expérience du « mal radical », être plein de l’odeur de la mort, avoir dans les yeux la fumée des crématoires, les cadavres entassés…choisir d’abord la vie contre l’écriture. Choisir la voie de l’oubli, l’amnésie. Pour se garder en vie, «éviter les mots sur le papier. L’écriture ramenait hier, traînait hier jusqu’à aujourd’hui, emplissait le jour de la nuit d’hier. Semprun choisira le chemin inverse de Primo Levi qui, lui, crut se sauver par les chemins de l’encre. Il choisira d’échapper au passé, de l’enfouir sous des pelletées de vie – Et combien furent risquées les 10 années de militantisme clandestin en Espagne dans les rangs du PCE !
Mais telle est la ruse de l’oubli que d’avoir fait de tout ce passé le sang même de sa vie. Il suffira d’un heurt, d’un coup, d’un hasard, d’une rencontre pour fasse retour la vérité - Et ce sera la conjonction de deux occasions en 1987 : la commémoration de la libération des camps et la mort de Primo Levi qui rendront possible la réappropriation des souvenirs, la tâche d’écrire un récit où l’informulable pourrait prendre forme, trouver « le taux d’artifice nécessaire pour élever mon livre au rang d’œuvre d’art », trouver « un je de la narration, nourri de mon expérience mais la dépassant, capable d’y insérer de l’imaginaire, de la fiction, une fiction qui serait aussi éclairante que la vérité ».
C’est cela que Semprun réalise dans L’écriture ou la vie : montrer qu’ « il n’y a que l’écriture, il n’y a que les écrivains qui soient capables de maintenir vivante la mémoire de la mort ». Et c’est libérer de la vie cela.
Fabriquer de la vie à partir de la mort, l’écriture le peut. Fabriquer de l’humain.
C’est là la force des poèmes. Vous ne pourrez pas lire le récit de la mort de Maurice Halbwachs, philosophe, ou celle de Morales, militant communiste espagnol sans être jeté à la renverse. Bouleversé. Ils meurent, réduits par la dysenterie à n’être plus que viande pestilentielle et le jeune Semprun, perdu, ne trouvera que les mots de Baudelaire pour l’un et ceux de Cesar Vallejo pour l’autre. Et aux lèvres comme dans les yeux des mourants une étincelle, un sourire par où toute l’humanité réussit à passer.
A quoi sert la poésie ? à ça !
21:41 Publié dans Du côté de mes interventions, Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0)
10/04/2011
Lu 64 - Les poètes de la méditerranée, Anthologie - Poésie / Gallimard
 Cette Anthologie établie par Eglal Errera regroupe 4 générations de poètes contemporains tous « amarrés à leur langue » ; 17 langues, 5 alphabets – Notons , et c’est là la première originalité de cette édition, que figurent, face à face, le poème en sa langue originelle en regard de sa traduction française ; 24 pays : des villes, des ports, des îles… ; un traitement égal de 5 pages est réservé aux 101 poètes comme on dit les « mille et une nuits », histoire de faire signe vers cet inachevable caractéristique de l’entreprise.
Cette Anthologie établie par Eglal Errera regroupe 4 générations de poètes contemporains tous « amarrés à leur langue » ; 17 langues, 5 alphabets – Notons , et c’est là la première originalité de cette édition, que figurent, face à face, le poème en sa langue originelle en regard de sa traduction française ; 24 pays : des villes, des ports, des îles… ; un traitement égal de 5 pages est réservé aux 101 poètes comme on dit les « mille et une nuits », histoire de faire signe vers cet inachevable caractéristique de l’entreprise.
C’est à un voyage que nous convie Eglal Errera en accord en cela avec le titre même de la belle préface d’Yves Bonnefoy : « moins une mer que des rives ». Ainsi on part d’Athènes vers l’est : Turquie, Israël , monde arabe avant de remonter via l’Espagne, la France, l’Italie vers la Macédoine, ouest où le soleil décline.
On parcourt des terres, plus qu’on ne navigue. C’est l’autre originalité de cette anthologie que d’avoir choisi non la mer et ses appels répétés vers l’ailleurs ; non l’ivresse poétique de l’au-delà des Colonnes d’Hercule aimantée par cette « île des bienheureux » dont parlait Pindare et qu’évoque Yves Bonnefoy lorsqu’il nous rappelle comment l’Ulysse de Dante finira par naufrager et se perdre lors de son second voyage en atlantique, mais bien la Méditerranée comme creuset de rencontres, chaudron d’échanges, lieu de comptoirs où le langage, les langues qu’on parle sur ces rives se trouve mis au centre et donc, en sa pointe, la poésie, « expérience fondatrice » écrit Yves Bonnefoy, pour la Méditerranée : la poésie comme mémoire de l’être, comme ce qui entend défendre l’idée que s’il y a certes encore de l’attrait pour l’Eurydice noire, perdue, il y a aussi, ici et là, sous le ciel, des choses, des êtres et leurs infinies relations à préserver des ravages du discours des médias comme de la pensée conceptuelle.
On ne trouvera pas dans cet ouvrage quelque pâle et mauvais accord de circonstance sous prétexte d’une Mare Nostrum et d’une lumière que l’on pourrait croire celle des premiers matins du monde . Ici, chaque poète dit à sa manière et dans sa langue cette terre de contrastes, cette réalité déchirée où pourtant chacun ancre son identité irremplaçable avant de dire ce que Salah Stétié appelle « la prodigieuse nuance séparée ».
La Méditerranée comme une chambre d’échos, une caisse de résonance. Résonance ? ce qui importe en poésie, non ?
Alain Freixe
16:09 Publié dans Du côté de mes interventions | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : méditerranée, anthologie, poésie, yves bonnefoy
Lu 63- Les temps suspendus de Michel Butor, Henri Maccheroni et Bertrand Roussel
Trois hommes, trois sensibilités, trois regards : le scientifique, l’artiste et le poète. Trois contemporains croisent leurs pratiques – Bertrand Roussel, directeur des collection du muse de paléontologie humaine de Terra Amata à Nice, curieux de de création contemporaine ; Henri Maccheroni dont les toiles et les photographies le montrent depuis longtemps intéressé par l’archéologie ; Michel Butor et son œuvre ouverte à tous les défis, toutes les routes – dans un beau livre fort bien publié par les éditions Mémoires Millénaires (www.memoiresmillenaires.com) . On y remonte le temps de l’âge des métaux (il y a environ 5000 ans) de la Vallée des Merveilles, au pied du Mont Bego, non loin de Casterino au jurassique supérieur (il y a près de 150 millions d’années) du plateau Saint-Barnabé, près de Coursegoules en passant par le site de Terra Amata du Paleolithique inférieur (il y a 400000 ans) à Nice.
Des millénaires de feu, d’orage, de neige, de gel, de pluie, battus à tous les vents sont ainsi pris en écharpe par ces « fouilleurs ».
J’aime que ce livre pousse ses pages à la manière de l’archéologue qui du plus récent va vers le plus enfoui : ici, de l’écriture du graveur des Merveilles à celle de la erre sur elle-même du plateau de Saint-Barnabé en passant par les traces des foyers, premiers témoins de la domestication du feu dans le monde.
C’est le même geste qui unit les trois auteurs : découvrir en enlevant, dégager, tirer hors de et porter au jour sur les rivages de la lumière l’enfoui. Ainsi Henri Maccheroni revisite-t-il d’une belle et leste manière en des lavis rehaussés les gestes des graveurs de la vallée des Merveilles.
Trois chantiers de fouilles dialoguent ici, chacun constituant ce qui reste comme objet de pensée.
Qu’est-ce qu’il reste, finalement ?
Nulle relique, ni fétiche, des dépôts tournés – merveille ! – vers un futur et non un passé, à vénérer tel quel. À trois, ils refont le paysage. Et le lecteur devient le « pays », le passant. L’éternité – pas la sempiternalité ! – peut venir s’y prendre. Les ouvrages du temps ainsi revisités l’attendent. C’est ce temps hors du temps, ce « temps suspendu » qui traverse ces restes et, passant, les font vibrer les portant plus loin, jusqu’à demain.
15:21 Publié dans Du côté de mes interventions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : archéologie, michel butor, henri maccheroni, bertrand roussel
02/01/2011
Lu 56 - Henri Michaux, Poteaux d'angle, Poésie/Gallimard, N°400, 2004
Je connaissais le Poteau d’angle paru en 1971 aux éditions de l’Herne – je revois le mince volume à couverture rouge – j’avais raté les ajouts parus en 1978 chez Fata Morgana et négligé les nouveaux Poteaux – Deux grandes balises et un poème final de « retour à l’effacement / à l’indétermination », paru en 1981 chez Gallimard.
 Pourquoi ai-je emmené avec moi, dans mes montagnes, ce livre republié en 2004 dans la collection Poésie/Gallimard, 400ème volume de la collection ? Sûrement à cause de son titre – ce trou qui permet au regard de pénétrer comme à l’avance - et parce que feuilleté j’y ai reconnu ce style lapidaire dont les éclats sont toujours des événements pour le corps, enfin parce que je connaissais Henri Michaux, la fascinante singularité nos regards et cadastre nos chemins dans le paysage poétique du XXème siècle de ce désorienteur, qui à nomadiser en ses propriétés, nous jette toujours à côté, dans la question et l’énigme. Je sais maintenant qu’il répondait à une attente, attente que la parole qui brûle dans ce mince ouvrage ne saurait combler mais aguiserait au contraire : « non, non, pas acquérir, écrit Henri Michaux. Voyager pour t’appauvrir. Voilà ce dont tu as besoin. » L’étrange leçon ! Si contraire à tout ce qui grillage: « toute une vie ne suffit pas pour désapprendre, ce que naïf, soumis, tu t’es laissé mettre dans la tête – innocent ! – sans songer aux conséquences » et si tonique pour traverser nos temps incertains où garder une posture humaine, rester ouvert à de l’humain en formation, est la question, le « grand combat » et l’insoumission, toujours le chemin vers une « paix dans les brisements ».
Pourquoi ai-je emmené avec moi, dans mes montagnes, ce livre republié en 2004 dans la collection Poésie/Gallimard, 400ème volume de la collection ? Sûrement à cause de son titre – ce trou qui permet au regard de pénétrer comme à l’avance - et parce que feuilleté j’y ai reconnu ce style lapidaire dont les éclats sont toujours des événements pour le corps, enfin parce que je connaissais Henri Michaux, la fascinante singularité nos regards et cadastre nos chemins dans le paysage poétique du XXème siècle de ce désorienteur, qui à nomadiser en ses propriétés, nous jette toujours à côté, dans la question et l’énigme. Je sais maintenant qu’il répondait à une attente, attente que la parole qui brûle dans ce mince ouvrage ne saurait combler mais aguiserait au contraire : « non, non, pas acquérir, écrit Henri Michaux. Voyager pour t’appauvrir. Voilà ce dont tu as besoin. » L’étrange leçon ! Si contraire à tout ce qui grillage: « toute une vie ne suffit pas pour désapprendre, ce que naïf, soumis, tu t’es laissé mettre dans la tête – innocent ! – sans songer aux conséquences » et si tonique pour traverser nos temps incertains où garder une posture humaine, rester ouvert à de l’humain en formation, est la question, le « grand combat » et l’insoumission, toujours le chemin vers une « paix dans les brisements ».
Il y a un côté « manuel » dans ce livre, un côté « pensées », un stoïcisme travaillé par le Tao d’où cet ensemble de sentences écrites par un « barbare » qui serait passé par l’Asie. La tenue d’Henri Michaux y est toujours originale. C’est celle d’un aventurier de l’intérieur : « tu veux apprendre ce qu’est ton rôle ? Décroche. Retire-toi en ton dedans. Tu apprendras tout seul ce qui est capital pour toi car il n’est pas de gourou pour ce savoir ».
Ces Poteaux d’angle sont comme autant de bornes qui ne bornent pas, ils ne cadrent que l’écart, l’affût, la préparation au bond, au saut de côté. De ce côté-là sont nos lointains, inatteignables bien sûr, nous vouant à une marche interminable au point que « la mort cueillera un fruit encore vert ».
Ces Poteaux d’angle servent tout au plus à délimiter des champs jonchés de cailloux, de rocs. Ce sont des vergers de pierres car selon la leçon de Lao-Tseu, ces injonctions sont des fruits. À peler !
Allez ramasser ces pierres, cueillir ces fruits. Ils se goûtent sur la langue. Saveur et savoir mêlés. Laissez-vous prendre, chaque pierre est une surprise. Et celle-ci est saxifrage – Ah ! l’énergie disloquante de la parole de poésie ! – elle casse, disloque, ouvre en deux, réveille car s’adressant à lui-même, c’est nous, lecteurs, qu’il atteint.
« Voûtés d’un grand silence », c’est ainsi que nous sortons de la lecture de ces Poteaux d’angle, comme leur auteur alors qu’il sortait d’une exposition de Paul Klee.
Silence, fruit de l’action poétique !
23:28 Publié dans Du côté de mes interventions, Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : henri michaux, poésie, poteaux d'angle, poésiegallimard
Lu 54 - Antoine Emaz, Plaie, Tarabuste éditeur et Jours/Tage, Editions En Forêt/Verlag im wald
J’ai lu dès réception, fin 2009, les deux livres d’Antoine Emaz. Je les ai lus, comme il se doit, en ménageant des palliers comme lors d’une remontée du bleu des fonds, pour filer l’air. Puis, j’ai laissé Plaie et Jours/Tage faire leur travail de lichen en moi, tant il est vrai que si les mots d’Antoine Emaz « bougent peu », ils « vibrent et tremblent dans une lumière de ras de porte.
 Je les rouvre aujourd’hui. Et c’est le même coup, la même frappe. Certes, il s’agit
Je les rouvre aujourd’hui. Et c’est le même coup, la même frappe. Certes, il s’agit  de deux livres différents quant à leur facture : Plaie est un long poème, une coulée entre le 02 septembre 2007 et le 23 novembre 2007 : 28 stations pour un trajet, 28 scansions pour une même force, celle qui pousse à dire le quelque chose qui a fait effraction, a « ruiné toute clarté » et dont il a fallu sortir, tandis que Jours/Tage est un recueil recensant 14 poèmes, 14 jours entre le 18.03.07 et le 09.06.08 – tous traduits en allemand. On imagine aisément que ce qu’Antoine Emaz appelle « menuiserie », ce travail du poème et ensuite du livre a différé d’un ouvrage à l’autre.
de deux livres différents quant à leur facture : Plaie est un long poème, une coulée entre le 02 septembre 2007 et le 23 novembre 2007 : 28 stations pour un trajet, 28 scansions pour une même force, celle qui pousse à dire le quelque chose qui a fait effraction, a « ruiné toute clarté » et dont il a fallu sortir, tandis que Jours/Tage est un recueil recensant 14 poèmes, 14 jours entre le 18.03.07 et le 09.06.08 – tous traduits en allemand. On imagine aisément que ce qu’Antoine Emaz appelle « menuiserie », ce travail du poème et ensuite du livre a différé d’un ouvrage à l’autre.
Pourtant, même coup, même frappe. Et non seulement pour les thèmes abordés – la mort, la maladie, la solitude, le vide…- mais aussi pour ce qu’il y a d’énergie, de vie risquée dans cette traversée de la mort ou de la blessure, cette expérience du peu de mots pour toute douleur : « sur ce qui fait mal », rien, tout glisse, aucun mot ne tient, vraiment. Pas d’accroche, trop de faiblesse pour « soulever du comme ». Et enfin pour cette interrogation toujours présente au cœur de la poésie d’Antoine Emaz et qui en définit sa position éthique : Comment écrire ce qui est quand ce qui est défaille ? Comment « fermement / se tenir » ? Comment « tenir droit dans un monde de travers » et dans un corps blessé qui vous coupe non seulement de vos sources mais des autres ? Comment faire tenir les mots ensemble, dans le poème, et de poème en poème, s’encorder à eux, tenir le chemin et passer debout car « digne / c’est debout » !
Un non, ferme, farouche, se dresse sur fond de faiblesse. Il dit le refus d’être écrasé, piétiné. Il dit le refus de tout idéalisme consolateur qui empoisonnerait jusqu’au langage. Il dit l’effort vers le jour . Une remontée d’être.
Ce n’est pas tout d’accueillir ce qui arrive comme il arrive quand il arrive. Un accident n’est pas encore un événement. L’écriture du poème chez Antoine Emaz vise à séparer de l’accident – ce « bloc d’ardoise tombé / sur le jour / et les yeux » - sa part immaculée, cet éclat d’être qu’il faudra mener – « les mots tendus comme mains » - jusqu’au jour, jusqu’à se remettre debout « et à l’intérieur » et « de nouveau / sortir » dans « le jardin d’automne / l’air / l’hiver qui vient ».
Ce qui a arrêté est devenu - on peut, à se retourner le dire - l’origine de cette avancée. Avec le temps redressé, l’homme trouve à se maintenir comme homme, soit cette chance qu’il est de pouvoir « (prendre) le dessus ». Avec Antoine Emaz, on passe d’un monde où ce qui nous arrive est accident qui nous affecte à un monde où cela devient événement qui nous engendre.
L’œuvre que, les mains dans le Cambouis (cf, son livre de notes paru au Seuil en 2009), Antoine Emaz construit, pas à pas, est capable de faire œuvre de vie parce que c’est sa personne morale qui s’y trouve engagée.
Optimistes, les livres d’Antoine Emaz ?
Oui ! Optimistes parce qu’ils ouvrent sur un devenir, un temps qui loin d’être perdu est seulement passé en mots formant comme un archipel de paroles !
22:47 Publié dans Du côté de mes interventions, Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : antoine emaz, plaie, jourtage, poésie
LU 53 - Emmanuel Laugier, For, éditions Argol, collection l'estran
 Il est des livres qui vous tiennent non à distance mais dans la distance, des livres qui vous imposent une posture. Le dernier livre d’Emmanuel Laugier For que publient les éditions Argol est de ceux-là.
Il est des livres qui vous tiennent non à distance mais dans la distance, des livres qui vous imposent une posture. Le dernier livre d’Emmanuel Laugier For que publient les éditions Argol est de ceux-là.
Imaginez 250 pages d’un poème en continu avec ce qu’il faut d’asyntaxie, de syncopes, de coupes, de graphies inattendues, de récits concassés, de remontées de mémoires, de glissades, de pans de fantasmes et tout cela dans un flot, un torrent au débit impétueux, aux écumes irisées. Hors signification immédiate, on est jeté dehors – c’est le sens le plus évident de ce titre aussi court qu’énigmatique, renvoyant à l’étymologie latine for, foris – et lire dès lors revient à se tenir comme on se tient face à un être vivant. Un autre qu’il ne s’agit pas de décrypter, de déchiffrer, de déboutonner, de déplier pour l’expliquer mais de regarder d’un œil étonné, attentif à voir comment il bouge, se délie, se déplie, ouvre les yeux, les ferme, se penche, avance, glisse, saute, se jette à côté, traverse les pages.
Regarder le corps du texte – cette danseuse ! - comme le conseillait le poète E.E Cummings à propos de la beauté, n’est-ce pas le seul moyen de deviner – on ne dira pas son âme par crainte de faire retour sur quelques vieux débats – sa part immortelle. Sa singularité.
Ce titre For, on pourrait le prendre pour un nom. Un nom propre. Celui en verlan d’or-f, Orphée, figure du poète Figure de celui qui remue, use et abuse de la langue commune, attaque son corps massif pour la chance d’y voir naître comme étrangère sa langue singulière. Dans ce travail, le poète Emmanuel Laugier ne craint ni le manque de suite, ni les coupures, ni les sauts d’une scène d’enfance marocaine aux cahots d’un voyage en voiture en passant par la rencontre avec cet autre museur qu’est parfois l’analyste pour finir par approcher l’île, celle « intérieure / (…) pliée dans l’enveloppe / du jour ». Emmanuel Laugier pratique l’interruption, la séparation, la refente. Il y a tellement d’épais à entamer que tout se passe comme s’il ne pouvait tracer chemins de langue où marcher qu’en entamant et pris dans le mouvement rester sur cet élan afin qu’à peser sur l’avant, on dépasse. Nulle confession. On ne déroule ici ni affres, ni souffrances, à peine si l’on reconnaît des fragments d’images remontées, ballotées, polies à tous les courants du vivre.
Plus s’effondre le monde de la veille, plus on s’enfonce « dans l’infini du sommeil : venu en creux / faire un autre temps dans le temps » et plus viennent les mots au poème. Attention, à sommeil, sommeil et demi ! On ne peut qu’être frappé par cet état intermédiaire entre la veille et le sommeil qu’au moyen Age on nommait dorveille quand le chevalier errant sur son cheval composait une pièce de vers – Rappelez-vous…Guillaume IX , comte de Poitiers, et son aveu : « farai un vers / pos mi somelh » (Je ferai un vers puisque je suis endormi) , c’est lui qu’Emmanuel Laugier affectionne ! Ainsi c’est à partir de rien , comme notre premier troubadour, de ces « linéaments », lignes, plis, feuillette cérébral entre mémoire, veille et dormance que le museur tente encore et toujours de faire monde à partir de ce qui reste sans langue dans le « noir sur fond noir » du for d’un crâne.
Dès lors le poème se dévide non pour combler manques et lacunes, non pour ravauder, coudre les pièces décousues, non pour ramer contre le courant mais au contraire pour l’épouser, suivre le flux, la force qui se joue des articulations dans cette mêlée perpétuelle. Un rien tient tout cela, passes de vent qui déchirent. Et éclairent.
C’est cela qui émeut au long de ces pages, assister à un processus de subjectivation, au cours duquel un homme s’invente.
22:42 Publié dans Du côté de mes interventions, Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emmanuel laugier, for, editions argol, poésie
De Nice parce que j'y vis: bouon cap d'an et de catalogne nord parce que j'en viens: bon any nou!
Six mois loin du blog! Ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas rien fait durant tout ce temps. Les jours ont poussé les jours.
Je profite de ce premier jour de Janvier 2011 pour le réactiver souhaitant aux passants des terres de P/oesie tous mes voeux pour cette belle et bonne énergie, grande ouvreuse de routes.
N'oubliez pas ces mots d'André Frénaud: "Le salut, c'est : en marche! "
17:28 Publié dans Du côté de mes interventions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré frénaud, voeux
02/04/2009
Lu 37 - Gaston Puel par Eric Dazzan
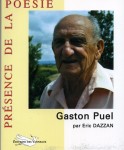 Après Pierre Garnier, Jean Malrieu, Serge Wellens, Pierre Dhainaut, Présence de la poésie, cette collection ouverte par Cécile Odartchenko aux éditions des Vanneaux qu’elle dirige, accueille Gaston Puel. L’homme de Veilhes est présenté par Eric Dazzan. Comme pour les volumes précédents, trois espaces font tresse à ce livre. Le premier accueille une présentation du poète et de son œuvre ; le second, iconographique, est illustré ici – une fois n’est pas coutume ! – par des références autobiographiques manuscrites par Gaston Puel ; le dernier est une anthologie de poèmes enrichie d’une dizaine de « poèmes récents ».
Après Pierre Garnier, Jean Malrieu, Serge Wellens, Pierre Dhainaut, Présence de la poésie, cette collection ouverte par Cécile Odartchenko aux éditions des Vanneaux qu’elle dirige, accueille Gaston Puel. L’homme de Veilhes est présenté par Eric Dazzan. Comme pour les volumes précédents, trois espaces font tresse à ce livre. Le premier accueille une présentation du poète et de son œuvre ; le second, iconographique, est illustré ici – une fois n’est pas coutume ! – par des références autobiographiques manuscrites par Gaston Puel ; le dernier est une anthologie de poèmes enrichie d’une dizaine de « poèmes récents ».
Je suis heureux de cette parution.J ‘ai lu ces pages avec la même joie qui me faisait – c’était hier ! – saluer l’homme de tous les refus, l’insurgé chaleureux qui demande au mélèze : « délivre-moi de la tendresse qui arrondit l’amour » afin qu’éperonné jusqu’à la brûlure « l’âme s’ouvre au vent qui vient », « âme errante » qui sait reconnaître ses « attaches », selon le titre du dernier livre qu’il vient de publier aux éditions de l’Arrière-Pays. Louer le tôt levé qui sait recevoir « l’aube comme un baquet d’eau fraîche », le marcheur matinal qui va « vers le grand poumon des versants », l’homme incertain qui lit l’espoir – cet « élan vers l’impossible » - dans les nuages de son pays et dans le vernt, « la grâce de recommencer ».
J’aime à retrouver dans ces pages présent, le poète. Le « livreur » solaire de « mots lavés de frais / à la source du matin », le passeur qui dégèle le monde et dont la voix laisse entendre un triple oui aux travaux et aux jours après que dans la bouche s’est défait un NON murmuré pour « (acquiescer) au futur sans oreille, à la terre qui se dérobe sous nos pieds ».
Eric Dazzan a raison de voir dans la poésie de Gaston Puel, dans sa vie en poésie depuis les années 40, une « traversée de l’invivable », traversée obstinée, sans concession avec le monde des Lettres, sans illusion sur les pouvoirs de la parole, fidèle à ce « lien mortel » qu’il noua tôt avec la terre « grave et souffrante ».
Lien qui se goûte sur la langue, dans les mots de ses poèmes. « Saveur mortelle » de la poésie de Gaston Puel. Source de vie pour qui sait se rendre « sensible à la part renaissante de chaque chose qui dure (…) devancer dans ce qui passe le souffle qui va l’emporter, participer ainsi de ce qui le ressuscite », selon les mots de Joë Bousquet, aimés de Gaston Puel.
Contact: Editions des vanneaux - http://les.vanneaux.free.fr
16:09 Publié dans Du côté de mes interventions | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, poésie
11/11/2008
Lu 27 -"La poésie, c'est autre chose", sous la direction de Gérard Pfister
 La poésie, mais qu'est-ce ? Une inconnue délaissée ? Il faut dire qu'elle joue perdant. Rebelle à tous les attributs dont on voudrait l'affubler, on ne peut la saisir. Les poètes ne se sont pas privés de lui proposer, parfois de manière péremptoire, des définitions. Mais voilà, elle est toujours autre chose !
La poésie, mais qu'est-ce ? Une inconnue délaissée ? Il faut dire qu'elle joue perdant. Rebelle à tous les attributs dont on voudrait l'affubler, on ne peut la saisir. Les poètes ne se sont pas privés de lui proposer, parfois de manière péremptoire, des définitions. Mais voilà, elle est toujours autre chose !
Oui, Gérard Pfîster a raison de rappeler le mot de Guillevic : "la poésie, c'est autre chose » et d'en faire le titre de son anthologie où sont recensées « 1001 définitions de la poésie », publié dans la collection « Les Cahiers d'Arfuyen », éditions Arfuyen (15 euros). Bien sûr tout tient dans ce « 1000 + 1 » qui maintient la voie ouverte vers quelque soleil futur !
C'est ce vacillement que nous donne à lire Gérard Pfîster. On feuillettera ce livre comme on tournerait un cristal. Huit facettes, huit approches défînitionnelles : Affirmation, Connaissance, Emotion, Licorne, Musique, Objet, Révélation, Vie. Le tout réunissant quelques 650 citations de quelques 250 auteurs d'époques, de langages et de sensibilités très diverses.
C'est un sacré service que Gérard Pfîster rend à la poésie contemporaine tant il est vrai que ce livre aide à nous la faire comprendre et aimer. Les passionnés sont toujours passionnants ! Gérard Pfîster est de ceux-là !
Parce que nous fêtons cette année le centenaire de sa naissance dans un silence assourdissant, j'aimerais souligner ce chemin ouvert par René Daumal dans ce toujours fameux débat entre prose et poésie : « la prose parie de quelque chose, la poésie fait quelque chose par des paroles ». Le poète est celui qui fait. Que ce sens grec du mot reste à notre horizon et nous comprendrons que là où l'on a « rythmé la langue dans l'émoi », comme le rappelait Pierre Michon, à Mouans-Sartoux le 5 octobre dernier, là se trouve la poésie.
© Alain Freixe
16:54 Publié dans Du côté de mes interventions, Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0)
01/07/2008
René Daumal aurait cent ans
"La porte de l'invisible doit être visible." René Daumal
Né le 16 mars 1908 à Boulzicourt dans ce pays des Ardennes, on lui doit ce clin d'oeil à Arthur Rimbaud : "Oui, nous sommes tous de la race d'Antée, et pour mon compte, je dépérirais vite si je n'allais chaque semaine piétiner, palper et souvent fouiller, râcler, retourner le ventre maternel. Paysan!" ( le 29/07/1932 à Rolland de Renéville).
Avant Le mont analogue - cette ascension inachevée d'un sommet inaccessible", ce voyage vers la Réalité, vers la "vraie vie" - on relira La vgrande beuverie - cette satire du monde des "hommes-creux", critique féroce des postures et des impostures de ses contemporains; on s'efforcera de prendre la mesure des efforts par lesquels, dans cette expérience qu'est la poésie, le poète René  Daumal essaya d'être un "poète blanc", s'arrachant aux rivages où il fut "poète noir", tout en reconnaissant que "de fait, toute poésie humaine est mêlée de blanc et de noir" : mais l'une tend vers le blanc, l'autre vers le noir" (cf. Poésie noire et poésie blanche in Le contre-ciel, Poésie/Gallimard); on visitera cette période des années adolescentes (1926-1932) qui le verra en compagnie de Roger-Gilbert Lecomte, Roger Vailland et quelques autres "phrères simplistes" tels que Pierre Minet du lycée de Reims créer le groupe - se joindront alors à eux à Paris Hendrik Cramer, Artur Harfaux, Maurice Henry, André Rolland de Renéville, Josef Sima...- et la revue Le grand jeu - 3 numéros entre 1928 et 1930 - et débattre avec son aîné André Breton et le groupe surréaliste.
Daumal essaya d'être un "poète blanc", s'arrachant aux rivages où il fut "poète noir", tout en reconnaissant que "de fait, toute poésie humaine est mêlée de blanc et de noir" : mais l'une tend vers le blanc, l'autre vers le noir" (cf. Poésie noire et poésie blanche in Le contre-ciel, Poésie/Gallimard); on visitera cette période des années adolescentes (1926-1932) qui le verra en compagnie de Roger-Gilbert Lecomte, Roger Vailland et quelques autres "phrères simplistes" tels que Pierre Minet du lycée de Reims créer le groupe - se joindront alors à eux à Paris Hendrik Cramer, Artur Harfaux, Maurice Henry, André Rolland de Renéville, Josef Sima...- et la revue Le grand jeu - 3 numéros entre 1928 et 1930 - et débattre avec son aîné André Breton et le groupe surréaliste.
Que cet anniversaire soit l'occasion de redonner à lire le René Daumal de Joë Bousquet qui, à Carcassonne, créa en 1928 la revue Chantiers laquelle accueillera, malgré son ancrage dans le surréalisme via Paul Eluard, quelques membres du Granjeu comme André Delons, josef Sima...Cet ouvrage que vous trouverez au catalogue des éditions Unes comprend outre la fin de Traduit du silence - Attention! Non le texte que Jean Paulhan tirera en 1941 des quelques mille pages qu'il emportera de la chambre de Carcassonne mais celui publié en date du 20 mai 1939 et constituant le N°65 des Cahiers du journal des poètes - ; un hommage paru dans le N°272 des Cahiers du sud et enfin une lettre inédite du 2 juin 1932 de Bousquet à Jean Ballard, directeur des Cahiers du sud; le tout mis en situation par Bernard Noël dont je relèverai l'affirmation selon laquelle finalement il importe peu que le temps n'ait rendu justice ni au Grand Jeu, ni à Bousquet "car c'est la mort qui fixe et statufie: nous, les vivants, ne savons jamais ce qu'elle mettra à notre place pour déguiser l'absence. Le Grand Jeu n'est pas plus un sous-groupe surréaliste que Bousquet n'est "un" écrivain, lui qui cache sous son nom tout un mouvement anonyme, dont les voix multiples n'en finissent pas de troubler l'eau du regard trop chargée de présence et n'en finissent pas non plus de faire fleurir des visages au bord de l'amour devenu, par lui, énergie de la langue." On ne saurait mieux dire. Ces hommes se tiennent comme des rôdeurs, en bordure des routes, adossés aux fossés, les yeux perdus dans "les confins de la lumière et de la nuit impénétrable", là où le regard se traverse de son propre coeur.
Ce que Bousquet dit de Daumal, je le dirais des deux, et volontiers des trois - Bernard Noël compris! -: n'en perdons aucun de vue, la vertu de poésie est intacte chez eux! C'est qu'avec Bousquet, ils considèrent comme une véritable et redoutable entreprise le fait de ne plus séparer vie artistique et vie morale, de ne plus admettre comme oeuvre littéraire digne de ce nom, c'est-à-dire capable de faire oeuvre de vie, et non de donner du rêve à consommer aux anesthésiés que nous sommes, que celles où la personne morale se trouve engagée.
15:20 Publié dans Du côté de mes interventions, Inédits | Lien permanent | Commentaires (0)




