05/11/2007
Lu 20 - Bernard Noël-sonnets de la mort
Le poème ne sera jamais un discours parmi d’autres. Altérité irréductible, il nous force à voir. À entendre aussi bien. Comme Bernard Noël a dû crier. Comme quelque chose en lui a dû crier pour écrire ces sonnets de la mort ! C’est à partir de ce cri immensément silencieux qu’il a risqué le geste du poème. Là une force l’a fendu en deux et par le milieu l’a poussé à ouvrir l’espace où vont se montrer ces mots dont la torture est l’objet.
Bernard Noël a dû crier. Comme quelque chose en lui a dû crier pour écrire ces sonnets de la mort ! C’est à partir de ce cri immensément silencieux qu’il a risqué le geste du poème. Là une force l’a fendu en deux et par le milieu l’a poussé à ouvrir l’espace où vont se montrer ces mots dont la torture est l’objet.
Oui, il y a de l’insoutenable. Et il y a à résister à partir de cet insoutenable. À partir du pire – Titre même de la collection des éditions fissile dans laquelle paraissent ces sonnets de la mort, dans la collection "pire" (9 euros) Onze poèmes repris du N°2 de la revue Moriturus, Le sens du sang, revue créée en 2001 par Cédric Demangeot, Brice Petit, Lambert Barthélémy et Guy Viarre qui choisit en cours de route de se rayer de ce côté-ci du monde.
Ce n’est pas dans ces poèmes que l’on trouvera des « oh ! quelle horreur ! et des « oh ! comme c’est abominable ! ». On aura affaire ici à bien pire que des sentiments, on aura à affronter les mots mêmes du bourreau. Tels quels. Simples collages parfois de propos lus ici ou là mais qui au montage, dans les vers, leurs séquences, produisent de ces déflagrations qui allument soudain le jaune sale des ampoules des culs de basse fosse où « ça finit dans un baquet de pisse / jusqu’à plus soif ».
À cette objectivation du réel que produisent les poèmes de Bernard Noël, on se rend. Et c’est au point de jonction de la conscience et de ses vers que ce produit l’éclair. Le poète ici s’est effacé. Bernard Noël est de ces rares, de ces quelques-uns dont parle Jacques Dupin qui s’effacent pour écrire. Et c’est moins l’émotion dont on aura toujours raison de se méfier que l’émoi – ce que Bernard Noël appelle ailleurs « une émotion dépourvue de sentiments » - qui est le cœur de feu de ses mots, soit cet effondrement que la forme du poème en quelque sorte redresse. Et tient.
À soulever le cœur, la raison en sort comme épurée. Car on fond c’est comprendre qu’il nous faut. Comprendre comment la mort travaille notre monde.
Les bourreaux auront beau faire. Ils susciteront toujours ceux qui à l’aube seront leurs ennemis. Bernard Noël est de ceux-là. Irréductiblement, debout.
18:40 Publié dans Du côté de mes interventions | Lien permanent | Commentaires (0)
Lu 18 - Antoine Emaz - Caisse claire
 Caisse claire. Sous ce titre se trouvent réunis par François-Marie Deyrolle et Antoine Emaz lui-même les poèmes qu’il a publié entre 1990 et 1997, soit de En deça, Fourbis 1990 à Boue, Deyrolle éditeur 1997. Une postface du poète Jean-Patrice Courtois accompagne les treize livres repris ici dans cette collection Poésie points du seuil (7,5 euros), qui ne cesse de s'enrichir, assurant le lecteur de la « cohérence indéniable », de l’« unité de ton et d’horizon » de ce livre au titre de tambour qui longtemps après la frappe vibre lent dans unh cliquetis d’os ou un crissement de grains de sable.
Caisse claire. Sous ce titre se trouvent réunis par François-Marie Deyrolle et Antoine Emaz lui-même les poèmes qu’il a publié entre 1990 et 1997, soit de En deça, Fourbis 1990 à Boue, Deyrolle éditeur 1997. Une postface du poète Jean-Patrice Courtois accompagne les treize livres repris ici dans cette collection Poésie points du seuil (7,5 euros), qui ne cesse de s'enrichir, assurant le lecteur de la « cohérence indéniable », de l’« unité de ton et d’horizon » de ce livre au titre de tambour qui longtemps après la frappe vibre lent dans unh cliquetis d’os ou un crissement de grains de sable.
C’est ce reste là – cet os – qui s’entend dans l :a poésie d’Antoine Emaz. C’est un reste de lumière. Si vous vous penchez, vous entendrez son murmure. Elle « dit demain / comme un sourire / ou bien demain encore / parce qu’il faut ».
Tournure est posture. Celle d’Antoine Emaz est de dignité verticale : « on tient encore / debout », écrit-il. Malgré tout ce qui interdit. Malgré les murs. La pluie. La boue . Malgré tout ce qui poisse. Et colle. Malgré l’hiver et tous ses froids.
18:35 Publié dans Du côté de mes interventions | Lien permanent | Commentaires (0)
Lu 17 - Charles Reznikoff - Holocauste
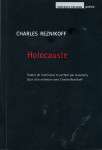 C’est un bien terrible livre que cet Holocauste de Charles Reznikoff. Paru aux Etats-Unis en 1975, c’est Dominique Bedou qui l’avait publié en France en 1989. On ne le trouvait plus. Il faut remercier vivement Lionel Destremeau et ses Editions Prétexte Poésie pour avoir pris l’initiative de cette parution (12 euros), revue et corrigée par Auxeméry, augmentée d’un entretien paru en 1977 dans la revue Europe.
C’est un bien terrible livre que cet Holocauste de Charles Reznikoff. Paru aux Etats-Unis en 1975, c’est Dominique Bedou qui l’avait publié en France en 1989. On ne le trouvait plus. Il faut remercier vivement Lionel Destremeau et ses Editions Prétexte Poésie pour avoir pris l’initiative de cette parution (12 euros), revue et corrigée par Auxeméry, augmentée d’un entretien paru en 1977 dans la revue Europe.
Holocauste, ce titre ancre le livre dans le monde américain qui persiste à nommer ainsi ce qui loin d’être un sacrifice – sens que ce mot revêt dans l’Ancien Testament – fut l’extermination des juifs d’Europe par les nazis, à laquelle il faut ajouter l’élimination, dans d’autres proportions, de tziganes, communistes, homosexuels, résistants…tous « déficients physiques et psychologiques ». Pour autant ce mot ne trompera pas l’histoire tant les XII scansions de ce « récitatif de l’horreur » voient la chose telle quelle et rien d’autre. Ni interprétation, ni métaphore, juste des découpages – Charles Reznikoff ainsi a travaillé à partir d’archives du Procès des criminels devant le tribunal militaire de Nuremberg et des enregistrements du procès Eichmann à Jérusalem – une mise en vers et un montage pour faire voir. C’est aux intersections que prend la lumière. Elle est crue. Et sans appel. Insoutenable est ce qu’elle donne à entendre. Cela qu’on croyait déjà avoir lu. Ou vu. Cela qui revient à la faveur de cet effacement dont Charles Reznikoff sait se rendre capable, effet de cette pratique poétique spécifique des poètes objectivistes américains : l’horreur sans nom propre, l’horreur qui voit l’homme résister à sa destruction infinie, cet « indestructible qui peut être infiniment détruit » selon les mots de Maurice Blanchot, l’horreur qui n’est pas de l’ordre de l’idée, encore moins du sentiment, mais qui est dans les choses, selon les mots de William Carlos Williams : « no ideas but in things » !
Ainsi, c’est moins d’émotion – ce jeu bouleversant des images qui cherchent à représenter l’inhumain – que d’émoi dont il s’agit ici, soit cette « émotion dépourvue de sentiments » dont parle Bernard Noël. C’est que les sentiments – on le sait depuis Rilke – on les a toujours assez tôt et ils sont le lieu toujours possible d’obscures manipulations. L’émoi, c’est cet effroi que produit la lecture continue de ce texte de Charles Reznikoff, troué de part en part par un inimaginable qui le sauve de tout pathos. Ici, la parole du poème fait acte de présence. Son récitatif ouvre dans notre présent la barbarie même et son cortège d’horreurs. L’effet de vérité est saisissant. Là comme sans auteur, les mots ne sont plus les mots, « c’est une terrible chute dans le silence » aurait pu dire Paul Celan.
18:31 Publié dans Du côté de mes interventions | Lien permanent | Commentaires (0)
10/10/2007
Lu 16 - X fois la nuit de Patricia Castex Menier
 La nuit est sur les noms. C’est le silence d’un trou autour duquel rôdent les noms du jour. Patricia Castex Menier la nommera tour à tour : « l’intime (…) la compacte (…) la perspicace (…) la visiteuse (…) la fraternelle (…) la / bienveillante / la bannie (…) la reculée / la séculaire (…) » X fois, comme en son titre, elle est celle qui échappe à la nomination. Et telle est sa nature rêvée : « on / dit qu’elle date / d’avant le monde / précéderait les dieux ». Hors temps, hors pouvoir, elle est l’avant de toutes choses, le chaos. Même Zeus la craignait !
La nuit est sur les noms. C’est le silence d’un trou autour duquel rôdent les noms du jour. Patricia Castex Menier la nommera tour à tour : « l’intime (…) la compacte (…) la perspicace (…) la visiteuse (…) la fraternelle (…) la / bienveillante / la bannie (…) la reculée / la séculaire (…) » X fois, comme en son titre, elle est celle qui échappe à la nomination. Et telle est sa nature rêvée : « on / dit qu’elle date / d’avant le monde / précéderait les dieux ». Hors temps, hors pouvoir, elle est l’avant de toutes choses, le chaos. Même Zeus la craignait !
Mais c’est mal la connaître. C’est se tromper sur sa véritable nature. Car elle est « la fraternelle » et « l’aurore / est son péché d’orgueil ». Elle sait s’ouvrir au rêve. Et préparer le jour.
Patricia Castex Menier a écrit ce texte comme la nuit tombe. Insensiblement. De coupure en coupure. Ici, matérialisées au blanc. Invisibles, dans le monde. Comme la nuit, l’écriture de Patricia Castex Menier stolonne. S’attarde. Se prolonge. S’enrichit. Vit, lançant ses nouvelles nappes d’ombres. X fois la nuit (Cheyne Editeur, 2006, 13, 50 euros), oui, car la nuit ne connaît pas de point final. Et si le jour l’élague, la relègue. Elle rôde encore en tombées, effarouchées, dans le corps de la lumière.
Si la nuit est la toujours en allet, la première et la dernière ; si elle est celle qui se retire et nous laisse signer nos drames, elle est aussi celle qui revient, « gardienne / des ruines, sentinelle du présent », celle qui « entretient le feu ».
Le livre est son semblable, écrit avec justesse Patricia Castex Menier. En effet, les livres de poésie font brèche et meurtrières. Ils éboulent les murs pour en affronter de nouveaux. Oui, c’est de mur en mur, de mur sapé en mur éboulé, que nous allons comme de passage en passage. Non pour traverser – ce serait trop dire ! – mais pour avancer dans un monde rendu un temps plus habitable.
23:00 Publié dans Du côté de mes interventions | Lien permanent | Commentaires (0)
Lu 15 - La mort n'est jamais comme de Claude Ber
( Aller voir dans la catégorie "Mes ami(e)s, mes invité(e)s" en date du 04/04/2007 la présentation et le beau texte que Claude Ber m'avait confié)
 Un mot manque à la langue. Un mot qui dirait la mort. Ce trou dans le réel qui oblige ceux qui ont le vertige à bâtir des tours pour du haut tenter de dire ce qui est arrivé. Ceux-là, ceux qui restent, ceux qui déplacent la douleur dans un remuement de langue, risquant bruits et crissements, ceux pour qui « la mort n’est pas un chemin barré » selon les mots de Jacques Dupin, ceux qui mènent à chaque fois par des chemins singuliers dans les mots vers le mot qui faut, qui tentent de l’arracher à la masse des signes, à le « traduire du silence », ceux qui tentent de le serrer dans les pages d’un livre, risquant jusqu’à l’illisibilité, ceux-là sont les ami(e)s de la traversée.
Un mot manque à la langue. Un mot qui dirait la mort. Ce trou dans le réel qui oblige ceux qui ont le vertige à bâtir des tours pour du haut tenter de dire ce qui est arrivé. Ceux-là, ceux qui restent, ceux qui déplacent la douleur dans un remuement de langue, risquant bruits et crissements, ceux pour qui « la mort n’est pas un chemin barré » selon les mots de Jacques Dupin, ceux qui mènent à chaque fois par des chemins singuliers dans les mots vers le mot qui faut, qui tentent de l’arracher à la masse des signes, à le « traduire du silence », ceux qui tentent de le serrer dans les pages d’un livre, risquant jusqu’à l’illisibilité, ceux-là sont les ami(e)s de la traversée.J’ai rencontré Claude Ber, comme il se doit, par hasard. J’ai lu son livre dans l’amitié, cet espace où se retrouvent ceux/celles dont on comprend qu’ils sentent davantage ce que veut dire vivre en écrivant.
La mort n’est jamais comme ( Editions de l’amandier, 2006, 12 euros ) est un de ces livres importants qui mettent à mal l’objet verbal qu’ils sont pourtant puisqu’ils proviennent d’un « effondrement / affrontement de la langue dans la langue », pour dans « ce reste » qu’ils sont laisser affleurer l’acte, ce moment de l’existence en mouvement vers son sens, qui a présidé à leur mise sur pied. Ce livre de Claude Ber est un de ces livres qui sont comme autant d’essais pour passer à travers, faire clarté, faire comme un dégagement pour se donner de l’air et retrouver les oiseaux de ces « intimes croyances, de celles qui font vivre à n’importe quel prix ».
Donc la question – la seule – est de savoir comment dire ce qui excède jusqu’au langage lui-même ? Comment dire avec des mots ce qui reste hors des mots ? Comment dire la mort des êtres aimés ? Comment entrer dans les veines du noir, dans la seule nuit dont personne ne trouvera le fond, la nuit du cœur qu’il faut pourtant toucher non des mains mais avec les quelques mots qui nous restent en plongeant au plus profond de l’abîme de l’existence.
C’est à cette expérience que nous invite Claude Ber. À la déroute du comme. Ce que nous traversons dans ce livre, c’est « le déchiré de la parole », l’impuissance de « l’agrafe de l’image » pour réunir « les lobes épars d’une cervelle » et « ramener l’invivable au vivable ordinaire des jours ». Non, la poésie n’a pas ce gluant des pommades qui masquent les plaies. Non, ici, on ne fait le deuil de rien. On a beau travailler, descendre dans la soute, risquer tous les comme possibles, rien ne vient boucher le trou des questions : « comme quoi est la mort ? Qu’est-ce qui est comme la mort ? » jusqu’à l’adresse à celui/celle passé de l’autre côté : « toi qui sais à présent, dis-moi ce qui est comme la mort ? ». Claude Ber qui en découd avec la parole ne fait qu’aggraver le questionnement. Et c’est cela qui tient le livre. Cette montée dans l’obscur. Par soustraction.
Et par composition. En effet, autant Claude Ber sait prendre acte du « crack définitif du langage », mettre à leur place les « (bouées) de l’image » et accepter que le poème ne soit que « ce qui reste », « un bégaiement », autant son « effort de clarté » concerne l’architecture même de son livre. Un territoire, une tour. À tenir. Ce sont ainsi deux pierres levées – Ce qui reste et Fragments in memoriam - qui ouvrent et ferment le livre. Entre elles, 22 « bribes », chacune engageant plusieurs « découpes », soit 50 au total, comme autant de poèmes, de restes, de vestiges, voisins du fantôme, ce vêtement d’absence, garant d’une présence encore et toujours de la vie dans ses aspects les plus kaléidoscopîques.
Claude Ber mêle à une belle tension rhétorique qui vise à porter le langage au plus près de ses limites, les impulsions secrètes de l’organisme, ces mouvements qui nous pressent, nous traversent, nous déchirent. Là où cœur et chair ne s’opposent pas, dans cette zone d’avant la distinction de l’âme et du corps, prend le feu de ce rythme qui bat dans l’écriture de Claude Ber. C’est lui qui oppose les arêtes, unifie et fait tenir ensemble. Cela donne ce ton particulier qui voit Claude Ber parler ici avec des mots au « juste temps » selon l’expression de Jean-Luc Nancy, soit avec des mots qui s’ils ne disaient pas le juste (le sens correct, la vérité) disaient juste !
Claude Ber dit juste. Et dans ce suspens du sens, c’est la vie qui se rue. Ce hors-sens, ce vide s’ajoute au temps pour le faire jouer, tourner. Pour resynchroniser un compte qui manifestement n’est pas bon. Et c’est alors un oui que l’on entend. Un oui « à la vie », au « jouir », à « la chair la mer nues. Et la lumière tierce ». Décidément, le reste, ce peu, est toujours ce qui sauve !
22:25 Publié dans Du côté de mes interventions | Lien permanent | Commentaires (0)
Lu 14 - Mandala des jours de Dominique Sorrente
 D’un de ses précédents livres Le petit livre de QO, paru chez Cheyne éditeur en 2001, j’écrivais que QO – Diminutif du narrateur de l’Ecclésiaste Qôhelet – était celui qui dérange. Apparaît et disparaît. Entre sans crier gare. Cet « imprévu rencontré » - C’était le titre que Dominique Sorrente avait donné en 1995 au N°109 de la revue Sud qu’il avait alors dirigé – est poésie. Cela qui s’écrit en nous dans la déroute des certitudes et des calmes.
D’un de ses précédents livres Le petit livre de QO, paru chez Cheyne éditeur en 2001, j’écrivais que QO – Diminutif du narrateur de l’Ecclésiaste Qôhelet – était celui qui dérange. Apparaît et disparaît. Entre sans crier gare. Cet « imprévu rencontré » - C’était le titre que Dominique Sorrente avait donné en 1995 au N°109 de la revue Sud qu’il avait alors dirigé – est poésie. Cela qui s’écrit en nous dans la déroute des certitudes et des calmes.Mais c’est ouvrir d’autres routes cela ! D’impossibles routes. Les seules aimées pourtant. Celles qui conduiraient à d’autres jours, un autre temps, à la demeure de haut et profond silence. Quelque chose comme un Mandala, cette perfection géométrique du cercle, qui reste à l’horizon d’un qui, homme parmi les hommes, reste « nu et pèlerin comme à l’heure du premier poème », un qui entend rester dans l’enfance du désir, ses énergies de feu, pour qui vivre se vit dans le risque de vivre. Oui, c’est cela que l’on ressent à la lecture de ce nouveau livre de Dominique Sorrente, après ses sept livres parus chez Cheyne éditeur et une bonne vingtaine de publications.
C’est pour cela que contre ce Mandala, je parierais pour la spirale. C’est son image qui s’impose à moi, lisant Dominique Sorrente. De nouvelles déchirures maintiennent ouvert ce quelque chose qui tourne, pars et revient, évolue et s’involue dans la poésie de Dominique Sorrente, quelque chose qui nous fait « une clairière pour l’habitation » et qui « nous invite à tenir parole avec quelques bouts de sagesse méridienne à partager. »
Je sais bien que Dominique Sorrente a voulu architecturer son Mandala des jours (éditions PubliBook, 13 euros) selon les cinq éléments de l’antique sagesse chinoise : « bois, feu, terre, métal et eau…cinq moments. Cinq graphies » écrit-il. Mais si ce livre de poèmes est du côté du Mandala, dans sa rondeur par exemple ; la poésie, elle , est du côté de la spirale, cercle que toujours « dénoue le matin futur ». Elle est du côté de ce qui « désoriente la braise », « disperse les cendres » et déshabitue l’œil car toujours la violence du monde fait déchirure : « ce qui se passe au loin, si près, / - tous ces anneaux de flammes - / t’empêchent de dormir », écrit Dominique Sorrente. La poésie toujours excède le poème, cette retombée transcriptive, cette traduction. C’est elle la passagère qui nous voue à la spirale. Et dominique Sorrente le sait : « la boucle retrouvée / enjoint le jour qui s’étonne / de ne pas achever le poème ».
Reste qu’une vie qui s’est vouée à une « parole pour éveiller » se joue entre lucidité et trouble, sagesse et folie, mandala et spirale.
Reste, cela qui n’échappera à aucun lecteur, cette ferveur dans l’écriture de Dominique Sorrente. Quelque chose comme un soutien intime du vrai. Car ce n’est pas avec ses mains que l’on saisit la vérité mais c’est en parcourant la nuit où notre cœur garde les éclairs qui ont éblouis nos jours, où « le feu certain qui déroulera ses spirales n’a pas encore logé ses bruits ».
Reste cette posture du poète qu’est Dominique Sorrente : « La tâche du poète, écrivait-il dans Le petit livre de QO, n’est pas d’embellir l’instant, pas plus que de le mimer. Son plaisir et son risque seront toujours de faire route vers la source du réel où vivent nos eaux mêlées ». Celle d’ »un homme / ses deux mains fouillant un chantier / face au hoquet du ciel ».
22:16 Publié dans Du côté de mes interventions | Lien permanent | Commentaires (0)
15/06/2007
Lu 13 - André Velter et la "fée des glaciers"
 Lettera amorosa, fin de partie ? Voire ! « La poésie est le lien privilégié où se disent ensemble l’amour des êtres (Amors) et l’amour de la langue » Comme ces mots de Jacques Roubaud bornent bien le livre d’André Velter, L’amour extrême et autres poèmes pour Chantal Mauduit (Poésie/Gallimard) dans lequel il a regroupé les trois livres dédiés à sa femme céleste.
Lettera amorosa, fin de partie ? Voire ! « La poésie est le lien privilégié où se disent ensemble l’amour des êtres (Amors) et l’amour de la langue » Comme ces mots de Jacques Roubaud bornent bien le livre d’André Velter, L’amour extrême et autres poèmes pour Chantal Mauduit (Poésie/Gallimard) dans lequel il a regroupé les trois livres dédiés à sa femme céleste.11:05 Publié dans Du côté de mes interventions, Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (1)
11/06/2007
Lu 12 - Jacques Dupin, critique? Oui, parce que poète!
 « Ecrire (est) à la fois un acte d’intrusion et d’habitation ». Ces mots sont de mon ami Emmanuel Laugier qui signe l’article intitulé Aux grands astreignants – clin d’œil appuyé à René Char - dans le dernier numéro du Matricule des anges à propos du dernier livre de Jacques Dupin qui vient de paraître chez P.O.L M’introduire dans ton histoire. Beau titre venu de Mallarmé pour voir « se déployer toute une vie de lecture et d’écriture, avec ses murs et ses lignes brisées qui revient pourtant buter sur la même question – ce qu’est la poésie pour un poète » selon les mots de Valéry Hugotte qui présente avec justesse et retenue l’enjeu de cet ouvrage.
« Ecrire (est) à la fois un acte d’intrusion et d’habitation ». Ces mots sont de mon ami Emmanuel Laugier qui signe l’article intitulé Aux grands astreignants – clin d’œil appuyé à René Char - dans le dernier numéro du Matricule des anges à propos du dernier livre de Jacques Dupin qui vient de paraître chez P.O.L M’introduire dans ton histoire. Beau titre venu de Mallarmé pour voir « se déployer toute une vie de lecture et d’écriture, avec ses murs et ses lignes brisées qui revient pourtant buter sur la même question – ce qu’est la poésie pour un poète » selon les mots de Valéry Hugotte qui présente avec justesse et retenue l’enjeu de cet ouvrage.Et certes de 1953 à 2006 que de répliques à la nuit. Que de dépenses d’énergie, de coups de foudre pour illuminer et laisser la nuit reprendre possession de son domaine.
37 textes - Ainsi va-t-on de Pierre Reverdy à René Char en passant par Francis Ponge et le encore trop peu connu Jean Tortel sans oublier Philippe Jaccotet et, proche d’entre les proches, « compagnon dans le jardin » : André du Bouchet. Mais aussi Paul Celan, Maurice Blanchot, Georges Schéhadé, Guy Levis Mano, Charles Racine, Octavio Paz,, Edmond Jabès, Jacques Prévert, Paul Auster, Claude Royet-Journoud, Adonis, Vadim Kozovoï, Faraj Bayrakdar, Pierre Chappuis et des plus jeunes tels que Nicolas Pesquès, philippe Rhamy et Jean-Michel Reynouard auteur de cette eau des fleurs, inclassable – 37 commandes/demandes. 37 coups, pioche ou bêche, dans la terre et les pierres des poèmes pour la fracturer, retourner, labourer. 37 prises incertaines de ce qui se joue dans ces « histoires » de désir et de mort dans l’obscurité des mots et la nuit de la langue.
Ces textes de Jacques Dupin nous parlent tous de quelque chose d’essentiel : de « l’incorporation du vide à la poésie » , de « l’énergie de l’angoisse qui oblige d’écrire pour ne rien dire d’autre que l’autre, l’inconnu au féminin, dans le mouverment qui porte à se jeter à l’inconnu, l’inconnu de l’autre et du monde. »
Rarement on aura lu autant de paroles qui nous redressent et nous tiennent. Debouts ? Mieux qui nous « (grandissent) sans nous attacher ».
19:55 Publié dans Du côté de mes interventions | Lien permanent | Commentaires (0)
05/06/2007
À propos de 5 rafles de gérard serée
( Gérard Serée, peintre-graveur, est né à Evreux en 1949 où il commence très jeune à montrer ses œuvres.
Il travaille à Nice et dans son atelier de Cuébris. Il a fondé l’Atelier Gestes et traces.
Il a collaboré à un grand nombre d’ouvrages de bibliophilie. Parmi ses amis poètes qu’il a accompagné par ses gravures et/ou ses collages, on peut citer Christian Arthaud, Daniel Biga, Michel Butor, Alain Freixe, Béatrice Bonhomme, Jacques Kober, Raphaël Monticelli, Bernard Noël, James Sacré, Marie-Claire Bancquart, Yves Broussard, Jean-Marie Barnaud…)
En suspens dans les fonds

De plis en déplis se déroulent des vagues.
Quelles pierres as-tu jeté dans l’eau noire ? Avant les ondes, te souviens-tu de ce froissé des eaux au moment de la percussion? De la fracture de surface? Te souviens-tu de cet enfoncement écumeux qui s'en suivit avec retour des fonds?
C’est cela que j’entends gronder dans la trame de tes noirs. Entre leurs masses. Un roulement sourd d’orages inapaisés.
Comme boursouflés, les heurts de l’ombre et de la lumière s’ouvrent sur des arrières-fonds, d’étranges clairières après d’épaisses frondaisons, aperçues entre deux troncs d’arbres abritant mousses et lichens. Dans leur lumière embuée d’encre et d’eau. Brouillards à peine colorés dans les creux et rehaussés sur les bords. Vifs aux arêtes. Quelque chose flotte. Un corps. Un sac à dos. Vieux et qui attend un temps propice à la sortie projetée. Non, pas des souvenirs, ces peaux mortes. Pas des rêves, ces vapeurs méphitiques. Mais quelque chose qui pèse aux épaules du marcheur, quelque chose dont les sangles tirent, quelque chose qui donne sa tenue au présent de qui chercherait son Mont Analogue…
 D’incisions en balafres, de fentes en refentes, quelque chose émerge de ces rafles sur plaque. Le visage furtif de ce qui nous manque. Et qui déjà se perd à l’avant de ce qui a pris place sur le papier quand la pression se relâche, entre langes et feutres.
D’incisions en balafres, de fentes en refentes, quelque chose émerge de ces rafles sur plaque. Le visage furtif de ce qui nous manque. Et qui déjà se perd à l’avant de ce qui a pris place sur le papier quand la pression se relâche, entre langes et feutres.Contre la paroi des plaques, là où ce sont les mains qui voient, de prise en prise, passe un souffle. Ce coup de vent espace nos yeux. Nous éclaire d'un lieu improbable.
Et, taille-douce dans la langue, les noirs de Gérard Serée nous parlent de ce pays d’à côté d’où nous vient ce qui nous tient.
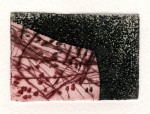
20:25 Publié dans Du côté de mes interventions, Inédits, Mes ami(e)s, mes invité(e)s | Lien permanent | Commentaires (1)
05/05/2007
Lubin Armen / Arménie année du 16 juillet 2006 au 14 juillet 2007

 Que cette occasion de découvrir les valeurs du patrimoine culturel arménien et de mieux connaître l’Arménie, sa culture et son histoire, son passé et son présent – on se reportera au site http://www.armenie-mon-amie.com/ - on ajoute celle de découvrir le poète Armen Lubin. De son vrai nom Chahnour Kerestedjian, il naquit à Istanbul en 1903. Sa vie d’exilé – Il fuira les persécutions de Mustapha Kemal en 1915 à Paris – fut vouée aux souffrances d’une tuberculose osseuse qui le conduira d’hôpital en hôpital jusqu’à sa mort à Saint-Raphaël en 1974. L’essentiel de son œuvre poétique a été repris dans un volume de la collection Poésie/Gallimard préfacé par Jacques Reda : Le passager clandestin, Sainte patience, Les hautes terrasses et autres poèmes en 2005.Seul, démuni, il va devoir s’adosser à notre langue et la faire bouger,la maltraiter comme seuls savent le faire les venus d’ailleurs, les bienvenus :« N’ayant plus de logisPlus de chambre où se mettre,Je me suis fabriqué une fenêtre
Que cette occasion de découvrir les valeurs du patrimoine culturel arménien et de mieux connaître l’Arménie, sa culture et son histoire, son passé et son présent – on se reportera au site http://www.armenie-mon-amie.com/ - on ajoute celle de découvrir le poète Armen Lubin. De son vrai nom Chahnour Kerestedjian, il naquit à Istanbul en 1903. Sa vie d’exilé – Il fuira les persécutions de Mustapha Kemal en 1915 à Paris – fut vouée aux souffrances d’une tuberculose osseuse qui le conduira d’hôpital en hôpital jusqu’à sa mort à Saint-Raphaël en 1974. L’essentiel de son œuvre poétique a été repris dans un volume de la collection Poésie/Gallimard préfacé par Jacques Reda : Le passager clandestin, Sainte patience, Les hautes terrasses et autres poèmes en 2005.Seul, démuni, il va devoir s’adosser à notre langue et la faire bouger,la maltraiter comme seuls savent le faire les venus d’ailleurs, les bienvenus :« N’ayant plus de logisPlus de chambre où se mettre,Je me suis fabriqué une fenêtresans rien autour »
A s’y pencher, on voit passer le monde. Et ses décombres. Ses gravats. Ils blessent le cadre de la chanson. Assombrissent sa lumière. Mais elle persiste pourtant. Et passe. Blanche. Comme un oiseau. Sa flèche. Son chant.
Lubin Armen, encore un de ces poètes plus reconnu que connu !
Voici un poème extrait de Les hautes terrasses publié en 1957 chez Gallimard. poème que d’aucun dirait de circonstances. En est-il d’autres ?
MONSIEUR ARNAUD, BACHELIER
À Arpik Missakian.
Les sans-patrie ont toujours tort
Puisqu'ils transportent du bois mort
Et campent dans de sombres garnis,
Chaque mur y a ses petites hernies.
Car c'est un hôtel moisi et croulant,
Sur une corde se balancent des piments.
Hôtel borgne dont l'œil valide s'infecte,
Hôtel où les réfugiés et leurs dialectes
Se glissent par une vieille porte noircie,
La police reconnaît en elle l'objet de ses soucis.
Elle la vise, se ravise, et ainsi de suite.
12:45 Publié dans Du côté de mes interventions | Lien permanent | Commentaires (0)
02/04/2007
Lu 11 - La lettera amorosa de Jean-Pierre Siméon
( Jean-Pierre Siméon, Lettre à la femme aimée au sujet de la mort, Cheyne Editeur, 2005, 13, 50 euros)
Et voilà que m’arrive cette Lettre à la femme aimée au sujet de la mort de Jean-Pierre Siméon. Une lettre d’amour, cela s’ouvre un peu à contre jour. À l’abri, dans le calme et le repos. Pour une joie.
Les poèmes de Jean-Pierre Siméon « (ôtent) la pierre sur (nos) souffles ». oui, dans l’excès de leurs coups de vent – ce lyrisme qui « (sait) être dans le cri / sans le cri » - ils nous aident à déchirer l’asphyxie qui nous menace. Avec eux, l’air accourt, la fraîcheur, la tendresse de « cet autre cœur / qui n’est pas un muscle ». Oxygéné de cet air autre qui fait claquer les mots des poèmes, il s’ouvre « au sens inexprimé des choses ».
Lyrique, Jean-Pierre Siméon ? Oui, c’est un grand remueur et rumineur de mots. En images, ils remontent des quatre coins : Amour, révoltes, mort, vie. Saturés de richesse, ils se clarifient au feu de l’effusion. Alors la verdeur du chant se prend à eux. On reconnaît bien là le directeur artistique du Printemps des poètes, sa fougue mise au service de la poésie, cette manière bien à lui de traverser le monde avec étonnement et générosité, ferveur et fermeté. Poésie qui sous toutes ses formes « mets les pieds dans le plat de l’existence » !
22:03 Publié dans Du côté de mes interventions, Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0)
26/03/2007
Turbulence 10 - Clermont-Ferrand-1987/2007- Vingt ans de poésie, et au-delà
René Char
Je reviens de Clermont-Ferrand. Invité par la Semaine de la poésie pour son XXème anniversaire, fêtant pour l’occasion son fondateur, notre ami Jean-Pierre Siméon.
Se faire passeur de poésie est affaire de patience. L’autre rive n’est jamais très visible et la lenteur préside à la traversée. Celle qui n’évite pas l’errance, les doutes, parfois même les chutes mais sait se garder de celles, mortelles, dont on ne se relève que dos maçonné et regard rayé de mauvaise nuit.
Oui Jean-Pierre a raison : « Si l’écriture du poème nous apprend quelque chose, c’est d’abord ceci : il faut du temps pour faire sens et le chemin vers le sens implique les risques du chemin, tâtonnements, fatigues, impasses, éternels recommencements… »
Oui, Françoise Lalot et sa « brigade de fées organisatrices» de la Semaine de la poésie de Clermont-Ferrand ont raison, « il faut que le chemin perdure »
Oui, nous avons raison, nous autres d’ici, Yves Ughes, Raphaël Monticelli, Jean-Marie Barnaud, sophie Braganti d’animer qui La poésie a un visage à Grasse -10 ans en 2008 ! – qui La poésie des deux rives dans les pays du paillon – 7 ans déjà ! – qui les Rencontres des Ecritures Poétiques et leur Lézard amoureux – www.ac-nice.fr/daac/lézard -qui le printemps des poètes à Nice, avec tous ceux enseignants, poètes, bibliothécaires, éditeurs, artistes, enfants, adolescents, élus, bénévoles... dont le compagnonnage est nécessaire pour que rencontrer la poésie d’aujourd’hui, cette langue qui ne se soumet pas à être privé de sens, soit possible de la maternelle au lycée et plus généralement, dans les institutions et la cité.
 Je reviens avec le livre des vingt ans édité par la Semaine de la poésie ( prix 10 euros, IUFM d’Auvergne, 36 Avenue Jean Jaurès, CS 20001, 63407 Chamalières cedex)magnifiquement titré Que l’éclair nous dure. Vous y trouverez les courts textes des intervenants de cette année : Marc Blanchet ; Louis Dubost ; Chantal Dupuy-Dunier ; Jean-Pierre Farines ; Alain Freixe ; Albane Gellé ; Jacques Jouet ; Christiane Keller ; Hervé Le Tellier ; Philippe Longchamp ; Jean-François Manier ; Nimrod ; Jean-Baptiste Para ; Emmanuelle Pireyre ; Thierry Renard ; Marie Rousset ; Valérie Rouzeau ; Alain Serres ; Jean-Pierre Siméon ; Claude Vercey.Pensant à René Char, qui s’inquiétait de l’avenir de la rencontre dans lces très beaux bandeaux de « Claire » (La pléiade, p.654/655), repensant à quelques rencontres marquantes, j’ai donné comme titre à mon texte :
Je reviens avec le livre des vingt ans édité par la Semaine de la poésie ( prix 10 euros, IUFM d’Auvergne, 36 Avenue Jean Jaurès, CS 20001, 63407 Chamalières cedex)magnifiquement titré Que l’éclair nous dure. Vous y trouverez les courts textes des intervenants de cette année : Marc Blanchet ; Louis Dubost ; Chantal Dupuy-Dunier ; Jean-Pierre Farines ; Alain Freixe ; Albane Gellé ; Jacques Jouet ; Christiane Keller ; Hervé Le Tellier ; Philippe Longchamp ; Jean-François Manier ; Nimrod ; Jean-Baptiste Para ; Emmanuelle Pireyre ; Thierry Renard ; Marie Rousset ; Valérie Rouzeau ; Alain Serres ; Jean-Pierre Siméon ; Claude Vercey.Pensant à René Char, qui s’inquiétait de l’avenir de la rencontre dans lces très beaux bandeaux de « Claire » (La pléiade, p.654/655), repensant à quelques rencontres marquantes, j’ai donné comme titre à mon texte :À Eliot,
Aux femmes et aux hommes – jeunes encore ! - que j’appelais – Dix ans déjà ! – les enfants-du-pied-des-tours de la ZEP La Charme,
À mon sens, l’immense mérite de cette Semaine de la poésie est de donner chance à la rencontre.
Seule, la rencontre est fécondante. Son « angle fusant » ne se résume ni dans la présence du poète, cet intervenant extérieur supposé en savoir plus que les autres sur ce dont il s’agit , dans une classe, ni dans la manière dont cette classe a été préparée par l’enseignant. Encore que pour se rencontrer, il convient que l’on se soit donné rendez-vous et quelque peu apprivoisé, et en ce sens le travail de l’enseignant est tout à fait important - Dirais-je qu’au cours de mes nombreuses interventions, au fil des ans, il n’a pratiquement jamais été pris en défaut? - Il lui appartient de préparer la venue du poète, de soigner cette attente, de la nourrir et la creuser d’interrogations, de lectures, etc...
Mais, ce qui importe ce n’est pas encore cela. Ce qui importe ce n’est ni le poète, ni la classe elle-même, mais leur rencontre, soit cet entre-deux, cette dimension à chaque fois neuve et inouïe d’un je et d’un tu, cet espace tiers entre un toi et un moi, espace autre par où passer est possible.
C’est dans cette rencontre que je définirais volontiers par ses qualités, soit ce sens des entours - timbre, tons, résonances, couleurs... - que se joue la transmission.
Et n’est -ce pas de cela dont il s’agit dans cette Semaine de la Poésie?
Ne s’agit-il pas d’être des passeurs de poésie?
19:15 Publié dans Dans les turbulences, Du côté de mes interventions, Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (1)




