25/02/2007
Un peintre et des poètes, Jean Capdeville à Carcassonne du 1 décembre 2006 au 31 mars 2007
"Un auteur chante, je danse autour", Jean Capdeville
Nous sommes à Carcassonne. Dans la Maison des Mémoires, au 53 rue de Verdun où vécut Joë Bousquet. Le centre Joë Bousquet et son temps qui s'intéresse aux relations "écriture/peinture" depuis sa création en 1999 a invité Jean Capdeville à montrer ses livres peints.
L'exposition est à couper le souffle. Vitrines rythmées par quelques-unes de ses toiles où les mots inscrtits de sa main - ceux d'Edmond Jabès, André Du Bouchet, Paul Celan, Jacques Dupin..; plus une bonne dizaine d'autres dont Simone Weil, Yves Peyré, Serge Pey...les siens aussi, parfois - sont tirés du noir par quelques feux tournants dont les cendres blanches demeurent encore vibrantes, rayonnantes dans la dimension d'un possible toujours ouvert.
Né en 1917 à Saint-Jean de l'Albère (Pyrénées Orientales), Jean Capdeville vit et travaille à Céret. Il a gardé de l'enfance deux yeux étonnés. Rieurs et malicieux, ils vont avec un sourire que son visage bruni à toutes les tramontanes et caressé de tous les soleils, laisse s'épanouir.
Vers les années 1950, deux événements modifient son orientation : la peinture romane et les écrits de la philosophe Simone Weil...«... Les notes de Simone Weil me fichaient alors une secousse, des couleurs donc, des traits, des moyens très simples, minces même, des à plats cernés. La richesse, la vraie, intense dedans...»
Pour ses relations avec les poètes et les philosophes, le peintre Jean Capdeville explique ainsi sa démarche :
«Des livres illustrés - un auteur chante, je danse autour, avec l'imprimeur et l'éditeur aussi bien sûr -Mon premier livre, en 1968, avec des poèmes de Georges Badin «traces», a été imprimé et édité par Gaston Puel à Veilhes. Quatre choses de moi étaient prévues, reproduites en clichés simples «au trait» que je voulais reprendre à la main. Je n'ai pas aimé les clichés après tirage ; les chosess'écrasaient dans le papier et devenaient lourdes. J'ai repris les clichés, à la main, en les recouvrant de peinture ; sur la lancée, j'ai rempli pareillement 13 pages d'images ; le tout dans un tirage de soixante exemplaires. Renouant ainsi avec les tout premiers livres imprimés et enluminés. Intervenir directement, pour un tirage normal à gravures, était devenu chez nous, dans l'édition, depuis les premiers temps de l'imprimerie un processus totalement étranger ; tout étant mécanisé.L'évolution de l'approche picturale, plus franchement liée au geste et au sériel, autorisant la multiplication des images dans la rapidité et le nombre, mais toujours une à une. Quelques livres au départ : Hommage à Simone Weil, Georg Christoph Lichtenberg, «notes de lectures» en livres,«Ludovic Massé» - tous pareillement illustrés, peintures, réécrits moi-même ou bien en typo locale artisanale. Par la suite tout s'est fait dans la prise en charge matérielle d'éditeurs d'art et de leur imprimerie...»
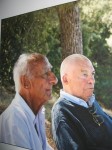
C'est cette danse qui nous est donnée à voir.Autant de livres, autant de "Fièvres de paix" écrit Yves Peyré, cela suffit pour une joie! Son dernier livre est une collaboration avec Jacques Dupin. Bleu et sans nom est publié par Jean Lissarague aux éditions l'écart. Peinture et poésie se touchent comme deux voix étrangères et complices, respectueuses de leurs différences. Affaire de rythme!
© Alain Freixe
22:05 Publié dans Dans les turbulences, Du côté de Joë Bousquet, Du côté de mes interventions | Lien permanent | Commentaires (0)
18/02/2007
René Char-Lettera Amorosa et ses entours
Dans le numéro de la revue Europe – N°705/706, janvier/février 1988 - consacré à René Char, Nelly Stéphane signe un article intitulé L’amour. On apprend qu’il reprend le titre de la revue Le genre humain que dirige aux éditons du Seuil Maurice Olender, professeur à l’Ecole des hautes études en sciences sociales à Paris, de l’automne-hiver 1985/1986. On apprend également que pour cette livraison René Char choisit lui-même dans ses Œuvres complètes de La Pléiade sept poèmes . Ainsi à côté de la Lettera amorosa, p.341, on trouve :
- Singulier, Arsenal in Le marteau san maître, p.10
- Vivante demain, Poèmes militants in Le marteau san s maître, p.36
- Madeleine à la veilleuse, La fontaine narrative in Fureur et mystère, p.276
- L’amoureuse en secret, Le consentement tacite in Les matinaux, p.313
- La chambre dans l’espace, Poème des deux années in La parole en archipel, p.372
- Madeleine qui veillait, Pauvreté et privilège in Recherche de la base et du sommet, p.663
Chacun pourra rajouter bien d’autres poèmes à ceux choisis par René Char, Allégeance, par exemple, La fontaine narrative in Fureur et mystère, p.278.
Pour moi, même si je ne saurais oublier La complainte du lézard amoureux, La sieste blanche in Les matinaux, p.294 à cause du lagarto de Lorca et de Miro et surtout à cause du Lézard amoureux de notre académie (http://www.ac-nice.fr/daac/lezard/)…pour moi, ce serait Marthe, Le poème pulvérisé in Fureur et mystère p.260. Marthe comme chant d’amour engageant à partager une présence celle dont « l’acte est vierge, même répété », chant rompant avec ce « dur filament d’élégie » dont parlait Mario Luzi qui narcose toujours un peu plus le cœur. Marthe dont René Char écrit qu’elle est « le présent qui s’accumule ».
23:21 Publié dans Du côté de mes interventions | Lien permanent | Commentaires (2)
31/01/2007
LU 10 - Clarté sans repos d'Antonio Gamoneda
22:56 Publié dans Du côté de mes interventions, Inédits | Lien permanent | Commentaires (2)
Lu 9 - Les silences du passeur de Jean-Max Tixier
C’est à partir de lui que jean-Max Tixier peut affirmer « parler pour n’être pas vaincu ». Car c’est ici que tout se passe. Ici qu’est l’autre rive. Ici et dans l’amour de la « femme de fin dernière », entrer dans la sérénité du froid mais « dans le soleil » et « épouser l’immobilité ». Et cela n’est pas se résigner mais « changer d’avenir ».
« Mes mots donnent la chair / à ce qui n’en a pas » écrit Jean-Max Tixier. À quoi je rajouterais volontiers qu’ils ouvrent des yeux dans la langue que tant de choses aujourd’hui ferme, replie sur elle-même, emprisonne dans une absence de sens coupable. Jusque dans ses « silences », le « passeur » nous assure encore que le feu de poésie peut prendre dans la langue et l’on sait, aujourd’hui comme hier, combien sa lumière et sa chaleur nous sont nécessaires.
22:52 Publié dans Du côté de mes interventions, Inédits | Lien permanent | Commentaires (0)
09/12/2006
Turbulence 7 - Jérôme Bonnetto, Vienne le ciel et le personnage de roman
Le personnage comme être de langue, c’est là une voie de poète. Le personnage qui en sort ne peut qu’en demeurer marqué. D’où l’importance pour lui des monologues intérieurs. Ada est d’abord un phénomène de langue. Du coup les autres personnages de Vienne le ciel, le photographe surtout, Alexandre même ont moins de présence.
Pour les poètes, le langage n’est pas un simple instrument de communication, il est ce qui toujours naît au point de friction de notre conscience et du monde. Là, des images, un rythme qui s’habille de mots, naissent.
Dirais-je qu’une fois trouvée la langue et donc le personnage, le danger que court un romancier tel que Jérôme Bonnetto, c’est de tomber amoureux de son personnage. Pourquoi danger ? Parce qu’il risque de s’enivrer de sa musique et oublier le drame du sein duquel est né le personnage, non ?
23:20 Publié dans Dans les turbulences, Du côté de mes interventions, Inédits | Lien permanent | Commentaires (5)
25/11/2006
Yves Ughes/Alain Freixe - Soirée « Rappelez-vous… »
22:55 Publié dans Du côté de mes interventions | Lien permanent | Commentaires (0)
21/11/2006
André Frénaud, poète métaphysique?
(Texte remanié d'une conférence prononcée à La Maison de la poésie de Grasse le vendredi 17 novembre 2006 à l'invitation de l'association Podio qui travaille pour "la défense et 'illustration de la poésie à Grasse.
J'invite ceux qui souhaiteraient prendre connaissance des poèmes lus lors de cette intervention à se procurer les livres. L'oeuvre poétique d'André Frénaud se trouve maintenant disponible sous la forme de 5 volumes dans la collection Poésie/Gallimard)

« Oublions les choses, ne considérons que les rapports"
Braque

Et d’abord pourquoi André Frénaud ?
Peut-être à cause de ces mots de Bernard Noël rencontrés dans son article sur jacques Dupin paru dans Strates, volume collectif dirigé par notre ami Emmanuel Laugier : « Peut-être Jacques Dupin a-t-il des frères en Pierre-Jean Jouve et en André Frénaud, il n’a pas de semblable », mots qui font signe vers une voix, un timbre singulier, une manière unique de remuer la langue et de la faire sonner de manière tantôt assourdie et tantôt agressive…
Peut-être à cause de cette solitude dans le paysage poétique des années 50/80 qui le voit persister alors que s’imposent fragments et dis-jonctions à écrire de longs poèmes qui sont autant de vastes méditations, autant « d’affrontements de la nuit qu’il avait en lui », selon les mots d’Yves Bonnefoy.
Peut-être à cause de ces mots anciens de Montale qui en 1953 écrivait : « La poésie est appréhendée par lui comme un acte vital qui porte et résout en soi toutes les contradictions par le fait même de les vivre (…) c’est le seul monde où puisse évoluer u !n homme comme André Frénaud, poète de grande culture, mais qui ne croit pas à « la littérature », individualiste, sinon anarchiste, disons un esprit réfractaire qui ressent pour les hommes une « piété » infinie et qui ne pense pas qu’on puisse les racheter à coups de trique, comme on le fait des brebis égarées. »
Ou ceux de mon ami Gaston Puel qui dirigea en1981 un N° spécial de la revue Sud sur André Frénaud et qui écrivait dans sa préface que ce dernier « se (présentait) à nous comme l’un des poètes français les plus nécessaires à notre survie d’homme de 1981 »
Peut-être à cause des paradoxes que souligne Gaston Puel: - homme qui commence par la fin. Ainsi le poème Epitaphe qui date de 1938 et ouvre son livre Les rois mages paru en 1944 chez Seghers
Lecture de Epitaphe, Les Rois mages, Poésie/Gallimard, p.15 (30 ‘’)
- homme qui aime les hommes mais qui écrit un ‘je me suis inacceptable » !
- athée qui ne cesse de revisiter la tradition chrétienne
- révolutionnaire tôt revenu de ses rêves mais qui pas de son idéal de justice
- amoureux de la nature qui déclare que « toujours les grandes villes (l’)ont troublé plus que la nature qui est trop claire et qu’elles seules donnent « le sentiment de ce que l’on n’atteint pas »
- amoureux de son « vieux pays » de Bourgogne mais qui avoue s’être épris définitivement de l’Italie et peut-être à un degré moindre de l’Espagne.
On pourrait continuer...
18:05 Publié dans Du côté de mes interventions, Inédits | Lien permanent | Commentaires (0)
15/10/2006
Lu 8 - La parole-lichen d'Antoine Emaz
( Antoine Emaz a publié en 2004 aux éditions Tarabuste avec des dessins de Djamel Meskache, Os.)
Là où le sol manque – ou un peuple, si l’on a lu Gilles Deleuze – la parole pour peu qu’elle sache se faire lichen n’est pas tout à fait démunie. Cette « parole lichen » est celle qui dans le poème d’Antoine Emaz tient toute sa poésie. En constitue la veille . Discrète et obstinée. Endurante. Quoiqu’il arrive. Elle se développe dans ce livre en 34 poèmes-lichens tous datés et disséminés sur de 5 mots-rocs : os, calme, ombre, peur et vieux.
Et qu’est-ce donc qu’une « parole lichen » ?
22:55 Publié dans Du côté de mes interventions | Lien permanent | Commentaires (0)
19/09/2006
LU 7 : La méthode Stanislavski de Claire Legendre
La méthode Stanislavski, on tourne autour de ce titre de Claire Legendre publié chez Grasset, soit parce qu’on sait – ou croit savoir – ce qu’il en est de ce chemin supposé sûr puisqu’on s’intéresse par ailleurs au théâtre et que forcément on a rencontré Stanislavski, soit parce que plus simplement on a lu la quatrième de couverture !
Ainsi va la lecture, on tourne les pages sans cesser jamais de se demander comment le récit qu’entreprend Graziella Vaci, pensionnaire de la villa Médicis à Rome, fascinée par cet « emblème de notre génération perdue » qu’est à ses yeux S.A.R, tueur des trains, et qui débouche sur l’écriture d’un scénario de film vite transformé en pièce de théâtre dont un metteur en scène connu, Vlad, va vouloir assurer le devenir scénique ; oui, comment ce livre va finir par tendre vers son titre. Et faire flèche.
On le sait la méthode de Stalisnavski ne concerne pas le roman – Qui connaît Claire Legendre sait que de Making off ( éditions Hors Commerce, 1998, repris in J’ai lu) à Matricule (Grasset, 2003) en passant par le très médiatisé Viande (Grasset, 1999), il n’y a pas de méthode chez la jeune romancière, tout au plus, et j’emprunterai ces mots à Jean Echenoz que l’on croise – en clin d’œil admiratif ? – dans La méthode Stanislavski, « une appréhension, aux deux sens du terme, de ce qu’on veut raconter et de la façon dont on veut le raconter » - mais bien le théâtre et plus particulièrement la formation de l’acteur, titre traduit de l’américain et préfacé par Jean Vilar en 1958, et la construction du personnage.
On pourrait dire de ce livre de Claire Legendre qu’il est un roman policier. Et certes tous les ingrédients sont présents : un meurtre, un séduisant commissaire, un assassin, la villa Médicis et le monde de l’art contemporain pour décor …Et j’aime, dans ce livre, la montée lente vers le terrible, me plais à l’ironie douce de quelques descriptions – La villa Médicis que je ne connais pas comme le festival du livre de Nice que je pourrais connaître mais dont je me garde encore – à cet art de l’intrigue que Claire Legendre maîtrise : fausses pistes, impasses, rebondissements, mobiles souterrains, calculs, non-dits… toute cette réalité où l’on ne s’avance que masqué comme l’autre sur le grand théâtre du monde, des amours et des fêtes – nous sommes à Rome ne l’oublions pas, Rome et son décor, ses flèches baroques, ses trompe-l’œil, ses faux-semblants et ce parfum de secret qui flotte, ces passions tues. Mais ce serait en amoindrir l’enjeu et la portée puisqu’on ne pourrait le comparer qu’aux romans du même genre.
Alors ? Dire qu’il s’agit d’un livre sur le théâtre serait bien court et réducteur. Ce roman est le livre d’un autre texte dont nous ne connaîtrons que quelques passages, bribes d’un objet littéraire laissé en amont, non perdu sinon voué à passer dans les corps des acteurs Léa et Ali. Texte voué à devenir parole, à produire du jeu, à être porté sur la scène par l’entremise de Vlad, fervent partisan de la méthode de Stanislavski. Parodiant René Descartes, on pourrait dire « pour bien conduire » l’acteur « à chercher la vérité » du personnage à partir de sa propre vérité, si par ce terme on entend sa « mémoire affective » : matériaux disparates d’affects, sentiments, souvenirs…Livre d’une fascination moins pour les tueurs en série finalement que pour les metteurs en scène qui inventent le spectacle avec les acteurs, aidant à l’apparition de la parole et donnant à la présence de l’acteur tout son poids, courant le risque de la vérité.
Avec la méthode de Stanislaski, il n’est plus question de grimace ni d’artifice. L’expérience traverse la technique. La déborde. Un événement advient qui subvertit la représentation même. Là, le texte littéraire peur rencontrer sa corne – Vous vous souvenez de Michel Leiris, de sa « littérature considérée comme une tauromachie » ? « Faire un livre qui soit un acte » était son désir le plus vif – et devenir, sur le plateau, ce qu’il était mais en puissance seulement. Jouant, l’acteur énonce la parole, arrive à se mettre à l’endroit où la parole devient possible. Concrète. Réelle. Parole qui aura prise, fera trait – cette flèche et sa plaie – sur le spectateur. Traversé par la parole, il est parlé si loin qu’il en bégaye avant de se taire. Silence, terreau pour l’acte en fleur. Ici, un crime. Le Mal.
Que dire de l’écrivain, de la littérature sans cette « part maudite » du jeu, de l’alea, du danger ? Oui, que dire ? Et Claire Legendre en claire jeune fille s’esquive non sans nous adresser, se retournant, un énigmatique sourire.
© Alain Freixe
15:05 Publié dans Du côté de mes interventions | Lien permanent | Commentaires (0)
11/09/2006
Lu 6 : Viendra-t-il le ciel?
Il y a tant de choses que nous ne verrons pas ! Tant de nuits à l’intérieur du jour. À rôder en lisière, sur les bords déchiquetés des hommes quand ils aiment. La littérature s’affronte toujours à la même question : comment raconter l’irracontable ? Et toujours tentant cela, toujours ses pages nous font entrevoir sinon cette nuit du moins les premières vagues d’une d’entre elles.
Pris entre beauté convulsive des surréalistes et construction maîtrisée du Nouveau Roman, Vienne le ciel est un beau récit, publié aujourd'hui par les éditions de l'Amourier dans leur collection Thoth. Beau d’être aussi troublant. Qu’une « mère soit le cadavre d’une femme amoureuse », si cela ne peut se dire, cela peut s’écrire. Se composer. C’est tout l’art de Jérôme Bonnetto que de bâtir un récit comme une mosaïque où jouent des voix narratives multiples. L’effet de brouillage dure peu, très vite on repère les différentes tesselles , leurs couleurs et nuances. Jamais on ne perd le fil du chemin invisible, ligne de fracture interne qui parcourt l’épaisseur et l’obscurité de la vie d’Ada comme dans ces cristaux si transparents qu’on finit par y noyer ses yeux.
Allez, comme de juste, je vais m’exécuter et m’efforcer de répondre aux fameuses questions ; de quoi ça parle ? Qu’est-ce que ça raconte ? Pour le dire vite et j’espère pas trop mal : un photographe – on a son carnet – propose à une jeune femme, Ada, de la photographier tout au long d’un « voyage sentimental » qui va les conduire de Prague à Paris, puis Tokyo, Petersbourg, encore Prague et enfin une ville imaginaire, celle de ce dernier chapitre où se mêlent alors qu’un bateau s’en va emportant l’homme aimé, les voix d’Ada et de son fils Alexandre. Alors pour que vienne le ciel, une mère demande à son fils de la tuer en lui brisant la nuque au moyen d’une pierre, celle-là même qu’il est devenu. Pour que Vienne le ciel, il faudra bien des prières. Des folies. On laissera aux lecteurs le soin de décider s’il viendra ou pas.
Compositeur ai-je dit, monteur aussi bien. Dans ce récit où la problématique photographique, cette folie de l’instantané, cette fraction, ce point de présent déjà enfui se croise avec la problématique littéraire qui se développe, elle, à l’aventure, les éléments se mettant en place chemin faisant – écrire ne saurait se faire qu’au présent . Dans les deux cas, on cadre. On coupe. Comme le tailleur de tesselles. Puis on met en place. On agence. On monte. Douleur et lumière de ce qui tient on ne sait plus trop comment tellement les lignes de narration deviennent souples et comme poreuses. Comme dans ce dernier chapitre où sans le soutien d’une quelconque ponctuation s’impose le rythme qui emporte ce chant d’amour. Et de mort.
© Alain Freixe
13:55 Publié dans Du côté de mes interventions | Lien permanent | Commentaires (0)
10/09/2006
Lu 5 : Serge Bonnery, homme du Midi noir
Après "Une patience", ce récit qui à partir d’un objet – cette planchette percée d’une rainure, dont les soldats se servaient pour astiquer leurs boutons – laisse s’opérer – avec « un tremblé dans l’écriture » dont Yves Ughes disait qu’il « était cultivé comme un acte de fidélité » - un lent travail de mémoire autour de la figure d’un grand-père, ancien poilu de 14-18 ; après Le temps d’un jardin où le grand-père est convoqué mais cette fois comme donateur de « l’amour des choses terrestres », voici "Les roses noires", aux éditions de l'Amourier, collection Thoth, une histoire d’amour, un récit d’enfance si l’enfance n’est pas seulement un âge de la vie repérable sur la ligne du temps mais ce qui n’arrive jamais à se dire. Et comme tel fait retour. En fantôme obstiné.
Le tempo de l’écriture de ces trois livres diffère. Les roses noires sont un texte qui fait du silence et du secret, de l’attente, du mystère et de l’oubli, son sujet. Quelque chose se tient caché dans ce texte, quelque chose qui est ignoré du texte lui-même. Et c’est peut-être de savoir ce que c’est que d’aimer…
Si le récit est bien le lieu même de la mémoire ; si raconter, c’est bien conserver, maintenir au plus près ce qui fut vécu, Les roses noires nous content l’histoire d’une perte. Ce qui a été vécu, la mémoire même du narrateur se trouve dans un carnet, Le cahier noir de Jean, qu’il finit par ne plus retrouver…Du coup, Les roses noires pourraient être lues comme la tentative de reconstituer l’histoire consignée dans le cahier noir. De là son apparence labyrinthique, ces pans de narration que le narrateur s’efforce en même temps de comprendre et d’interpréter afin d’en faire apparaître la part de vérité. Ruines d’une écriture rompue, en miettes. En charpie.
L’écriture de Serge Bonnery, ses modulations développent un phrasé, un tempo qui tend un fil invisible entre ces moments de vie. C’est lui qui fait bouquet de ces roses noires.
Et c’est au lecteur de les disposer dans le vase qu’il aura choisi.
© Alain Freixe
22:30 Publié dans Du côté de mes interventions | Lien permanent | Commentaires (0)
Lu 4 : Jacques Dupin, homme des sources
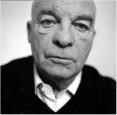 Coudrier, le livre de Jacques Dupin qui vient de paraître chez POL, est la baguette qu’il nous confie. Prenez-la en mains. Laissez venir. Ce livre est tout entier en contact avec un pur Dehors que traversent courants d’énergie, fluxions et fluctuations.
Coudrier, le livre de Jacques Dupin qui vient de paraître chez POL, est la baguette qu’il nous confie. Prenez-la en mains. Laissez venir. Ce livre est tout entier en contact avec un pur Dehors que traversent courants d’énergie, fluxions et fluctuations.
Lisez, vous ne pourrez pas ne pas entendre comme un balbutiement têtu, celui-la même qu’il repérait chez Joan Miro : «Le balbutiement nous touche plus instinctivement, ou plutôt bouscule en nous de la pensée enfouie, de la parole informulée (…) perçant lentement à travers les stratifications d’un autre règne ». Quelque chose qui ne cesse pas de murmurer, dans les basses, au plus près de soi quand soi n’est plus que vide, n’est plus dedans. Ou plutôt que le dedans est dehors, pauvres eaux qui vont s’ajustant aux pierres d’un torrent souterrain, frêles eaux qui obstinées poursuivent leur cours.
C’est cela que l’on entend, cela qui fait signe, selon les mots de Pierre Reverdy, vers ce « noir qu’on n’a pas vu derrière les étoiles », dans ce dernier livre de Jacques Dupin.
© Alain Freixe
22:25 Publié dans Du côté de mes interventions | Lien permanent | Commentaires (0)









