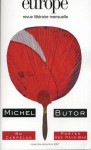01/07/2008
René Daumal aurait cent ans
"La porte de l'invisible doit être visible." René Daumal
Né le 16 mars 1908 à Boulzicourt dans ce pays des Ardennes, on lui doit ce clin d'oeil à Arthur Rimbaud : "Oui, nous sommes tous de la race d'Antée, et pour mon compte, je dépérirais vite si je n'allais chaque semaine piétiner, palper et souvent fouiller, râcler, retourner le ventre maternel. Paysan!" ( le 29/07/1932 à Rolland de Renéville).
Avant Le mont analogue - cette ascension inachevée d'un sommet inaccessible", ce voyage vers la Réalité, vers la "vraie vie" - on relira La vgrande beuverie - cette satire du monde des "hommes-creux", critique féroce des postures et des impostures de ses contemporains; on s'efforcera de prendre la mesure des efforts par lesquels, dans cette expérience qu'est la poésie, le poète René  Daumal essaya d'être un "poète blanc", s'arrachant aux rivages où il fut "poète noir", tout en reconnaissant que "de fait, toute poésie humaine est mêlée de blanc et de noir" : mais l'une tend vers le blanc, l'autre vers le noir" (cf. Poésie noire et poésie blanche in Le contre-ciel, Poésie/Gallimard); on visitera cette période des années adolescentes (1926-1932) qui le verra en compagnie de Roger-Gilbert Lecomte, Roger Vailland et quelques autres "phrères simplistes" tels que Pierre Minet du lycée de Reims créer le groupe - se joindront alors à eux à Paris Hendrik Cramer, Artur Harfaux, Maurice Henry, André Rolland de Renéville, Josef Sima...- et la revue Le grand jeu - 3 numéros entre 1928 et 1930 - et débattre avec son aîné André Breton et le groupe surréaliste.
Daumal essaya d'être un "poète blanc", s'arrachant aux rivages où il fut "poète noir", tout en reconnaissant que "de fait, toute poésie humaine est mêlée de blanc et de noir" : mais l'une tend vers le blanc, l'autre vers le noir" (cf. Poésie noire et poésie blanche in Le contre-ciel, Poésie/Gallimard); on visitera cette période des années adolescentes (1926-1932) qui le verra en compagnie de Roger-Gilbert Lecomte, Roger Vailland et quelques autres "phrères simplistes" tels que Pierre Minet du lycée de Reims créer le groupe - se joindront alors à eux à Paris Hendrik Cramer, Artur Harfaux, Maurice Henry, André Rolland de Renéville, Josef Sima...- et la revue Le grand jeu - 3 numéros entre 1928 et 1930 - et débattre avec son aîné André Breton et le groupe surréaliste.
Que cet anniversaire soit l'occasion de redonner à lire le René Daumal de Joë Bousquet qui, à Carcassonne, créa en 1928 la revue Chantiers laquelle accueillera, malgré son ancrage dans le surréalisme via Paul Eluard, quelques membres du Granjeu comme André Delons, josef Sima...Cet ouvrage que vous trouverez au catalogue des éditions Unes comprend outre la fin de Traduit du silence - Attention! Non le texte que Jean Paulhan tirera en 1941 des quelques mille pages qu'il emportera de la chambre de Carcassonne mais celui publié en date du 20 mai 1939 et constituant le N°65 des Cahiers du journal des poètes - ; un hommage paru dans le N°272 des Cahiers du sud et enfin une lettre inédite du 2 juin 1932 de Bousquet à Jean Ballard, directeur des Cahiers du sud; le tout mis en situation par Bernard Noël dont je relèverai l'affirmation selon laquelle finalement il importe peu que le temps n'ait rendu justice ni au Grand Jeu, ni à Bousquet "car c'est la mort qui fixe et statufie: nous, les vivants, ne savons jamais ce qu'elle mettra à notre place pour déguiser l'absence. Le Grand Jeu n'est pas plus un sous-groupe surréaliste que Bousquet n'est "un" écrivain, lui qui cache sous son nom tout un mouvement anonyme, dont les voix multiples n'en finissent pas de troubler l'eau du regard trop chargée de présence et n'en finissent pas non plus de faire fleurir des visages au bord de l'amour devenu, par lui, énergie de la langue." On ne saurait mieux dire. Ces hommes se tiennent comme des rôdeurs, en bordure des routes, adossés aux fossés, les yeux perdus dans "les confins de la lumière et de la nuit impénétrable", là où le regard se traverse de son propre coeur.
Ce que Bousquet dit de Daumal, je le dirais des deux, et volontiers des trois - Bernard Noël compris! -: n'en perdons aucun de vue, la vertu de poésie est intacte chez eux! C'est qu'avec Bousquet, ils considèrent comme une véritable et redoutable entreprise le fait de ne plus séparer vie artistique et vie morale, de ne plus admettre comme oeuvre littéraire digne de ce nom, c'est-à-dire capable de faire oeuvre de vie, et non de donner du rêve à consommer aux anesthésiés que nous sommes, que celles où la personne morale se trouve engagée.
15:20 Publié dans Du côté de mes interventions, Inédits | Lien permanent | Commentaires (0)
02/06/2008
Lu 25 - Coleridge, La ballade du vieux marin
( Vient de paraître, Samuel Taylor Coleridge, La ballade du vieux marin et autres textes, Poésie/Gallimard, Cat 7)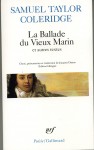
Oui, et pour plusieurs raisons. Dans une très éclairante préface Jacques Darras qui a assuré la traduction de ces textes – l’essentiel de l’œuvre poétique de Coleridge - s’attache à mettre en évidence ses errances de marcheur puissant – Il faut l’imaginer en « voyageur perdu au-dessus d’une mer de nuage », de dos, les yeux perdu au loin surplombant la nature sauvage du pays de Galles et des Lacs du côté de son ami le poète Wordsworth avec qui il composera durant l’année 1797 ces Lyrical ballads, publiées sans nom d’auteur, qui vont « révolutionner la sensibilité poétique » d’alors – ou de voyageur – Avant les deux années passées à Malte entre 1804 et 1806 d’où il reviendra profondément changé physiquement, ce sera l’Allemagne où il séjournera entre septembre 1798 et décembre 1799, année de rupture où il découvre les philosophies de Kant, Schelling et Hegel et d’où il reviendra profondément changé intellectuellement.
Romantique, certes, mais avec un pied déjà dans la modernité comme en témoigne son amour pour les grandes villes, Londres notamment où il retournera toujours pour ses lieux de parole : cafés, salles de conférence.
Pour Jacques Darras, il est la figure exemplaire de « l’esprit européen (…) pionnier, découvreur de langues, de littératures et de sensibilités », figure malheureuse tant il eut à vivre la césure entre sensibilité et rationalité, poésie et philosophie. De fait, les grands poèmes de Coleridge sont tous d’avant son séjour en Allemagne. Tout se passe comme si à 26/27 ans il « s’opérait vivant » de la poésie comme Mallarmé le dira plus tard pour Arthur Rimbaud !
Il faut lire ces poèmes dont la célèbre Ballade du vieux marin, cette errance maritime d’un vieux marin coupable d’avoir tué un jour un albatros, « l’oiseau par qui le vent soufflait ». C’est dans ses mots qu’erre le vieux marin. Et nous avec lui, pris au filet de sa parole, renvoyés à notre propre errance de sujet sans place. À l’image d’un souffle sur la mer, ainsi allons-nous !
21:57 Publié dans Du côté de mes interventions, Du côté de mes publications, Inédits | Lien permanent | Commentaires (0)
01/04/2008
Lu 24 - Eugénio De Andrade, Matière solaire suivi de Le poids de l'ombre et de Blanc sur blanc
 Nul besoin d’être spécialiste. À parler de poésie portugaise le nom de Pessoa et des hétéronymes qui lui font cortège s’impose. C’est une montagne avec plis et replis, sommets et fonds de vallée creusés par les terreurs de l’identité et du manque d’être. C’est un paysage d’ubac.
Nul besoin d’être spécialiste. À parler de poésie portugaise le nom de Pessoa et des hétéronymes qui lui font cortège s’impose. C’est une montagne avec plis et replis, sommets et fonds de vallée creusés par les terreurs de l’identité et du manque d’être. C’est un paysage d’ubac.À l’adret, se tient la poésie d’Eugénio De Andrade. Poésie du désir, du « soleil de la peau ». Poésie du corps réhabilité, libéré de toute crainte aussi bien celle de « l’insurrection de la chair » que celle de la mort qui « n’a pas de prise sur le corps / quand on tient le soleil endormi dans ses bras ». Toujours une douce lumière éclaire depuis un fonds réservé, retenu dans l’épaisseur du corps les mots, les images de la poésie d’Eugénio De Andrade. C’est elle qui invite l’âme à la fête des sens.
Lisez Eugénio De Andrade Lisez ces trois recueils, traduits par Michel Chandeigne, Patrick Quillier et Maria Antonia Camara Manuel et publiés entre 1980 et 1984. Ils sont la ligne de crête de sa production poétique. L’homme qui était né en 1923 à Povoa de Atalaia, près de la frontière espagnole s’est éteint à Porto en juin dernier.
Quitte de tout, un soleil a replié ses rayons. Ainsi, même dans la mort, « il y a une rumeur qui ne dort pas / une manière pour la lumière de se poser, la trace / d’une larme brûlante ». C’est cette lumière rasante que l’on entend dans la poésie d’Eugénio De Andrade. Si elle n’efface pas le poids du monde, elle l’allège ; si elle ne dissout pas les ombres, elle les tient à distance.
21:40 Publié dans Du côté de mes interventions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Poésie, Littérature
31/03/2008
Lu 23 - Haiku - Anthologie du poème court japonais
Le mendiant –
Il porte le ciel et la terre
Pour habit d’été
Ce haiku d’été de Kikakou, je le prendrais volontiers pour emblème de cet art poétique que Corinne Atlan et Zéno Bianu résument dans le triangle suivant : Brièveté d’un souffle ; court-circuit de nos représentations ; pincement léger du cœur.
De quoi s’agit-il donc dans le haiku sinon de la chair même du monde quand elle palpite entre diastole et systole ? Que sont ses mots sinon des laisser-passer ? Poreux – véritable puits artésien ! – par où remonte ce « ah ! » des choses quand, étonnées, elles surgissent comme elles sont, moins peut-être dans leur être que dans les rapports qu’elles peuvent entretenir entre elles, tant elles sont ajustées et comme reposant dans une mesure qui les illumine.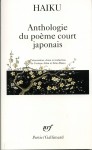
L’originalité de cette anthologie du poème court japonais (Poésie/Gallimard, cat 2) tient d’une part à la traduction de Corinne Atlan et Zéno Bianu qui ont cherché à faire la part belle aux résonances plutôt qu’au sens, forts de ce que le même mot japonais « uta » désigne poésie et chant qui oblige pour ainsi dire à lire le haiku à voix haute. Et d’autre part, à côté de l’inévitable répartition des poèmes en ces saisons qui portent tout, privilégiant « les moments témoins d’une émotion saisonnière », Corinne Atlan et Zéno Bianu ont su faire place à un espace « hors saison », réservée aux « haikistes contemporains, soucieux de créer une esthétique moderne de l’instantané » tel que Hoshinaga Fumio par exemple qui écrit :
Dans le quartier des banques
Les navires de guerre
irradient
© Alain Freixe
11:05 Publié dans Du côté de mes interventions | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Poésie, Littérature
13/02/2008
Lu 22 - Jours Déchaux de Jean-Vincent Verdonnet, J
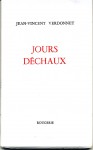 Jours déchaux, et certes l’on pense à ces jours qui vont déchaussés par le temps qui se fait de plus en plus prégnant. Né en 1923, riche d’une œuvre importante publiée pour l’essentiel par les éditions Rougerie qui sous le titre Où s’anime une trace en ont repris l’essentiel en quatre tomes, Jean-Vincent Verdonnet n’en continue pas moins à « interroger / ce frémissement dans les arbres / qui ne (l’) aura jamais lassé ».
Jours déchaux, et certes l’on pense à ces jours qui vont déchaussés par le temps qui se fait de plus en plus prégnant. Né en 1923, riche d’une œuvre importante publiée pour l’essentiel par les éditions Rougerie qui sous le titre Où s’anime une trace en ont repris l’essentiel en quatre tomes, Jean-Vincent Verdonnet n’en continue pas moins à « interroger / ce frémissement dans les arbres / qui ne (l’) aura jamais lassé ».
Pour « déchaux » qu’ils soient ces jours, le poème leur assure encore une prise au sol comme les entours dont Jean-Vincent Verdonnet a toujours eu un sens aigu permettent de « pressentir l’invisible » au « trouble » qui mêle les couleurs d’octobre en un timbre inouï dont le poète s’est si souvent demandé s’il a « un nom / et dans le fond de quel abîme ».
L’essentiel me semble dit là. Jean-Vincent Verdonnet est le poète attentif à ce qui dans le cœur battant d’un paysage se donne à entrevoir dans l’écoute attentive pour peu que nous sachions nous oublier de nous-mêmes ces oripeaux imaginaires qui nous tiennent lieu de moi. C’est cela qui laisse trace, une vibration qui passe sur les choses, une lumière déjà passée, « lueur intermittente / où les extrêmes se rejoignent ».
Déchaux pouvait paraître comme un étrange adjectif, on voit combien il est ajusté aux deux principales caractéristiques de Jean-Vincent Verdonnet : sa cambrure, d’une part, soit cette manière d’aller dans le monde avec légèreté, court chaussé et porteur d’un regard qui laisse venir jusqu’à lui les choses et les êtres du monde jusqu’à épanouir d’autres yeux dans nos yeux et d’autre part, son écriture toujours aussi fluide, fruit d’une lutte amoureuse au sein du langage, qui sait se rendre poreuse aux sollicitations du dehors qui finit par affleurer entre les noirs de l’encre.
Oui, Jean-Vincent Verdonnet est un marcheur déchaux ! Il va sandales sans bas depuis toujours. Mal chaussé eu égard aux chemins empruntés. Non balisés. Mal assurés. Chemins toujours en avance sur nos pas. Chemins en quête de la piste perdue qui mènerait au lieu où l’invisible prendrait visage et où cesserait notre exil.
Déchaux certes mais obstiné. Tremblant certes mais espérant. Patient. De là cette douceur qui se dégage de la poésie de Jean-Vincent Verdonnet. Sa fraîcheur. Celles des braises sous cendres.
22:30 Publié dans Du côté de mes interventions | Lien permanent | Commentaires (0)
02/02/2008
Lu 21 - Giacometti/Dupin -Eclats d'un portrait
( Est paru chez André Dimanche éditeur (39 euros) de Jacques Dupin, Alberto Giacometti Eclats d’un portrait avec des photographies de Ernst Scheidegger ) 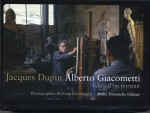
Il ne s’agit pas pour Dupin de dire on ne sait trop quelle vérité sur ce qui s’est passé dans cet atelier mais dans le jeu entre les images reproduites ici et les mots de Jacques Dupin de dire au plus juste. De reprendre. Porter plus avant le souvenir, cela est relever. Porter hier dans un futur.
Le porter au plus près de cette avancée dans l’inconnu, après que le premier trait comme le premier pas ait introduit le porte-à-faux d’un déséquilibre. Et c’est alors comme un souffle toujours là à tisonner le feu qui à brûler toujours plus, s’effondre braise sur braise. Et c’est cet éboulement, celui d’une interrogation qui s’entretient interminablement elle-même, qui tient, trait à trait, comme tiré du vide et devant nous porté comme devant le regard perdu de Giacometti. Qu’il dessine ou sculpte – les deux séries de photographies sont superbes de complicité attentive – une tête – celle de Dupin, « tête d’un autre dans le regard d’Alberto » écrit-il – surgit moins qu’elle ne se déclôt, sur la toile ou dans le bloc de terre, trait pour trait, pétale de terre après pétale de terre, comme autant de saetas, flèches sonores qui déchirent le ciel vide, à partir d’un tout perdu, ce fantôme de tête que Giacometti a perdu, explique Dupin, à peine s’est-il emparé du pinceau ou de la terre.
Il est ainsi très émouvant de suivre Giacometti et Dupin avancer dans l’ignorance de la fin sans souci d’arriver. Etrange voyage vers la figure ! Vers ce qui se dérobe toujours alors même qu’elle s’affirme, se cache alors qu’elle se montre, se détruit alors qu’elle se construit. Etrange construction dont le processus est de démolition ! Ici travaille la ruine. C’est elle qui édifie, trait contre trait ; coup de pouce contre coup de pouce. Ce qui élève abaisse, ce qui amoindrit relève.
Ce livre est l’autre scène d’une danse . Celle de mains funambules, amoureuses du vide.
18:55 Publié dans Du côté de mes interventions, Inédits | Lien permanent | Commentaires (5)
19/01/2008
Table ronde sur le N°de la revue Europe consacré à Michel Butor le vendredi 25 janvier 2008 à la BMVR Louis Nucéra à Nice à 17hs
17:15 Publié dans Du côté de mes interventions | Lien permanent | Commentaires (0)
08/01/2008
Aux passant(e)s du blog
Ami(e)s connus, moins connus voire inconnus qui passez par les mailles de la toile sans vous y prendre que 2008 vous accorde l’énergie nécessaire à la réalisation des projets qui vous tiennent le plus à cœur. Et le cœur !
Energie nécessaire pour cette fermeté dont parle Kafka dans son aphorisme 21 quand il évoque « une main tenant une pierre ». Main qui ne « la tient ferme que pour la relancer encore plus loin, aussi loin que mène le chemin. »
15:55 Publié dans Du côté de mes interventions | Lien permanent | Commentaires (3)
Exposition « Joë Bousquet, j’habite au milieu des couleurs » du 30 novembre 2007 au 01 mars 2008 à la Maison des Mémoires – Maison Joë bousquet, 53 rue de Verdun, 11000 Carcassonne (tel/fax : 0468725083)
(Conçue par Le centre Joë Bousquet et son temps en partenariat avec le Conseil Général de l’Aude, l’exposition propose un cheminement dans l’univers de Joë Bousquet.
Des rencontres réunissant Yannick Bellon, Eric Le Roy, Serge Bonnery, André Cariou, Anne Cathala, Michaël Glück, Sylvie Gonzalez, Anne Gualino, Rose-Hélène Iché, Yolande lamarin, Adriano Marchetti, Doiminique Rabourdin, Alain Freixe et bernard Noël, se sont déroulées les 30 novembre et 1 et 2 décembre 2007.
Les œuvres présentées : peintures, photographies, sculptures, ouvrages, revues, documents témoignent des liens vitaux que le poète a entretenu avec les créateurs entre les années 1925 et 1950.)
 « Les peintres m’ont comblé. Quand j’étais aussi pauvre qu’eux, ils m’ont fait de ma chambre une
« Les peintres m’ont comblé. Quand j’étais aussi pauvre qu’eux, ils m’ont fait de ma chambre une demeure enchantée. »
demeure enchantée. »
Joë Bousquet à Maurice Nadeau
On l’aura compris, il ne s’agissait pas pour les concepteurs de l’exposition de courir après les pièces telles que mais de tenter d’évoquer l’atmosphère de ce « repaire amoureux », ce « lieu souterrain » dont Bousquet disait – Et c’est le titre même de l’exposition ! – que là, « il habitait au milieu des couleurs », que sa vie même était dans ces « réalités éruptives »
Pari gagné !
A parcourir salles et couloirs, c’est un vent et une lumière qui vous accompagnent : vent qui porte haut l’écho d’une rébellion qui avait subordonné « toutes les activités esthétiques à une idée morale de l’homme » ; lumière d’un refus de tout ce qui asphyxie l’homme et le voue à l’écoeurement.
15:40 Publié dans Du côté de Joë Bousquet, Du côté de mes interventions | Lien permanent | Commentaires (0)
05/11/2007
Turbulence 17 - La Belugo, au bord de braises qui ne finissent pas cendres
 Les samedi 27 et dimanche 28 octobre 2007, nous étions Bernadette Griot, Jean Princivalle, Jeanna Bastide,
Les samedi 27 et dimanche 28 octobre 2007, nous étions Bernadette Griot, Jean Princivalle, Jeanna Bastide, Raphaël Monticelli, Serge Bonnery et moi-même, auteurs des éditions de l'Amourier invités par l'association La Belugo à Montagnac dansz l'Hérault à pousser la porte de l'écurie pour; près d'un feu de vieux ceps, croiser nos écrits, rencontrer un public attentif et généreux. Deux jours durant fusa l'étincelle - cette "belugo" occitanne - de la poésie. Celle de l'amitié l'accompagnait. C'est elle qui mit le feu à des extraits du livre de Raphaël Monticelli, Effraction, publié cdans la collection Ex-caetera des éditions de l'Amourier lors d'une lecture-théâtralisée que la compagnie de la Belugo anima avec passion et talent.
Raphaël Monticelli, Serge Bonnery et moi-même, auteurs des éditions de l'Amourier invités par l'association La Belugo à Montagnac dansz l'Hérault à pousser la porte de l'écurie pour; près d'un feu de vieux ceps, croiser nos écrits, rencontrer un public attentif et généreux. Deux jours durant fusa l'étincelle - cette "belugo" occitanne - de la poésie. Celle de l'amitié l'accompagnait. C'est elle qui mit le feu à des extraits du livre de Raphaël Monticelli, Effraction, publié cdans la collection Ex-caetera des éditions de l'Amourier lors d'une lecture-théâtralisée que la compagnie de la Belugo anima avec passion et talent.
On peut soutenir la Belugo en adhérant pour 20 euros à l'association qui organise aussi des ateliers d'écriture, des stages, des week-ends autour des types d'écriture et d'autres expressions comme peinture, calligraphie...
Adresse: La Belugo, 95 avenue Azema, 34530 Montagnac- 0467240233 - belugo@club-internet.fr
19:25 Publié dans Dans les turbulences, Du côté de mes interventions | Lien permanent | Commentaires (0)
Lu 19 - A propos de l'art du bref
(Deux livres, d'ici et d'ailleurs: Anthologie de l’épigramme de l’antiquité à la renaissance Edition de pierre Laurens NRF Poésie/Gallimard, cat 5 et Anthologie Haïkus Texte français de Roger Munier Préface de Yves Bonnefoy PoésiePoints, 6,50 euros )
 Moins de mots, plus d’intensité. L’art du bref est difficile. Pourtant , « la génialité fragmentaire » -l’expression est
Moins de mots, plus d’intensité. L’art du bref est difficile. Pourtant , « la génialité fragmentaire » -l’expression est de Schlegel –est à la mode : l’aphorisme de Char comme les poèmes de Guillevic si concis, clairs et nus, et dont on fête aussi cette année le centenaire de la naissance. Comment oublier le haïku et comment ne pas faire signe vers l’épigramme ?
de Schlegel –est à la mode : l’aphorisme de Char comme les poèmes de Guillevic si concis, clairs et nus, et dont on fête aussi cette année le centenaire de la naissance. Comment oublier le haïku et comment ne pas faire signe vers l’épigramme ?
On se souvient que retour du Japon Roland Barthes dans L’empire des signes, publié en son temps dans la belle édition des Sentiers de la création chez Skira, opposait ces deux genres brefs comme caractéristiques de l’Orient et de l’Occident.
D’un côté, un art du moins dire pour mobiliser l’attention et susciter un élan de la pensée vers « la chose comme elle est dans l’instant de sa révélation soudaine et là », selon Roger Munier. Quelques mots qui cherchent à aller plus loin que les mots. Des mots tels qu’ils se fassent oublier comme chez Bashô ou Shiki, Buson ou Issa. Des mots poreux – véritables puits artésiens – par où remonterait le « ah ! » des choses quand, étonnés, elles surgissent comme elles sont, moins peut-être dans leur être que dans les rapports qu’elles peuvent entretenir entre elles, quand ceux-ci sont justes, quand ils reposent dans une mesure qui les illumine. Des mots court-circuit, tels qu’ils viennent déconnecter notre esprit de ses types où il est comme à demeure := sourd, chaud et aveugle.
De l’autre, le fruit d’une rhétorique étincelante couvrant les domaines amoureux, narratif, descriptif, moral, comique, politique…peau élégante et chair subtile ! Lorsqu’il passera de la Grèce à Rome, il recevra de Catulle, l’ébranlement de la violence, et de Martial, ce rétrécissement en pointe qui voit briller sa lame dans la satire. À la brièveté s’ajoute comme trait distinctif du genre, « la pointe latine », la pique. Cette « agudeza » qui continuera à « battre son plein, selon Pierre Laurens » au grand siècle et au siècle des lumières ».
Poèmes courts d’ici et d’ailleurs. Poèmes du séjour terrestre de l’homme.
18:40 Publié dans Du côté de mes interventions | Lien permanent | Commentaires (0)
Lu 20 - Bernard Noël-sonnets de la mort
Le poème ne sera jamais un discours parmi d’autres. Altérité irréductible, il nous force à voir. À entendre aussi bien. Comme Bernard Noël a dû crier. Comme quelque chose en lui a dû crier pour écrire ces sonnets de la mort ! C’est à partir de ce cri immensément silencieux qu’il a risqué le geste du poème. Là une force l’a fendu en deux et par le milieu l’a poussé à ouvrir l’espace où vont se montrer ces mots dont la torture est l’objet.
Bernard Noël a dû crier. Comme quelque chose en lui a dû crier pour écrire ces sonnets de la mort ! C’est à partir de ce cri immensément silencieux qu’il a risqué le geste du poème. Là une force l’a fendu en deux et par le milieu l’a poussé à ouvrir l’espace où vont se montrer ces mots dont la torture est l’objet.
Oui, il y a de l’insoutenable. Et il y a à résister à partir de cet insoutenable. À partir du pire – Titre même de la collection des éditions fissile dans laquelle paraissent ces sonnets de la mort, dans la collection "pire" (9 euros) Onze poèmes repris du N°2 de la revue Moriturus, Le sens du sang, revue créée en 2001 par Cédric Demangeot, Brice Petit, Lambert Barthélémy et Guy Viarre qui choisit en cours de route de se rayer de ce côté-ci du monde.
Ce n’est pas dans ces poèmes que l’on trouvera des « oh ! quelle horreur ! et des « oh ! comme c’est abominable ! ». On aura affaire ici à bien pire que des sentiments, on aura à affronter les mots mêmes du bourreau. Tels quels. Simples collages parfois de propos lus ici ou là mais qui au montage, dans les vers, leurs séquences, produisent de ces déflagrations qui allument soudain le jaune sale des ampoules des culs de basse fosse où « ça finit dans un baquet de pisse / jusqu’à plus soif ».
À cette objectivation du réel que produisent les poèmes de Bernard Noël, on se rend. Et c’est au point de jonction de la conscience et de ses vers que ce produit l’éclair. Le poète ici s’est effacé. Bernard Noël est de ces rares, de ces quelques-uns dont parle Jacques Dupin qui s’effacent pour écrire. Et c’est moins l’émotion dont on aura toujours raison de se méfier que l’émoi – ce que Bernard Noël appelle ailleurs « une émotion dépourvue de sentiments » - qui est le cœur de feu de ses mots, soit cet effondrement que la forme du poème en quelque sorte redresse. Et tient.
À soulever le cœur, la raison en sort comme épurée. Car on fond c’est comprendre qu’il nous faut. Comprendre comment la mort travaille notre monde.
Les bourreaux auront beau faire. Ils susciteront toujours ceux qui à l’aube seront leurs ennemis. Bernard Noël est de ceux-là. Irréductiblement, debout.
18:40 Publié dans Du côté de mes interventions | Lien permanent | Commentaires (0)