31/12/2025
Lu 126- René Depestre et Jean D'Amérique *
 Avec René Depestre et Jean D’Amérique, « Résister / aux grands froids du monde… »
Avec René Depestre et Jean D’Amérique, « Résister / aux grands froids du monde… »
J’intitulais ma XIXème chronique poétique « Haïti, pays de poésie ». Elle présentait les journées que l’Association des Amis de l’Amourier organisaient en novembre 2022 autour de Haïti et de sa poésie à l’occasion du centenaire de la naissance du poète Jacques Stephen Alexis. Elle faisait suite à ma XVIIème chronique poétique consacrée, elle, au livre que Michel Séonnet faisait paraître sur ce militant révolutionnaire et poète, vie et œuvre mêlées, Le voyage vers la lune de la belle amour humaine aux éditions l’Amourier.
Je fais retour aujourd’hui à ce pays, cette « perle des Antilles » selon les colons, masque scandaleusement posé sur sa réalité de terre ravagée par tous les cataclysmes géologiques, météorologiques et politiques. Retour aussi à ses poètes garants, selon les mots d’Aimé Césaire de « la forêt natale » et du « chant nécessaire ». Deux livres paraissent l’un appelant l’autre. Le premier de René Depestre, Journal d’un animal marin est un choix de poèmes des années 1956-1990 dans la collection Poésie / Gallimard préfacé par le jeune poète haïtien Jean D’Amérique dont je parlais à la fin de mon article « Haïti, pays de poésie » et qui donc publie de son côté Quelque pays parmi mes plaintes aux éditions Cheyne.
Disons-le tout de go : deux livres de révolte et d’espoir pour rester toujours debout dans la vie.
L’aîné, René Depestre est né en 1926 à Jacmel, en Haïti. Il lui fut donné de traverser entre les années 50 et 80 bien des combats et autant de débats aux enjeux politiques et esthétiques importants de Jacques Stephen Alexis à Aragon en passant par Aimé Césaire. Il vivra et travaillera à Cuba entre 1959 et 1978. Son amitié avec Fidel Castro prit fin avec l’emprisonnement du poète cubain Ernesto Padilla en 1971. Sans rien renier de son engagement, le poète en lui – « la poésie aussi (avait) ses raisons d’état » écrira-t-il – celui qui entendait « travailler pour élargir / les frontières de l’homme » se dressa. Et il partit pour le sud-ouest de la France où il vit toujours. Ce sont ces raisons, cette « passion de déplacer sans cesse les bornes que l’on impose à la parole qui se tient debout » écrit Jean D’Amérique dans sa préface au livre de René Depestre, qui « sont venues éclairer (…) tendre la main » et « ouvrir un nouveau chemin de vie » au jeune homme qu’il était - Il est né en 1994, en Haïti – qui « dérivait (…) déboussolé » dans « le ciel sombre de (son) adolescence ». C’est cette voix qui enracina en lui « la révolte, l’insolence » lui intimant toujours de « (voguer) à contre-courant des vents du monde ». Ce sont les poèmes de ce « nomade enraciné dans la beauté, voix tachée de l’encre du soleil » que l’on trouve dans cette trop courte anthologie, dans ce petit volume qui est comme une traversée en comète de son œuvre poétique » et donc une invite à prolonger ailleurs la lecture car « René Depestre est un monde immense à explorer, un éternel animal marin de la poésie, un errant riche de multiples terres, de luttes qui nous lègue sa voie en héritage ».
Jean D’Amérique dans son précédent recueil Rhapsodie rouge paru en 2021 aux mêmes éditions Cheyne fixait à la poésie la tâche de « (redresser) l’épine dorsale du jour et (faire) monter les voix délabrées vers un doux pays ». Deux ans plus tard, la lumière à l’horizon de son livre n’a pas disparue : « nous croyons nos ruines capables de muter en ciel bleu » même si « une voix coupée nous habite ». Toutefois, reconnaissons que les ruines sont toujours bien là peut-être même un peu plus sombres encore. Parfois affleure le désespoir, quand « après la pluie, le beau temps s’affaisse dans une flaque dégueulasse » et que « l’espoir, ce salaud, écrit Jean D’Amérique, vient à nouveau trahir nos chants, cadavres qui voudraient repêcher l’aurore ».
Eh bien, même si « la mort ronge nos élans », on aime lire le titre de la troisième partie de son livre : « Avancer malgré » ! « Avancer malgré, jongler parmi corbillards et fleurs, tenir tête contre requiem et absences multiples (…) avancer malgré ». Ne dit-on pas, s’interroge Jean D’Amérique, « ce pays, terre de poètes » ? Certes, mais « il n’y a pas de poème dans les couloirs du parlement (…) il n’y a pas de poésie possible ni dans les cordons de police ni dans les mitrailleuses officielles qui trouent nos soleils, il n’y a pas de poésie dans le trésor public qui vit loin du peuple, nul poème, nul trésor ».
Alors, où y - a - t-il poésie pour ce pays si ce n’est dans le désespoir lui-même, sa force résidant dans le fait qu’il vous donne le sentiment de votre capacité à composer une présence humaine nouvelle. Oui, c’est une force qui est donnée, même fictive… comme ce « contre-sépulcre » qu’évoquait René Char dans son poème « Qu’il vive » et dont il disait qu’il n’était qu’ « un vœu de l’esprit ». Là, le pays pourra retrouver les « ailes-silex » d’une « terre en moi debout » et « (réapprendre) l’adresse de respirer, chanson-pluie qui arrose les clartés neuves » écrit Jean D’Amérique.
C’est en violence et tendresse qu’ici avec ces deux poètes les choses sont dites - est-il d’autres façons de dire quand c’est la création, le soleil, l’arbre, les forces de vie et les hommes qui se lèvent contre les Pères Ubus de tout poil, ceux qui ne savent plus appeler les aurores, qui assassinent les matins, bref contre la mort et ses visages biseautés d’injustice.
Parce qu’à parler debout, c’est poumons gonflés qu’on passe au large, lire René Depestre et Jean D’Amérique, c’est respirer avec le cœur.
* René Depestre, Journal d’un animal marin, nrf, Poésie / Gallimard, cat. 1, 2024
** Jean D’Amérique, Quelque pays parmi mes plaintes, Cheyne, 2023, 18 euros
*** Note parue dans le Patriote Côte d'Azur en 2019
17:25 | Lien permanent | Commentaires (1)
LU 125- Patrick Quillier-Voix éclatées (de 14 à 18)*
 La poésie pour défoncer les portes closes de l’histoire
La poésie pour défoncer les portes closes de l’histoire
On connaissait Patrick Quillier pour ses traductions de Pessoa en Pléiade, certains le connaissaient pour ses poèmes publiés aux éditions La Différence : Office du murmure en 1996 et Orifices du murmure en 2010, d’autres enfin pour ses performances. On a aujourd’hui ces Voix éclatées (de 14 à 18) publiées, courageusement, disons-le, par les éditions fédérop, un véritable oratorio. Certes, on n’y commente plus les textes sacrés, on n’y chante plus les laudes en hommage au jour, on y entend un thrène et moins gémissements et lamentations que mises en perspective toutes les voix de ces vies fauchées dans le fracas musical des obus – « musique barbare et ininterrompue » dont parlera Apollinaire – les fumées, les gaz, la boue des tranchées, ces « corps creux et blancs » qui « habitent toute la terre dévastée ». Un monument aux morts éloquent parlant contre les paroles, « morts fraternels tempe contre tempe ».
Tout se passe dans ce livre comme s’il s’agissait de redresser les centaines de milliers de blessés, mutilés… de désensevelir leurs voix, de faire vibrer la pierre des milliers de monuments aux morts qui dans le moindre de nos villages rappellent combien les morts pèsent sur les vivants. Patrick Quiller ressuscite, redonne souffle de vie à « ce que fut la souffrance des corps et des âmes, sacrifiés au profit illusoire des nations » selon les mots de Frédéric Jacques Temple qui signe la 4ème de couverture.
Excepté trois personnages inventés par l’auteur, Patrick Quiller a donné la parole aux poilus, aux morts d’Aiglun et Cigale, ces villages de la vallée de l’Esteron dans les Alpes Maritimes ; aux écrivains si nombreux tués lors de cette guerre ou marqués à vie par elle. Patrick Quiller a la tête suffisamment épique pour écrire ou réécrire en décasyllabes – souvent cahoteux – des textes écrits initialement en prose, des textes librement traduits, et les ajuster comme des marqueteries juxtaposant des fragments d’essences différentes. « Les français n’ont pas la tête épique » s’exclamait Théophile Gautier, Patrick Quiller, lui, l’a, et, certes, il ne s’agit pas de rivaliser avec les grands textes du passé mais de rendre justice à tout ce qui fut cassé, ici et là, dans cette Europe du début du XXème siècle et tourner « en un seul grand mouvement vers la lumière » comme le voulait Victor Hugo tous ces malheurs, cette invisibilité dont Apollinaire dénonçait l’art en 1915.
La force éthique et politique de ce travail, de cette mise en chantier vise à transformer la mort en force de vie. Pari réussi !
* Voix éclatées (de 14 à 18), Préface de Gabriel Mwènè Okoundji, Collection Paul Froment, fédérop, 25 euros
* Note parue dans L'Humanité en 2019
17:10 | Lien permanent | Commentaires (1)
Balise 101-
« Même si le grand chant ne doit plus reprendre
Ce sera pure joie, ce qui nous reste
Le fracas des galets sur le rivage
Dans le reflux de la vague »
William Butler Yeats
16:58 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : -
28/11/2025
Rencontre / Lecture avec Alain Freixe le samedi 6 décembre à 19h, librairie Victor et Madeleine, Canet-en-Roussillon
 Samedi 6 décembre à 19h00 rencontre avec Alain Freixe sous le regard des œuvres exposées de Joseph Maureso et Patrick Soladie à qui il rendra hommage sous le plus haut regard de Jacques Quéralt, passeur et accompagnateur.
Samedi 6 décembre à 19h00 rencontre avec Alain Freixe sous le regard des œuvres exposées de Joseph Maureso et Patrick Soladie à qui il rendra hommage sous le plus haut regard de Jacques Quéralt, passeur et accompagnateur.
Lecture d’œuvres croisées aux hésitantes frontières entre texte et image des Cahiers du Museur d’Alain Freixe avec Patrick Soladie et Joseph Maureso et d’Evelyne Maureso avec Claude Massé.
Présentation et lecture du dernier livre d’Alain Freixe publié aux éditions de la Margeride accompagné d’encres de Robert Lobet, Dans ce plus de jour qui fait le jour.
Patrick Soladie et Joseph Maureso, ces deux artistes et amis ont exposé ensemble à la Casa Carrere de Bages (66) en 2009.
Aujourd'hui en décembre 2025, c'est le poète et ami Alain Freixe qui les réunit à nouveau à la librairie-galerie Victor & Madeleine, pour participer à une poétique d'espace partagée entre les mots et les figures.
Deux langages plastiques différents aux frontières poreuses et qui accueillent chacune et chacun à l'aune de sa culture et de son histoire.
Ils ont en commun un rapport éthique à leur pratique picturale, avec lequel ils ne transigent pas !
Exposition visible jusqu’au 4 janvier 2026
Débat et pot de l’amitié suivront
* Places limitées, réservation conseillée
19:21 Publié dans Du côté de mes interventions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : patrick soladie, joseph maureso, jacques quéralt, richard meier
Lu 124- Thierry Metz, Lettres à la Bien- aimée et autres poèmes, Poésie / Gallimard, juillet 2025, cat 3
Thierry Metz, son chemin dans l’inépuisable
 Il faut saluer – et je le fais avec enthousiasme – la parution dans la collection Poésie / Gallimard de ces Lettres à la Bien-aimée et autres poèmes de Thierry Metz même si je regrette que le prix Froissart de1989 Dolmen et L’homme qui penche de 1990 n’y figurent pas.
Il faut saluer – et je le fais avec enthousiasme – la parution dans la collection Poésie / Gallimard de ces Lettres à la Bien-aimée et autres poèmes de Thierry Metz même si je regrette que le prix Froissart de1989 Dolmen et L’homme qui penche de 1990 n’y figurent pas.
Les poèmes de Thierry Metz y sont encadrés d’une importante, précise et rigoureuse préface d’Isabelle Levesque qui s’attache à replacer chacune des œuvres dans son contexte de création et d’une postface d’Eric Vuillard dans laquelle il se montre sensible à l’écriture même de Thierry Metz qui se développe « dans le déchirement du langage et des choses, sur la feuille percée de mots ».
Thierry Metz était maçon, manœuvre - il faut lire le magnifique Journal d’un manœuvre paru chez Gallimard, collection L’Arpenteur, en 1990, qui connut un beau succès de librairie - Oui, il avait choisi d’être maçon parce qu’il y avait là le travail des mains certes mais aussi parce qu’on y apprend que « les murs du livre et de la maison sont percés d’ouverture » et que cela « permet d’y revenir ».
Mais il était déjà tard pour lui puisque, en mai 1988, la mort avait ravi son jeune fils Vincent par l’entremise d’une automobile qui faucha l’enfant en bordure de route.
Il est des voix dont on ne se remet pas de celles qui certains soirs nous rendent visite, celle de l’enfant qui « nous raconte ce qui se passe là-bas, comment sont les gens, ce qu’on y trouve…Ces voix nous ferment les yeux ». Et parfois « Non / Rien de cela / Qu’une inépuisable, inexorable absence / Rien qu’une mort.// Et un nom : Vincent. »
« Quelle absence que d’écrire », écrit Thierry Metz. Cette traque de l’absence dans « la langue / qui chemine dans l’inépuisable », cet affrontement à la question de savoir comment donner présence et voix de rouge-gorge à ce « quelque chose d’incertain / d’indicible / qui ne s’éteint jamais » dura neuf longues années coupées de publications et de deux séjours volontaires en hôpital psychiatrique avant de céder à la ramasseuse de sarments et d’en finir un 16 avril 1997, à 40 ans.
Neuf longues années pendant lesquelles il fut à la manœuvre. Je voudrais rappeler que ce mot renvoie à la manière dont les couleurs d’un tableau sont fondues et agencées. Ici dans les mots.
Mais attention pour Thierry Metz ces mots doivent être écriture sinon, ils ne sont pas parlant, selon lui. Et parlant, ils ne le sont jamais assez. Toujours, ils séparent, nous laissent dehors, au bord – et même si l’on retourne et retourne la langue – de ce qui serait à dire. Ainsi le poème est-il pour lui « un abri de mots / mais pas longtemps », note-t-il. L’absence revient. La poésie circule entre les mots qui portent le drame d’être au monde. C’est par là qu’elle nous touche. On y sent la vie respirer de souffle en souffle. A la Bien-aimée, il écrira : « J’ai vidé la page pour que tu puisses entrer ». C’est ce souci de l’autre qui émeut. Cette volonté d’une écriture qui va seule, avançant au travers d’une vie qui va se dépouillant. Sa parole n’est pas parole de « prince », parole pleine, remplie jusqu’au débord, « sourde de se suffire à elle-même » mais bien parole de « gueux », selon la belle distinction opérée par Christian Bobin, que trouent vide et silence. Assez pour laisser place à nous autres lecteurs, pour partager l’impartageable !
( Paru dans le Patriote Côte d'Azur, semaine du 20-26 novembre 2025)
19:14 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thierry metz, thierry renard
Lu 123 - Thierry Renard, Oeuvres poétiques Tome II, collection La Bibliothèque, La rumeur libre, 2018
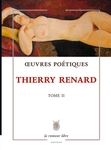 Il y a deux ans, en avril 2016, c’était le tome I des Œuvres poétiques de Thierry Renard, voici maintenant le deuxième. Plus d’un millier de pages, la reprise de 7 recueils dans le Tome I et 14 dans le Tome II plus un inédit qui clôt le volume. J’observe que cet inédit a pour titre Le fait noir/deux qui fait écho au Fait noir, préfacé par Patrick Laupin qui ouvrait le Tome I, comme si 25 ans après le poème avait toujours et encore à témoigner du « passage inexplicable de la vie», son épreuve, ses rencontres, ombres et éclairs mêlés.
Il y a deux ans, en avril 2016, c’était le tome I des Œuvres poétiques de Thierry Renard, voici maintenant le deuxième. Plus d’un millier de pages, la reprise de 7 recueils dans le Tome I et 14 dans le Tome II plus un inédit qui clôt le volume. J’observe que cet inédit a pour titre Le fait noir/deux qui fait écho au Fait noir, préfacé par Patrick Laupin qui ouvrait le Tome I, comme si 25 ans après le poème avait toujours et encore à témoigner du « passage inexplicable de la vie», son épreuve, ses rencontres, ombres et éclairs mêlés.
Deux tomes, c’est une somme ! Son ami Emmanuel Merle disait c’est une « cathédrale laïque » en pensant aux mots de Pierre-Albert Jourdan qui à propos d’un « amandier en fleurs tout bourdonnant d’abeilles » avait écrit : « c’est une cathédrale » ! Ce serait aussi comme un manteau de mots, un manteau de nuit troué de lucioles, traversé de quelques nocturnes « qui (traceraient) la chance d’un autre jour » selon les mots de Michel de Certeau.
La poésie est de l’ordre de ce combat, de cette guerre secrète – « combat spirituel aussi brutal que la bataille d’hommes » disait Arthur Rimbaud – pour garder ouvertes et battantes les portes de ce pays, ce « contre-sépulcre », même s’il n’est qu’un « vœu de l’esprit », cet inconnu devant soi qu’invoquait René Char sans lequel exister ne pourrait que s’effondrer dans les sables mouvants du libéralisme travaillés par l’argent-roi et le mépris des autres, proches ou lointains. Les poèmes de Thierry Renard, ces « éclats de réalité », disent l’urgence, tous sont écrits avec au bas des reins l’aigu d’une lame, celle du temps ; avec dans les poumons, comme une menace d’asphyxie et dans les yeux, le voile de quelques rêves non encore aboutis capables de tenir la bride au désespoir.
Ici, on écrit toujours au plus proche de ce que l’on ressent. Cela tient de la traversée, c’est une vraie expérience comme telle risquée car il ne s’agit pas seulement d’habiller de mots un vécu, il s’agit bien plus de l’interroger, de le mettre à la question, de le faire parler : « chaque poème est un raid dans l’inarticulé » dit Patrick Laupin des poèmes de Thierry Renard.. Ici, on écrit « pour lire et dire le monde », « aérer le présent », se tenir debout, - quelque soient les coups qui jamais ne manquent surtout quand, comme Thierry Renard, on s’expose. Faut-il rappeler l’animateur infatigable, « l’agitateur poétique » selon ses propres mots, qu’il est, toujours sur la brèche de quelques projets nouveaux – passer avec armes et bagages du côté où l’homme n’est rien que cette chance du jour qui vient.
19:08 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0)
Balise 100-
« Il ne faut jamais avoir peur d’aller trop loin car la vérité est toujours au-delà » (Marcel Proust)
19:00 Publié dans Balises | Lien permanent | Commentaires (0)
08/10/2025
Présentation / Signature de Si le vent du nord... livre d'artiste Alain Freixe - Ernest Pignon-Ernest à la librairie Blaizot à Paris le 16 octobre 2025 à partir de 17h
16:21 Publié dans Du côté de mes interventions, Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernest pignon-ernest, éditions d'art fma
07/10/2025
Avec du ciel en plus, Esdée-Manie avec des collages de Gislaine Lejard, éditions Esdée
09:50 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0)
Lu 122- Pierre Reverdy / Pablo Picasso, Le chant des morts
 Le chant des morts, ce cycle de poèmes écrits entre 1944 et 1948, fut publiés en 1948 par l’entremise de l’éditeur Tériade qui le tira à 270 exemplaire dont 20 HC. Ce grand format – 42, 5 x 32, 5 comprend 124 lithographies de Pablo Picasso qui viennent jouer avec, sérigraphiée, l’écriture manuscrite impérieuse de Pierre Reverdy.
Le chant des morts, ce cycle de poèmes écrits entre 1944 et 1948, fut publiés en 1948 par l’entremise de l’éditeur Tériade qui le tira à 270 exemplaire dont 20 HC. Ce grand format – 42, 5 x 32, 5 comprend 124 lithographies de Pablo Picasso qui viennent jouer avec, sérigraphiée, l’écriture manuscrite impérieuse de Pierre Reverdy.
Certes, nous n’avons pas ces grandes double page, ce papier d’Arches, le vermillon original ; certes, l’édition qu’en fait la collection Poésie / Gallimard est réduite au tiers de l’édition originale. Et donc certes, on pourrait trouver à redire. Finalement, on aurait tort. Puisque nous avons là, un des « livres de dialogue », selon l’expression d’Yves Peyré, majeurs de l’après-guerre, mis à la disposition du plus grand nombre, un livre réunissant ces deux grands « transformateurs de puissances » que furent Reverdy et Picasso à un moment où la catastrophe historique de la seconde guerre mondiale avait atteint l’humanité entière, où « la mort (était) à tout bout de champ / sur les cicatrices toujours rouvertes des étoiles ».
Sur plus de 120 pages à la simplicité nue et impérieuse de l’écriture manuscrite de Reverdy répondent les « balafres sanglantes » écrit François Chapon, de Picasso. Ses lignes épaisses, croix et ronds répliquent, encadrent sans limiter comme autant de poteaux d’angle les vers de Reverdy. A la lumière déchirée des mots de Reverdy répondent les injonctions des traits de Picasso : traits, Saetas, ces flèches/chants tirées au noir, à la véhémence du Nada que Reverdy tient en respect. Reverdy met le feu à la langue, les mots dans ses poèmes sont en flammes, ce sont ces brandons que Picasso met en rythme, page après page, dans ce chant des morts qui du chant à ce côté d’antiphonaire, cette opposition de timbres, cet agôn entre signes plastiques et signes graphiques, image et texte. Entre le rouge du sang et le noir de l’encre, la poésie chante plus haut et plus loin, hors du livre, elle plane magistralement sur la vie. C’est sa ligne de vol qui nous sollicite, quelque chose de singulier, autre chose que l’on entend, une autre musique, un autre tempo. L’œil, suspendu entre noir et rouge, se fait oreille interne. C’est elle qui perçoit ce chant des morts. Là est s’inversent les signes. Alors on voit tout le négatif nous faire don d’une émotion qui ranime en nous cette « santé du malheur » dont parlait René Char, quelque chose que le mot « vitalité» pourrait désigner aussi. Redresser, redonner vie, réjouir, il est des livres qui le peuvent. Ce Chant des morts en est un.
09:44 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre reverdy, pablo picassi
Lu 121- Serge Pey, Mathématique générale de l'infini
 Perdona’m aquesta paraula en la nostra llengua : Hola Serge amic ! Oui, pardonnez-moi ce salut à Serge Pey dans « la langue des chiens », cette langue si longtemps réprimée et que l’on parle des deux côtés des Pyrénées, langue dont on emprisonne aujourd’hui ceux qui avec elle entendent démocratiquement instaurer une république catalane.
Perdona’m aquesta paraula en la nostra llengua : Hola Serge amic ! Oui, pardonnez-moi ce salut à Serge Pey dans « la langue des chiens », cette langue si longtemps réprimée et que l’on parle des deux côtés des Pyrénées, langue dont on emprisonne aujourd’hui ceux qui avec elle entendent démocratiquement instaurer une république catalane.
Cette « langue des chiens », je l’entends dans bien des titres de livres publiés chez ceux que l’on nomme « petits éditeurs » dont le travail admirable porte la poésie d’aujourd’hui dans toute sa diversité et que Serge Pey a réuni dans ce fort volume de la collection Poésie / Gallimard qu’André Velter dans sa préface présente comme un « exercice d’incantations martelées, une pratique du dévoilement, de la déchirure, de la blessure vocalisée qui accroît infiniment le champ du réel tout en le forçant à trembler sur ses bases », Mathématique générale de l’infini. Je l’entends aussi dans bien des noms croisés au hasard des poèmes dans ces quelques 37 titres comportant plus de 150 bâtons, figures même de la poésie-action de Serge Pey : sardane et ses flabiols i tambouris, Argelès, Sant Cebrià, Pedro Soler, Tautavel, Canigou, la Têt, la Santa Espina…
Mathématique générale de l’infini, ceux qui s’étonneront de ce titre, c’est qu’ils ne savent pas danser la sardane, qu’ils n’ont aucune idée des pas courts, des pas longs, de leur nombre, des pas glissés, pointés ou sautés : « deux fois nos pas courts / et deux fois nos pas longs / pour allonger l’infini / d’un pas plus grand que lui ». Le poète est un danseur. Un danseur mathématicien. Il compte avec ses pieds, tourne sur place, lève les bras au ciel, convoque et révoque l’infini, le rapproche et l’éloigne, l’accueille et le renvoie. « La sardane des chiens puisque tel est notre nom/ dans les camps / de l’autre côté », comme les poèmes de Serge Pey, sont des pièges à infini. Poète, il sait tordre la langue et l’arracher à tous les conformismes qui la menacent, l’avachissent et finissent par la pétrifier. Il sait l’espacer, l’étirer, la distendre, la douer de lointain, l’aérer et donner prise au silence, cette mise d’air, et c’est ouverte qu’elle résonne sans jamais se fermer sur elle-même. On peut entrer dans la ronde, le cercle de la sardane s’ouvre et se ferme alors comme on peut entrer dans le poème et que lire devient respirer du coeur. Fraternité de la danse, fraternité du poème.
Serge Pey est ce mathématicien qui dans son dialogue avec le peintre Jean Capdeville a appris de Simone Weil qu’il fallait « veiller au niveau où l’on met l’infini » et surtout ne pas le mettre où le fini convient seul. Cela se mesure, il y faut un œil qui ne se regarde pas dans un miroir mais qui traversant le miroir le brise et c’est dans ses tessons épars répandus sur la page que l’on fait image de soi. Comme l’âme, elle ne s’éveille que brisée.
« Donner des yeux au langage », comme le voulait Octavio Paz, la main le peut quand les pieds, leur martellement, est remuement du sens, appropriement du sol et de l’espace, ouverture de la bouche, cette « oreille qui voit » écrit Serge Pey, et qu’une autre langue naît dans la langue. Oui, c’est bien cela que l’on entend, une échappée de langue hors de la langue, une voix qui devient bâton pour assurer la marche du poème dans un monde devenu toujours plus dangereux où règnent la solitude des nantis comme des malheureux qui poussent leur pas sans bâton autre que celui qui, invisible, s’enfonce douloureusement dans leurs reins les jetant dans une en-avant éperdu, dans un monde où l’on détruit comme hier au Bourdigou, entre mer et étang, en Roussillon, aujourd’hui à Notre-Dame des Landes, ces lieux « où l’on pensait faire des choses en commun / pour qu’elles ne soient pas communes ».
On connaît l’aventure de Serge Pey enfant concernant la porte devenue table quand le père la dégonda pour accueillir et faire asseoir autour de cette nouvelle table ces amis inattendus poussés là par quelque nécessité. J’aime à croire que lui donner la volte vaille aussi. Alors c’est la table dont le plateau deviendrait porte si avec des amis on le verticalisait et le dressait ouverte sur les jours à venir et battante. Ce livre est table et porte, porte et table. Entrez / sortez, partagez repas et prenez ce chemin dont on sait bien qu’il se fera « al andar », pas après pas, comme le voulait Antonio Machado, grenade qu’on ouvre et que maintient ouverte un incessant éclair.
(publié dans la revue Europe)
09:40 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : serge pey
Balise 99-
Jean Bazaine aurait pu souffler cela à son ami Henri Maldiney qui l’aurait transmis à André Du Bouchet pour que nous le recueillons aujourd’hui :
« Travailler avec ce qu’on n’a pas. Non avec ce qui fait notre force, et qui est toujours illusion, mais avec notre faiblesse qui est notre ouverture au monde. Avec tout ce qui nous manque ».
09:36 Publié dans Balises | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bazaine, maldiney, du bouchet







