13/05/2009
Turbulence 34 - Etre de son siècle?
En écho à la chronique 43 de Jean-Marie Barnaud: Agamben et Badiou : Pour penser le contemporain qu'il faut absolument aller lire sur http://remue.net/spip.php?article3232 - ces mots d'Ossip Mandelstam sur le poète Alexandre Blok in La taissonière du blaireau, De la poésie, Arcades, Gallimard, 1990:
"Blok était un homme du XJX et il- savait que les jours de son siècle étaient comptés. Aussi, avidement, n'avait-il de cesse d'élargir et d'approfondir à temps son monde intérieur, comme un blaireau remuant la terre pour s'y construire une demeure, en s'y ménageant deux ouvertures. Le siècle, c'est la taissonière; l'homme vit et se meut en ce siècle sur un espace qui lui est chichement mesuré, s'escrimant fébrilement à étendre ses possessions, tout en affectionnant par-dessus tout les entrées de son terrier. Ainsi, mû par cet instinct de blaireau, Blok approfondissait sa connaissance poétique du XIXe."
14:39 Publié dans Dans les turbulences | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie
07/05/2009
Lu 40 - Patrick Laupin, L'homme imprononçable
"II y a un mot qui m'exalte, un mot que je jamais entendu sans ressentir un grand frisson, grand espoir, le plus grand, celui de vaincre les puissances de ruine et de mort qui accablent les hommes, ce mot c'est : fraternisation."
Paul Eluard
Je viens de relire L’homme imprononçable de Patrick Laupin. J’en sors « bouleversé d’humain ». Je l’avais lu, une première fois dans la foulée de notre rencontre – ce silence entre deux regards, deux sourires esquissés – à Lodève, lors des Voix de la Méditerranée 2008. Je l’avais lu comme l’on entend respirer, dans la nuit qui veille, la part inaliénable de l’homme, celle toujours à naître, qui « passe infiniment l’homme » dont parlait Pascal.
 Je le relis et retrouve à côté de son goût pour « le site des beautés ordinaires », le grand Rhône ou la barre des Cévennes, ces beautés naturelles qui sont « corps entier d’une écriture », non sans un serrement de gorge et un pincement de cœur – ou l’inverse – cette vaste « salle des pas perdus de l’existence » où errent avec « la sérénité des vaincus » : « chômeurs », « cheminots en bleu de travail », « hommes des hauts plateaux » ou les figures de « Paul », du « petit vannier », du « pourvoyeur d’abîme », de « l’ouvrier allemand », de « Marco », « hommes creux, titubés, vains, faillis d’espérance en qui la destruction expose crûment la douleur qui les hante. » Ces êtres de bord de monde, « toujours en passe de trébucher », ces êtres dont « (la) parole tombe » sont,, pour Patrick Laupin, des veilleurs mais aux confins de la vie. Quand rené Char nommait « alliés substantiels » ses amis peintres pour les « mille planches de salut » qu’offrait leur pratique de la peinture, Patrick Laupin reprend cette expression pour l’appliquer à ces tutoyeurs d’abîmes, ses frères, ses camarades : « j’ai trouvé mes alliés substantiels dans la tête pensive de quelques enfants fous, de quelques voyous méchamment lettrés ou quelques vagabonds, analphabètes, ce qui revient au même, et en quelques êtres d’écoute et de bonté naturelles, dont le corps ne trahissait pas l’émotion sincère. Avec eux, je pus vivre. »
Je le relis et retrouve à côté de son goût pour « le site des beautés ordinaires », le grand Rhône ou la barre des Cévennes, ces beautés naturelles qui sont « corps entier d’une écriture », non sans un serrement de gorge et un pincement de cœur – ou l’inverse – cette vaste « salle des pas perdus de l’existence » où errent avec « la sérénité des vaincus » : « chômeurs », « cheminots en bleu de travail », « hommes des hauts plateaux » ou les figures de « Paul », du « petit vannier », du « pourvoyeur d’abîme », de « l’ouvrier allemand », de « Marco », « hommes creux, titubés, vains, faillis d’espérance en qui la destruction expose crûment la douleur qui les hante. » Ces êtres de bord de monde, « toujours en passe de trébucher », ces êtres dont « (la) parole tombe » sont,, pour Patrick Laupin, des veilleurs mais aux confins de la vie. Quand rené Char nommait « alliés substantiels » ses amis peintres pour les « mille planches de salut » qu’offrait leur pratique de la peinture, Patrick Laupin reprend cette expression pour l’appliquer à ces tutoyeurs d’abîmes, ses frères, ses camarades : « j’ai trouvé mes alliés substantiels dans la tête pensive de quelques enfants fous, de quelques voyous méchamment lettrés ou quelques vagabonds, analphabètes, ce qui revient au même, et en quelques êtres d’écoute et de bonté naturelles, dont le corps ne trahissait pas l’émotion sincère. Avec eux, je pus vivre. »
Il y a dans la voix d’écriture de Patrick Laupin l’empreinte grave de ces êtres qui ont agrandi sa vie en lui apportant cette pauvreté essentielle, celle qui tient à nous de partout et nous fait ce que nous sommes, ces êtres dont le manque même est le ressort caché de ce qui en nous ne renonce pas à l’essentiel, à savoir cet homme que nous ne serons jamais suffisamment, cette exigence comme telle « imprononçable « qui nous voit porter valeurs de vie et amour qui les tient. Et nous tient. C’est ce sens de ce qui nous dépasse qui passe par ces hommes, ces hommes descendus, perdus qu’aime Patrick Laupin.
Et moi, j’aime voir dans ses mots qui portent l’inhumain jusqu’à nous tout l’humain affluer. Dès qu’un homme ou un groupe d’hommes est exclu de l’humanité, en lui passe l’humanité toute entière. Cela que j’avais appris chez Marx, voilà que ça me revient porté par l’écriture de Patrick Laupin. Dans cette humanité se tient toute la chance de l’humain, comme telle imprononçable. Comment comprendre ? C’est que l’humain n’a pas de contenu à proprement parler, il fait signe vers une exigence. L’homme n’est homme que dans la mesure où il estime qu’il ne l’est jamais assez. S’ouvre devant l’interminable même, espace qui interdit toute définition définitive de l’humain. Les mots ne sauraient le circonscrire. Pourtant, c’est par eux que passe le maintien et le respect de cet « imprononçable ». Par eux quand c’est un auteur tel que Patrick Laupin qui mène cette « guerre interne à la langue » par quoi on peut approcher ce que dit le mot poésie.
Maintenir, ce verbe va bien à Patrick Laupin. Il y a main. Il y a tenir. Il y a la prise en main, la garde, la sauvegarde, le prendre soin de. Et moins de l’homme – ce vague ! – que de ce qui en l’homme « compte pour homme », selon les mots d’Henri Michaux dans Ecce homo, ce poème des années 40, sombres temps, cet « imprononçable » qu’il est, cette chance que le poème redresse, libère et fait passer. Passage de vie, disait Deleuze.
Patrick Laupin, L’homme imprononçable suivi de Phrase et Le mystère de la création en chacun, La rumeur libre éditions, 18 euros
© Alain Freixe
14:45 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, poésie
Balise 47 - C'était en 1936, et pour Paul Eluard, cela s'appelait "l'évidence poétique"
« ô vous qui êtes mes frères parce que j'ai des ennemis ! » a dit Benjamin Péret.
Contre ces ennemis, même aux bords extrêmes du découragement, du pessimisme, nous n'avons jamais été complètement seuls. Tout, dans la société actuelle, se dresse, à chacun de nos pas, pour nous humilier, pour nous contraindre, pour nous enchaîner, pour nous faire retourner en arrière. Mais nous ne perdons pas de vue que c'est parce que nous sommes le mal, le mal au sens où l'entendait Engels, parce qu'avec tous nos semblables, nous concourons à la ruine de.la bourgeoisie, à la ruine de son bien et de son beau.
C'est ce bien, c'est ce beau asservis aux idées de propriété, de famille, de religion, de patrie, que nous combattons ensemble. Les poètes dignes de ce nom refusent, comme les prolétaires, d'être exploités. La poésie véritable incluse dans tout ce qui ne se conforme pas à cette morale qui, pour maintenir son prestige, ne sait construire que des banques, des casernes, des prisons, des églises, des bordels. La poésie véritable est incluse dans tout ce qui affranchit l'homme de ce bien épouvantable qui a le visage de la mort. Elle est aussi bien dans l'œuvre de Sade, de Marx ou de Picasso que dans celle de Rimbaud, de Lautréamont ou de Freud. Elle est dans l’invention de la radio, dans l'exploit du Tchéliouskine, dans la révolution des Asturies*, dans les grèves de France et de Belgique. Elle peut être aussi bien dans la froide nécessité, celle de connaître ou de mieux manger, que dans le goût du merveilleux. Depuis plus de cent ans, les poètes sont descendus des sommets sur lesquels ils se croyaient. Ils sont allés dans les rues, ils ont insulté leurs maîtres, ils n'ont plus de dieux, ils osent embrasser la beauté et l'amour sur la bouche, ils ont appris les chants de révolte de la foule malheureuse et, sans se rebuter, essaient de lui apprendre les leurs.
Peu leur importent les sarcasmes et les rires, ils y sont habitués, mais ils ont maintenant l'assurance de parler pour tous. Ils ont leur conscience pour eux.
14:37 Publié dans Balises | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, poésoie
Lu 39 - Paul Eluard, une présence manifeste
 Onzième printemps des poètes ! On en sort. Restent entre rires et sourires, émotions et projets, ouvrages divers publiés pour l’occasion, deux livres de Paul Eluard publiés dans la collection Poésie/Gallimard, histoire de ne pas oublier que « notre printemps est un printemps qui a raison ».
Onzième printemps des poètes ! On en sort. Restent entre rires et sourires, émotions et projets, ouvrages divers publiés pour l’occasion, deux livres de Paul Eluard publiés dans la collection Poésie/Gallimard, histoire de ne pas oublier que « notre printemps est un printemps qui a raison ».
Le premier, J’ai un visage pour être aimé, est une anthologie, un choix de poèmes entre 1914 et 1951 fait par Paul Eluard lui-même peu de temps avant sa mort. Si l’on se souvenait que pour lui la plus belle anthologie était celle que l’on composait pour soi, on verrait que celle-ci lui donne encore une fois raison. Le visage qu’il nous donne de sa voix est fait pour se couvrir de regards. Il sait se faire aimer. On le suit de recueil en recueil, d’émotions en désirs, d’engagements en solidarités vers toujours plus de lumière où la raison trouverait enfin satisfaction. Au fil des livres sa passion du réeel ne se dément pas. Toujours il y a dans ses poèmes de quoi nourrir la nôtre. Puiser les provisions nécessaires « pour vivre ici ».
Eluard est toujours à découvrir ou à redécouvrir. Toujours à lire. Merci à André Velter qui signe la préface de nous rendre d’Eluard une présence manifeste.
Si Paul Eluard écrit pour être aimé, Man Ray selon Eluard « dessine pour être aimé » comme il l’affirme dans sa préface à ces Mains libres qu’ils  signent tous deux en 1936 pour l’offrir à Nusch et qui constitue le second volume publié en ce printemps.
signent tous deux en 1936 pour l’offrir à Nusch et qui constitue le second volume publié en ce printemps.
Un dessin. Un poème. Accouplés, dans cet ordre. Donc ici les dessins sont premiers, les poèmes d’Eluard servent à les « illustrer ». Par ce mot, j’entends qu’ils éclairent, portent dans la lumière les dessins de Man Ray : « toujours le désir, jamais le besoin ». Formidable renversement ! Si la toile de fond du recueil reste bien la guerre d’Espagne et les difficultés que traverse le Front Populaire, le thème dominant est celui de la liberté en amour pour une communauté d’ami(e)s : « tous devaient l’un à l’autre une nudité tendre » écrit Eluard dans « La plage », tous ont Les Mains libres comme Man Ray et ses dessins, Eluard et ses poèmes. Mains qui osent, qui comme dans « Le tournant » disent : « J’espère ce qui m’est interdit ». Mains qui dans cet espoir s’approchent l’une de l’autre , entrent en résonance pour « (appeler) le silence / par son plus petit nom ».
Ceux qui s’étaient promis « de ne rien voir qu’eux-mêmes » nous donnent dans ce livre une belle leçon de complicité artistique, d’audace, de liberté et d’amour.
Paul Eluard, J’ai un visage pour être aimé, Choix de poèmes 1914-1951, Poésie/Gallimard, Cat 4
Paul Eluard Man Ray, Les Mains libres, Poésie/Gallimard, Cat4
© Alain Freixe
14:30 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie
04/05/2009
Turbulence 33 - Mais Martine Broda vient de mourir...
"Nie vie, ni mort/ vie-mort à jamais",
disais-tu
Martine Broda
Fabienne Courtade m'apprenait le décès de Martine Broda. C'était hier. Au moment de boucler sacs et valises pour mes montagnes.
Je ne la connaissais qu'à travers ses poèmes - je pense à celui intitulé Tholos - ses essais - et c'est le très bel article sur Vie secrète de Pascal Quignard qui me saute à la plume - ses traductions de Paul Celan - de La rose de Personne en 1979 à La grille de Parole en 1991- et parce que j'aimais son travail pris entre lire, traduire et écrire, je la connaissais donc.
Poèmes, essais, traductions, un même amour de la langue, du sein même de "ce siècle incompréhensible et saignant", porte la langue de l'amour au lyrisme. Un lyrisme débarassé de tout ce que le subjectif peut avoir de fadasse au profit du désir qui même réalisé sait demeurer désir - oui, Char n'est pas loin - figure même de cet impossible qu'elle savait devoir aimer.
"sur la tombe la plus fraîche
amas de fleurs cueillies
mauve obscur
et des lys à foison
blanc pur
vert immortel"
Martine Broda
19:24 Publié dans Dans les turbulences | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, poésie
22/04/2009
Balise 46 - Et qu'on se le dise!
Marcel Proust écrit ceci à Mme Straus, veuve de Georges Bizet:
"La seule manière de défendre la langue, c'est de l'attaquer, mais oui, Madame Straus. Parce que son unité n'est faite que de contraires neutralisés d'une immobilité apparente qui cache une vie vertigineuse et perpétuelle."
18:47 Publié dans Balises | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, poésie
19/04/2009
Turbulence 32 - Mais Henri Meschonnic vient de mourir...
Henri Meschonnic, poète libre
Lodève, Les Voix de la Méditerranée. Eté 2008. Je viens d’écouter Jean-Yves Masson s’entretenir avec Henri Meschonnic. Riche de quelques questions, je le croise sur le stand de l’Atelier du Grand Tétras qui publie la revue Résonance générale qui lui a consacré son N°1 -Philippe Païni, Daniel Leroux, Laurent Mourey et Serge Martin, à qui j’ai emprunté le titre de cet article, en sont les rédacteurs. Je le retrouve ensuite sur le stand de la revue Faire part aux côtés d’Alain Chanéac et Alain Coste, qui la dirigent et qui viennent de publier, après un Jacques Dupin, matière d’origine, Le poème Meschonnic. A ma proposition d’un entretien à paraître dans l'Humanité courant 2009, il répond, sans hésitation et avec enthousiasme , favorablement. J’allais engager l’échange quand la ramasseuse de sarments est entrée hors-saison dans ses vignes. Henri Meschonnic est mort le 8 avril. Lui qui fut toujours homme de chantier, toujours à l’avant de lui-même, aventurier de la voix dans le poème, le voilà comme habitué à lui-même, à ses œuvres.
Si « ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience », selon les mots de René Char, alors Henri Meschonnic mérite les deux, par delà toutes les polémiques et les inimitiés. Il est vrai que l’homme eut parfois la plume dure et le mot acéré pour nombre de ses pairs. Et ils sont nombreux car cet enseignant, professeur de linguistique et de littérature à Lille d’abord puis à Paris VIII développa une œuvre critique – critiquer fut toujours pour lui conduire une réflexion sur ce qu’on ne connaît pas – considérable toujours en rupture avec les discours institués ou les modes tant sur le plan des essais – comment ne pas citer son Pour la poétique IV, Ecrire Hugo (1977) ou son langage heidegger (1990) – que sur celui des traductions – celles qu’il entreprit de la Bible , dès 1970 avec Les cinq rouleaux sont demeurées célèbres.
Sa grande originalité et ce qui donne cohérence à cet immense chantier fut de le développer à partir du poète qu’il entendait être depuis ses Dédicaces Proverbes (Gallimard,1972) au tout récent De monde en monde, paru en janvier dernier aux éditions Arfuyen. Ce poète n’écrivait pas des poèmes, il était celui que les poèmes faisaient. Avec Henri Meschonnic, le poème passe devant, la poésie derrière. Entendons-nous, la poésie quand elle n’est que cet amour de la poésie qui « produit des fétiches sans voix » avec quoi malheureusement, selon lui, on confond la poésie.
Avec Henri Meschonnic, le poème ne célèbre pas. Ne décrit pas. Ne nomme pas. Le poème est intervention – je ne peux m’empêcher d’entendre le « fini, maintenant j’interviendrai » d’Henri Michaux ! – ce qui suppose coupure et transformation. A Henri Meschonnic, on doit cette définition du poème : « il y a poème seulement si une forme de vie transforme une forme de langage et si réciproquement une forme de langage transforme une forme de vie ». Alors le poème, cet acte de langage qui toujours recommence, ce rythme particulier qu’il est rend visible notre rapport au monde. Là est le grand apport d’Henri Meschonnic : avoir pris le parti du rythme – Critique du rythme (Verdier, 1982), La rime et la vie (Verdier, 1990, repris en 2006, collection Folio), Politique du rythme, politique du sujet (Verdier, 1995)… - le parti du sujet. Celui du continu tant le rythme, selon lui, contient à la fois l’objet et le sujet, le monde et l’artiste. « Subjectivation maximale du langage », le poème est rythme. Il est l’oralité même, la voix comme « mode de signifiance » du langage dans l’écrit comme dans le parlé. Le poème donne plus à entendre qu’à voir. Il donne à entendre ce que les mots ne peuvent pas dire, ce continu d’un sujet. Là se fait le partage : de sujet à sujet – « Je parle, écrit Henri Meschonnic dans De monde en monde, / pour partager le silence / qui pousse tous les mots (…) pour transformer le silence / c’est ainsi qu’on s’entreparle ».
Cette théorie du rythme et du sujet rend indissociable poétique, éthique et politique. Le poème - l’œuvre d’art en général - est acte éthique et politique. Comme tel il transforme le sujet qui le fait et le sujet qui le reçoit. Pour cela, Henri Meschonnic pensait que les poèmes étaient susceptibles d’être entendus par chacun et que mettant en jeu le langage – ce qu’on en sait comme ce qu’on en fait – il mettait en jeu la société elle-même.
Henri Meschonnic ne s’est pas contenté de faire parti du monde – « on n’écrit ni pour plaire ni pour déplaire, écrivait-il, mais pour vivre et transformer la vie » - il sut y être présent. Et une présence, cela s’impose, s’expose. Et dérange. Comme un coup de vent. S’il déchire, il éclaire le paysage. A chacun d’aller vers ce qu’il ne connaît pas !
(article paru dans le quotidien L'Humanité, le 16 avril 2009)
20:28 Publié dans Dans les turbulences | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, poésie
Lu 38 - Yves Namur, Dieu ou quelque chose comme ça
 Dieu. Que disons-nous quand disons ce mot-là ? Comment écrire ce que dit ce mot-là ? Comment prononcer cet imprononçable ?
Dieu. Que disons-nous quand disons ce mot-là ? Comment écrire ce que dit ce mot-là ? Comment prononcer cet imprononçable ?
Rester comme Yves namur dans cette approximation « quelque chose comme ça ».
ça ? quoi ? Oh, trois fois rien. Pas grand chose. Rien qui ne se laisse prendre aux signes. Un au-delà ou un en-deçà, en tout cas un hors-là, hors de ce qui peut se montrer, se dire. Celui qui s’interroge alors « marche sur un chemin d’air, sur un chemin d’étincelles. » Cette marche en avant( dans l’inconnu n’est pas penser seulement mais bien vivre ses pensées. Méditer, oui. Et Méditation me semble être le mot qui convient à cet écrit d’Yves Namur.
Ainsi va Yves Namur : cœur à nu, yeux bandés vers « les choses de Dieu » « sans prêter attention » à rien en particulier. On pourrait reconnaître dans cette attention toute tissée d’attente vide, le regard d’une Simone Weil qui ne s’exerce que tous feux éteints sans jamais chercher car à chercher on ne trouve jamais que ce qu’on cherche.
Or Yves Namur ne sait pas ce qu’il cherche. Il va d’une écriture belle dans sa sobriété. Dépouillée, « incertaine » travaillée par cette question ouverte par le nom de Dieu qui ne saurait être ni ceci, ni cela, jusqu’à l’expression même du doute. Doute – et ce sera la question finale de cette méditation – « ne se transformerait-il pas en foi » ?
À cet instant du saut, s’arrête la méditation. Elle n’ira pas plus loin. Il n’y aura pas de pas au-delà. Au bord du ravin, les mots du poète ne fleurissent qu’en interrogations. Beau jardin !
Yves Namur, Dieu ou quelque chose comme ça, Lettres Vives, collection Entre 4 yeux, 2008 (13 euros)
(article paru dans le quotidien L'Humanité le 5 mars 2009)
20:22 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, poésie
09/04/2009
Raphaël Monticelli - Saint Georges (extrait de La légende fleurie)
( Ce texte de Raphaël Monticelli est extrait du recueil de La légende fleurie, qui a servi de préface à l’exposition de Martine Orsoni à la fondation Sicard-Iperti (Vallauris), en octobre 1993, éditions de la fondation Sicard-Iperti.)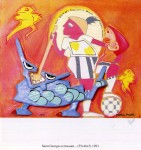
Il existe au moins deux saints portant le nom de Georges ; si le plus ancien est très célèbre et révéré, l’autre ne lui cède rien en grandeur, dévotion et humilité. Je te dis ailleurs l’histoire merveilleuse de Saint Georges de la Manade de Marie, laisse-moi te raconter ici l’épisode le plus merveilleux de celle de Saint Georges de Cappadoce qui, avant de devenir martyr de J.-C., sous Dioclétien et Maximien, par la fureur de Dacien, terrible persécuteur de Chrétiens, libéra, par le nom de J.-C., la cité lybienne de Silcha du dragon infâme qui la tourmentait.
Ce dragon hantait les grands étangs qui bordaient la cité à l’Est ; si on le voyait peu, on le reconnaissait à ses effets, aux carnages qu’il perpétrait, aux traces immondes qu’il laissait aux abords des étangs, à la fournaise dont il accompagnait son passage, à l’infect brouillard très puant dont il était entouré en toute occasion, à la terreur qu’il inspirait.
On le devinait aussi élevé que les cyprès ou les cèdres les plus imposants, il se déplaçait soit par répugnantes reptations, soit par bonds inattendus, lourds et disgracieux, selon que son énorme queue s’agitait horizontalement ou verticalement ; ses yeux rouges lançaient, dit-on, de tels feux qu’on les percevait, même dans la nuit, à travers son brouillard, son haleine ardente faisait bouillonner les eaux sur lesquelles elle planait, desséchait animaux et végétaux, ternissait et effritait les minéraux, durcissait les boues, faisait se rétracter le sable et le transformait en une dure matière glauque. Pour autant que l’on pût en juger, son corps était constamment travaillé par des pustules éructants qui crevaient en déversant un pus abondant et ocre qui lui dégouttait le long des flancs, et la terre qu’il imprégnait en devenait éternellement stérile.
Chaque jour, le dragon ne cessait de menacer les hautes et dérisoires murailles de Silcha qu’après avoir reçu sa pâture qui consistait en deux brebis bien grasses, une à midi, une le soir, ou toute autre denrée équivalente, pourvu que qu’elle fût de chair vivante et grasse, d’une constitution jeune et aux os bien craquants sous la dent.
Les choses allèrent ainsi jusqu’au jour où, le bétail venant à manquer, on s’avisa de le remplacer par les jeunes gens et les jeunes filles de la cité, chaque jour tirés au sort. On les envoyait seuls et nus, à la rencontre de la bête qui ne pouvait supporter ni parure ni vêtement, seulement accompagnés des pleurs de leurs proches et préparés par un repas dont les mets, rehaussés d’épices et de drogues, étaient servis avec des alcools divers destinés à étouffer leurs angoisses. Dans toutes les familles ce n’étaient que craintes, angoisses et lamentations modulées chaque jour du fait que le nombre des jeunes diminuant de deux chaque jour, la probabilité, pour les survivants, d’être tirés au sort s’élevait à mesure chaque jour ce qui, par contrecoup, faisait d’autant tomber l’angoisse et accroître les lamentations.
Le sort tomba sur la fille du roi, dont la tradition a perdu le nom sinon toute mémoire, le jour même où passait par là Saint Georges qui la croisa alors qu’elle se dirigeait, seulette et attristée, sans voiles et les pieds nus, sous le soleil lybien, vers le grand étang où attendait le dragon. Georges, tout ému d’un tel abandon, d’une telle déréliction errante et d’une tristesse si grande, si belle, si jeune et si nue, lui en demande la raison ; elle, du fond de son trouble, tant bien que mal, la lui dit ; lui, tout aussitôt, s’enflamme, et propose son aide ; elle, dans un sursaut de lucidité, bredouille une mise en garde ; lui, pousse un grand cri et son cheval au galop ; elle, entre deux pensées, s’émeut et tout soudain, transportée d’espoir, se met à courir, trébuchant et agitant les bras ; lui, s’approche avec célérité du brouillard de l’étang dont émerge le dragon, furieux de voir son déjeuner venir tout habillé.
Georges prononce alors le nom de N.S.J.-C. en même temps qu’il se signe ; à cette double invocation, le monstre a comme un recul rugissant, puis, tout aussi brusquement, projetant sa gueule en avant, il se lance sur Georges au moment même où, dans un grand cri, le saint, dont le cheval s’envole, vise le cou du fauve en propulsant sa lance. Les vitesses accumulées de la course du dragon et de celle du cheval, ajoutées à celle de l’arme brandie par les muscles du saint et à celle du cou du monstre tendant sa mâchoire vers sa proie, furent telles que c’est avec une force inouïe que la lance rencontra le cou, s’y enfonça avec aisance et resta fichée là, selon un angle tel qu’elle bloqua une partie de la trachée et sectionna à moitié la carotide. Cela fut la cause d’une faiblesse immédiate chez l’animal qui, le souffle court et impuissant, râlant et bavant, secoué de faibles soubresauts, sa peau pustuleuse desséchée et l’oeil trouble, tomba à genoux devant Georges.
Pendant ce temps la princesse avait fini par rejoindre le lieu du combat ; elle était toute haletante, et la fatigue redoublait les troubles de l’alcool, des drogues et de se sentir nue sous les regards d’un homme à cheval, triomphant et dont elle contemplait la gloire.
Elle sentit alors monter, du plus profond d’elle même et tout le long de son corps et de ses membres, un spasme violent qui la surprit, la baigna de satisfaction et la mit à terre dans un état d’étourdissement profond et béat qu’elle n’avait encore jamais connu et dont elle ne souhaitait plus se relever que pour pouvoir à nouveau contempler Georges qui considérait sans haine et sans terreur, l’animal terrassé dont les yeux se révulsaient.
18:50 Publié dans Mes ami(e)s, mes invité(e)s | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie
Balise 45 - Gilles Deleuze, Image et ritournelle
"L'image est une petite ritournelle, visuelle ou sonore, quand l'heure est venue :« l'heure exquise... ». Dans Watt, les trois grenouilles entremêlent leurs chansons, chacune avec sa cadence propre, Krak, Krek et Krik. Les images-ritournelles courent à travers les livres de Beckett. Dans Premier amour, lui, voit se balancer un coin de ciel étoilé, et elle, chantonne à voix basse. C'est que l'image ne se définit pas par le sublime de son contenu, mais par sa forme, c'est-à-dire par sa « tension interne », ou par la force qu'elle mobilise pour faire le vide ou forer des trous, desserrer l'étreinte des mots, sécher le suintement des voix, pour se dégager de la mémoîre et de la raison, petite image alogique, amnésique, presque aphasique, tantôt se tenant dans le vide, tantôt frissonnant dans l'ouvert*. L'image n'est pas un objet, mais un « processus». On ne sait pas la puissance de telles images, si simples soient-elles du point de vue de l'objet."
*Le monde et le pantalon, p. 20 (et sur les deux sortes d'images, chez Bram et Geer van Velde, image figée et image frissonnante).
18:43 Publié dans Balises | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, poésie
02/04/2009
Turbuence 31 - Bernard Noël, Précis d'humiliation
( Je relaie ce texte de Bernard Noël. Chacun mesurera son importance aujourd'hui où les représentants des pouvoirs économiques et financiers parlent entre eux à Londres une langue que les vers de l'argent ont pourri et avec laquelle ils cherchent à communiquer autour d'une "moralisation du capitalisme"! Je prends le texte de Bernard Noël comme une intervention, une parole contre les paroles, ce trop plein d'absence.)
Précis d'humiliation
Toujours, l’État s’innocente au nom du Bien public de la violence qu’il exerce. Et naturellement, il représente cette violence comme la garantie même de ce Bien, alors qu’elle n’est rien d’autre que la garantie de son pouvoir. Cette réalité demeure masquée d’ordinaire par l’obligation d’assurer la protection des personnes et des propriétés, c’est-à-dire leur sécurité. Tant que cette apparence est respectée, tout paraît à chacun normal et conforme à l’ordre social. La situation ne montre sa vraie nature qu’à partir d’un excès de protection qui révèle un excès de présence policière. Dès lors, chacun commence à percevoir une violence latente, qui ne simule d’être un service public que pour asservir ses usagers. Quand les choses en sont là, l’État doit bien sûr inventer de nouveaux dangers pour justifier le renforcement exagéré de sa police : le danger le plus apte aujourd’hui à servir d’excuse est le terrorisme.
Le prétexte du terrorisme a été beaucoup utilisé depuis un siècle, et d’abord par les troupes d’occupation. La fin d’une guerre met fin aux occupations de territoires qu’elle a provoquées sauf si une colonisation lui succède. Quand les colonisés se révoltent, les occupants les combattent au nom de la lutte contre le terrorisme. Tout résistant est donc qualifié de « terroriste » aussi illégitime que soit l’occupation. En cas de « libération », le terroriste jusque-là traité de « criminel » devient un « héros » ou bien un « martyr » s’il a été tué ou exécuté.
Les héros et les martyrs se sont multipliés depuis que les guerres ont troqué la volonté de domination contre celle d’éradiquer le « terrorisme ». Cette dernière volonté est devenue universelle depuis les attentats du 11 septembre 2001 contre les tours du World Trade Center : elle a même été sacralisée sous l’appellation de guerre du Bien contre le Mal. Tous les oppresseurs de la planète ont sauté sur l’occasion de considérer leurs opposants comme des suppôts du Mal, et il s’en est suivi des guerres salutaires, des tortures honorables, des prisons secrètes et des massacres démocratiques. Dans le même temps, la propagande médiatique a normalisé les actes arbitraires et les assassinats de résistants pourvu qu’ils soient « ciblés ».
Tandis que le Bien luttait ainsi contre le Mal, il a repris à ce dernier des méthodes qui le rendent pire que le mal. Conséquence : la plupart des États – en vue de ce Bien là - ont entouré leur pouvoir de précautions si outrées qu’elles sont une menace pour les citoyens et pour leurs droits. Il est par exemple outré que le Président d’une République, qui passe encore pour démocratique, s’entoure de milliers de policiers quand il se produit en public. Et il est également outré que ces policiers, quand ils encombrent les rues, les gares et les lieux publics, traitent leurs concitoyens avec une arrogance et souvent une brutalité qui prouvent à quel point ils sont loin d’être au service de la sécurité.
Nous sommes dans la zone trouble où le rôle des institutions et de leur personnel devient douteux. Une menace est dans l’air, dont la violence potentielle est figurée par le comportement des forces de l’ordre, mais elle nous atteint pour le moment sous d’autres formes, qui semblent ne pas dépendre directement du pouvoir. Sans doute ce pouvoir n’est-il pas à l’origine de la crise économique qui violente une bonne partie de la population, mais sa manière de la gérer est si évidemment au bénéfice exclusif de ses responsables que ce comportement fait bien davantage violence qu’une franche répression. L’injustice est tout à coup flagrante entre le sort fait aux grands patrons et le désastre social généré par la gestion due à cette caste de privilégiés, un simple clan et pas même une élite.
La violence policière courante s’exerce sur la voie publique ; la violence économique brutalise la vie privée. Tant qu’on ne reçoit pas des coups de matraque, on peut croire qu’ils sont réservés à qui les mérite, alors que licenciements massifs et chômage sont ressentis comme immérités.D’autant plus immérités que l’information annonce en parallèle des bénéfices exorbitants pour certaines entreprises et des gratifications démesurées pour leurs dirigeants et leurs actionnaires. Au fond, l’exercice du pouvoir étant d’abord affaire de « com » (communication) et de séduction médiatique, l’État et ses institutions n’ont, en temps ordinaire, qu’une existence virtuelle pour la majorité des citoyens, et l’information n’a pas davantage de consistance tant qu’elle ne se transforme pas en réalité douloureuse. Alors, quand la situation devient franchement difficile, la douleur subie est décuplée par la comparaison entre le sort des privilégiés et la pauvreté générale de telle sorte que, au lieu de faire rêver, les images « people » suscitent la rage. Le spectacle ne met plus en scène qu’une différence insupportable et l’image, au lieu de fasciner, se retourne contre elle-même en exhibant ce qu’elle masquait. Brusquement, les cerveaux ne sont plus du tout disponibles !
Cette prise de conscience n’apporte pas pour autant la clarté car le pouvoir dispose des moyens de semer la confusion. Qu’est-ce qui, dans la « Crise », relève du système et qu’est-ce qui relève de l’erreur de gestion ? Son désastre est imputé à la spéculation, mais qui a spéculé sinon principalement les banques en accumulant des titres aux dividendes mirifiques soudain devenus « pourris ». Cette pourriture aurait dû ne mortifier que ses acquéreurs puisqu’elle se situait hors de l’économie réelle mais les banques ayant failli, c’est tout le système monétaire qui s’effondre et avec lui l’économie.
Le pouvoir se précipite donc au secours des banques afin de sauver l’économie et, dit-il, de préserver les emplois et la subsistance des citoyens. Pourtant, il y a peu de semaines, la ministre de l’économie assurait que la Crise épargnerait le pays, puis, brusquement, il a fallu de toute urgence donner quelques centaines de milliards à nos banques jusque-là sensées plus prudentes qu’ailleurs. Et cela fait, la Crise a commencé à balayer entreprises et emplois comme si le remède précipitait le mal.
La violence ordinaire que subissait le monde du travail avec la réduction des acquis sociaux s’est trouvée décuplée en quelques semaines par la multiplication des fermetures d’entreprises et des licenciements. En résumé, l’État aurait sauvé les banques pour écarter l’approche d’un krach et cette intervention aurait bien eu des effets bénéfiques puisque les banques affichent des bilans positifs, cependant que les industries ferment et licencient en masse. Qu’en conclure sinon soit à un échec du pouvoir, soit à un mensonge de ce même pouvoir puisque le sauvetage des banques s’est soldé par un désastre?
Faute d’une opposition politique crédible, ce sont les syndicats qui réagissent et qui, pour une fois, s’unissent pour déclencher grèves et manifestations. Le 29 janvier, plus de deux millions de gens défilent dans une centaine de villes. Le Président fixe un rendez-vous aux syndicats trois semaines plus tard et ceux-ci, en dépit du succès de leur action, acceptent ce délai et ne programment une nouvelle journée d’action que pour le 19 mars. Résultat de la négociation : le « social » recevra moins du centième de ce qu’ont reçu les banques. Résultat de la journée du 19 mars : trois millions de manifestants dans un plus grand nombre de villes et refus de la part du pouvoir de nouvelles négociations.
La crudité des rapports de force est dans la différence entre le don fait aux banques et l’obole accordée au social. La minorité gouvernementale compte sur l’impuissance de la majorité populaire et la servilité de ses représentants pour que l’Ordre perdure tel qu’en lui-même à son service. On parle ici et là de situation « prérévolutionnaire », mais cela n’empêche ni les provocations patronales ni les vulgarités vaniteuses du Président. Aux déploiements policiers s’ajoutent des humiliations qui ont le double effet d’exciter la colère et de la décourager. Une colère qui n’agit pas épuise très vite l’énergie qu’elle a suscitée.
La majorité populaire, qui fut séduite et dupée par le Président et son clan, a cessé d’être leur dupe mais sans aller au-delà d’une frustration douloureuse. Il ne suffit pas d’être la victime d’un système pour avoir la volonté de s’organiser afin de le renverser. Les jacqueries sont bien plus nombreuses dans l’histoire que les révolutions : tout porte à croire que le pouvoir les souhaite afin de les réprimer de façon exemplaire. Entre une force sûre d’elle-même et une masse inorganisée n’ayant pour elle que sa rage devant les injustices qu’elle subit, une violence va croissant qui n’a que de faux exutoires comme les séquestrations de patrons ou les sabotages. Ces actes, spontanés et sans lendemain, sont des actes désespérés.
Il existe désormais un désespoir programmé, qui est la forme nouvelle d’une violence oppressive ayant pour but de briser la volonté de résistance. Et de le faire en poussant les victimes à bout afin de leur démontrer que leur révolte ne peut rien, ce qui transforme l’impuissance en humiliation. Cette violence est systématiquement pratiquée par l’un des pays les plus représentatifs de la politique du bloc capitaliste : elle consiste à réduire la population d’un territoire au désespoir et à la maintenir interminablement dans cet état. Des incursions guerrières, des bombardements, des assassinats corsent régulièrement l’effet de l’encerclement et de l’embargo. Le propos est d’épuiser les victimes pour qu’elles fuient enfin le pays ou bien se laissent domestiquer.
L’expérimentation du désespoir est poussée là vers son paroxysme parce qu’elle est le substitut d’un désir de meurtre collectif qui n’ose pas se réaliser. Mais n’y a-t-il pas un désir semblable, qui bien sûr ne s’avouera jamais, dans la destruction mortifère des services publics, la mise à la rue de gens par milliers, la chasse aux émigrés ? Cette suggestion n’est exagérée que dans la mesure où les promoteurs de ces méfaits se gardent d’en publier clairement les conséquences. Toutefois à force de délocalisations, de pertes d’emplois, de suppressions de lits dans les hôpitaux, de remplacement du service par la rentabilité, d’éloges du travail quand il devient introuvable, une situation générale est créée qui, peu à peu, met une part toujours plus grande de la population sous le seuil du supportable et l’obligation de le supporter.
Naturellement, le pouvoir accuse la Crise pour s’innocenter, mais la Crise ne fait qu’accélérer ce que le Clan appelait des réformes. Et il ose même assurer que la poursuite des réformes pourrait avoir raison de la Crise… Les victimes de cette surenchère libérale sont évidemment aussi exaspérées qu’ impuissantes, donc mûres pour le désespoir car la force de leur colère va s’épuiser entre un pouvoir qui les défie du haut de sa police, une gauche inexistante et des syndicats prenant soin de ne pas utiliser l’arme pourtant imbattable de la grève générale.
Pousser à la révolte et rendre cette révolte impossible afin de mater définitivement les classes qui doivent subir l’exploitation n’est que la partie la plus violente d’un plan déjà mis en œuvre depuis longtemps. Sans doute cette accélération opportune a-t-elle été provoquée par la Crise et ses conséquences économiques, lesquelles ont mis de la crudité dans les intérêts antipopulaires de la domination, mais la volonté d’établir une passivité générale au moyen des media avait déjà poussé très loin son plan. Cette passivité s’est trouvée brusquement troublée par des atteintes insupportables à la vie courante si bien - comme dit plus haut – que les cerveaux ont cessé d’être massivement disponibles. Il fallait dès lors décourager la résistance pour que son mouvement rendu en lui-même impuissant devienne le lieu d’une humiliation exemplaire ne laissant pas d’autre alternative que la soumission. Ainsi le pouvoir économique, qui détient la réalité du pouvoir, dévoile sa nature totalitaire et son mépris à l’égard d’une majorité qu’il s’agit de maintenir dans la servilité en attendant qu’il soit un jour nécessaire de l’exterminer.
© Bernard Noël
17:36 Publié dans Dans les turbulences, Mes ami(e)s, mes invité(e)s | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : littérature, poésie
Lu 37 - Gaston Puel par Eric Dazzan
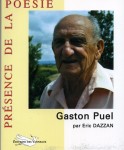 Après Pierre Garnier, Jean Malrieu, Serge Wellens, Pierre Dhainaut, Présence de la poésie, cette collection ouverte par Cécile Odartchenko aux éditions des Vanneaux qu’elle dirige, accueille Gaston Puel. L’homme de Veilhes est présenté par Eric Dazzan. Comme pour les volumes précédents, trois espaces font tresse à ce livre. Le premier accueille une présentation du poète et de son œuvre ; le second, iconographique, est illustré ici – une fois n’est pas coutume ! – par des références autobiographiques manuscrites par Gaston Puel ; le dernier est une anthologie de poèmes enrichie d’une dizaine de « poèmes récents ».
Après Pierre Garnier, Jean Malrieu, Serge Wellens, Pierre Dhainaut, Présence de la poésie, cette collection ouverte par Cécile Odartchenko aux éditions des Vanneaux qu’elle dirige, accueille Gaston Puel. L’homme de Veilhes est présenté par Eric Dazzan. Comme pour les volumes précédents, trois espaces font tresse à ce livre. Le premier accueille une présentation du poète et de son œuvre ; le second, iconographique, est illustré ici – une fois n’est pas coutume ! – par des références autobiographiques manuscrites par Gaston Puel ; le dernier est une anthologie de poèmes enrichie d’une dizaine de « poèmes récents ».
Je suis heureux de cette parution.J ‘ai lu ces pages avec la même joie qui me faisait – c’était hier ! – saluer l’homme de tous les refus, l’insurgé chaleureux qui demande au mélèze : « délivre-moi de la tendresse qui arrondit l’amour » afin qu’éperonné jusqu’à la brûlure « l’âme s’ouvre au vent qui vient », « âme errante » qui sait reconnaître ses « attaches », selon le titre du dernier livre qu’il vient de publier aux éditions de l’Arrière-Pays. Louer le tôt levé qui sait recevoir « l’aube comme un baquet d’eau fraîche », le marcheur matinal qui va « vers le grand poumon des versants », l’homme incertain qui lit l’espoir – cet « élan vers l’impossible » - dans les nuages de son pays et dans le vernt, « la grâce de recommencer ».
J’aime à retrouver dans ces pages présent, le poète. Le « livreur » solaire de « mots lavés de frais / à la source du matin », le passeur qui dégèle le monde et dont la voix laisse entendre un triple oui aux travaux et aux jours après que dans la bouche s’est défait un NON murmuré pour « (acquiescer) au futur sans oreille, à la terre qui se dérobe sous nos pieds ».
Eric Dazzan a raison de voir dans la poésie de Gaston Puel, dans sa vie en poésie depuis les années 40, une « traversée de l’invivable », traversée obstinée, sans concession avec le monde des Lettres, sans illusion sur les pouvoirs de la parole, fidèle à ce « lien mortel » qu’il noua tôt avec la terre « grave et souffrante ».
Lien qui se goûte sur la langue, dans les mots de ses poèmes. « Saveur mortelle » de la poésie de Gaston Puel. Source de vie pour qui sait se rendre « sensible à la part renaissante de chaque chose qui dure (…) devancer dans ce qui passe le souffle qui va l’emporter, participer ainsi de ce qui le ressuscite », selon les mots de Joë Bousquet, aimés de Gaston Puel.
Contact: Editions des vanneaux - http://les.vanneaux.free.fr
16:09 Publié dans Du côté de mes interventions | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, poésie




