12/02/2012
Lecture de Michel Ménaché - Mahmoud Darwich : Le lanceur de dés, Photographies d’Ernest Pignon-Ernest, Editions Actes Sud
La voix magnifique et chaude de Mahmoud Darwich s’est éteinte à Houston le 9 août 2008. Son dernier recueil, traduit par Elias Sanbar, est superbement publié par les éditions Actes Sud avec des images d’Ernest Pignon-Ernest collées sur les murs de Cisjordanie en hommage au grand poète palestinien prématurément disparu. Le lanceur de dés est un livre des questions sur les hasards et les nécessités de la vie, les parties de cache-cache avec tous les dangers, les blessures de l’histoire intime et collective : « Maintenant les collines se hissent / pour téter les nuages diaphanes / et entendre la Révélation. / Le lendemain est la tombola des perplexes… » Le conflit israélo-palestinien traverse bien sûr toutes les pages de ce beau recueil mais c’est l’intime qui cristallise la tragédie collective, le poète ne s’exprimant jamais comme un porte-parole mais sa nostalgie de la patrie déchirée et dévastée s’inscrit dans le miroir commun de tout son peuple : « Je me suis tenu dans la soixantaine de ma blessure, / je me suis tenu dans la gare, / non pour attendre le train […] / mais pour conserver le littoral des oliviers / et des citronniers dans l’histoire de ma carte… » Ce pays dépecé est évoqué d’une métaphore beaucoup plus identitaire que géographique, la subjectivité imaginaire prenant nettement le pas sur le référant monétaire érigé en symbole : « Notre pays est au cœur de la carte, / son cœur troué comme la pièce d’une piastre / au marché des ferronniers. »
Ce n’est pas sur le mode messianique que s’exprime Mahmoud Darwich, il ne se veut pas prophète, témoin tout au plus, et s’il incarne la voix multiple du peuple palestinien, il doute de la légitimité même de l’attente collective qui pèse sur sa conscience : « Qui suis-je pour vous dire / ce que je vous dis / à la porte de l’église, / moi qui ne suis qu’un lanceur de dés / entre prédateur et proie. » Sans modestie excessive, il pratique l’introspection comme un révélateur de la tragédie, la nécessité impérieuse de donner voix : « J’ai gagné en lucidité, / non pour jouir de ma nuit étoilée / mais pour être témoin du massacre. »
Entre la légende de Narcisse et la Passion du Christ, le poète tente d’éviter les écueils de l’ego suicidaire et du sacrifice prophétique : « Qui suis-je pour vous dire / ce que je vous dis ? […] J’ai la chance de dormir seul, / d’écouter ainsi mon cœur, / de croire en mon talent à déceler la douleur / et appeler le médecin, / dix minutes avant de mourir, / dix minutes suffisantes pour revivre / par hasard et décevoir le néant. // Mais qui suis-je pour décevoir le néant ? »
Dans Scénario prêt à jouer, le poète illustre sous forme de parabole l’absurdité du conflit, décrivant un combat singulier dans une fosse borgne. Il n’y aura que des perdants dans la guerre qui s’éternise : « un assassin et sa victime reposent / dans le même trou… »
Enfin, le dernier poème, Muhammad, évoque la mort d’un enfant assassiné : « ange pauvre, / à la portée du fusil de son chasseur de sang-froid.»
Poésie de combat, sans certitudes d’airain, à connotation testamentaire comme si le poète pressentait déjà une fin imminente, abattait son jeu avant de disparaître : « Face à la porte, le miroir qui me connaît / apprivoise le visage de son visiteur / et un cœur prêt à tout célébrer. / Chaque chose choisit un sens à l’accident de la vie / et se contente des dons de ce présent de cristal. / Je n’ai pas su, / pas demandé pourquoi / je fêtais la complicité du quotidien et du possible. / Pourquoi je suivais la cadence d’une musique qui / s’élèvera des quatre coins de l’univers ? »
Les portraits de Mahmoud Darwich sérigraphiés, installés puis photographiés par Ernest Pignon-Ernest à Ramallah, Naplouse et Jérusalem-est sur des façades lépreuses, des ruines hurlantes, le mur de séparation entre les territoires, au checkpoint de Qalanda, multiplient la présence du poète dans son pays martyrisé. Mahmoud Darwich, palestinien planétaire, rejoint ainsi Rimbaud, Pasolini, Le Caravage, Maurice Audin et autres figures héroïques ou victimaires des violences particulières ou collectives de l’histoire humaine, mis visuellement en scène dans les espaces urbains et les fractures du monde d’aujourd’hui par un artiste singulier, aussi talentueux que visionnaire…
Paru dans la revue EUROPE n° 978 oct. 2010
22:02 Publié dans Mes ami(e)s, mes invité(e)s | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ménaché, darwish, poésie
04/02/2012
In memoriam Bernard Vargaftig
Quand "la fugacité disparaît"*
La mort, c’était hier, le 27 janvier 2012 à Avignon.
La vie, c’est 1934, la naissance à Nancy puis les terribles années 40, celles des persécutions nazies, années de la peur, de la fuite et du silence. Années de clandestinité où l ‘on apprend aussi à tenir, à se tenir.
La vie en poésie, ce sera en 1965, la soirée du Récamier et dans ce théâtre parisien les paroles d’encouragement de Louis Aragon. Après Chez moi partout publié en 1967 chez PJ Oswald se succèderont une trentaine de livres plus des livres d’artiste avec Olivier Debré, Colette Deblé, Germain Roesz…ainsi que deux remarquables anthologies ; l’une La poésie des romantiques chez Librio, l’autre Poésie de résistance chez J’ai lu. Je ne dirai rien des prix qu’il put recevoir chemin faisant, celui de l’académie Mallarmé en 1991, celui Jean Arp en 2008, je préfère évoquer ici ses deux derniers ouvrages en souhaitant qu’ils donnent envie de retrouver ceux qui se tiennent à l’arrière et notamment cette Suite Fenosa, avec Bernard Noël, publiée chez André Dimanche en 1987.
Le premier est un coffret original liant image et texte, Coffret livre « L’aveu même d’être là »
et DVD « Dans les jardins de mon père », les deux constituants comme une autobiographie poétique de Bernard Vargaftig. Le poète a choisi lui-même les poèmes de son anthologie. Revisitant son œuvre, c’est sa vie qu’il reparcourt. Se promenant dans ses poèmes, il s’arrête ici ou là, comme dans ses souvenirs d’enfant juif caché en Haute-Vienne, près d’Oradour, pendant l’occupation nazie. Ce voyage dans la mémoire n’est pas un simple retour en arrière mais une véritable marche en avant, un véritable travail, une manière de creuser, de pousser plus avant la vie et ce souffle intérieur qui la porte. Cela qui a besoin de toujours plus de mots pour dire ce simple fait stupéfiant « d’être là », traversé de tous les désastres comme de toute lumière. Aveu à répéter dans la différence de ce qui n’en finit pas de commencer toujours à nouveau.
A propos du second, il peut être intéressant de se souvenir de ce qu’Aragon, en 1967, lors de la publication de La véraison chez Gallimard, disait : « j’aime ça, ce langage, haché comme la douleur ». En effet, Ce n’est que l’enfance est un livre que la douleur rythme. C’est elle qui espace les poèmes, les strophes – quatre strophes de quatre vers pour chaque poème – qui va jusqu’à inclure « deux pages blanches et muettes » pour « (dire) la mémoire vivante de (son) fils, Didier Vargaftig ». Devenue rythme, c’est elle qui engendre le temps propre à ce livre. Un temps dont la couleur pudique est celle du « déplacement intérieur » d’un « cri nul désert », le blanc d’un mouvement qui dénude, « faille d’enfance » avant « le dévalement », « accomplissement à nu que le manque / ne rattrape pas » et où c’est l’enfance qui appelle depuis cette distance où elle se tient, ce souffle qu’elle sait creuser toujours à l’avant de nos jours. L’enfance en appelle aux mots non pour combler cette déchirure, la taire par la même occasion mais pour la maintenir, au contraire, aussi vive que ces falaises qui tiennent, face aux vagues aveugles qui les dénudent toujours plus comme cet « ailleurs de moi d’un ailleurs / par la crainte dont la répétition se rapproche / où c’est l’accomplissement qui s’ouvre ».
Aujourd’hui, nous reste son murmure – Il disait : « Je n’écris pas, je marmonne » - sa respiration d’encre, son souffle. C’est là qu’il engagea son être et son existence, son insoumission au monde comme il va charriant toujours plus d’injustice et d’intolérable.
Bernard Vargaftig n’est pas mort. Sa vie s’est accomplie.
* Article paru dans l'Humanité du 02 février 2012
Bernard Vargaftig, Coffret livre « L’aveu même d’être là » et DVD « Dans les jardins de mon père », film de valérie Minetto et Cécile vargaftig, Au diable vauvert, La Laune, BP 72, 30600 Vauvert (39 euros)
Bernard Vargaftig, Ce n’est que l’enfance, Prix de littérature Nathan Katz 2008Arfuyen, Lac Noir, 68370 Orbey ( 11 euros)
08:13 Publié dans Dans les turbulences, Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard vargaftig, poésie, alain freixe
01/01/2012
Chantal Danjou - Récits du feu (extraits inédits)
 Poète, nouvelliste et critique littéraire, par ailleurs membre du conseil de rédaction des Editions Encres Vives, Chantal DANJOU vit et travaille aujourd’hui dans le Var après un long séjour parisien. Docteur ès lettres, professeur durant de nombreuses années, elle intervient à présent dans des instituts de formation d’enseignants (direction de mémoires et conception de projets concernant la lecture et l’expérience poétiques). Elle anime aussi des ateliers d’écriture et depuis 1989, d’abord à Paris puis en Région PACA, participe à faire connaître la poésie contemporaine avec l’association qu’elle a co-fondée, La Roue Traversière : présentations d’auteurs ; table ronde autour de revues et d'éditeurs de poésie ; interdisciplinarité artistique. Elle est, d’autre part, sociétaire de la SGDL et membre de la Maison des Ecrivains et de la Littérature.
Poète, nouvelliste et critique littéraire, par ailleurs membre du conseil de rédaction des Editions Encres Vives, Chantal DANJOU vit et travaille aujourd’hui dans le Var après un long séjour parisien. Docteur ès lettres, professeur durant de nombreuses années, elle intervient à présent dans des instituts de formation d’enseignants (direction de mémoires et conception de projets concernant la lecture et l’expérience poétiques). Elle anime aussi des ateliers d’écriture et depuis 1989, d’abord à Paris puis en Région PACA, participe à faire connaître la poésie contemporaine avec l’association qu’elle a co-fondée, La Roue Traversière : présentations d’auteurs ; table ronde autour de revues et d'éditeurs de poésie ; interdisciplinarité artistique. Elle est, d’autre part, sociétaire de la SGDL et membre de la Maison des Ecrivains et de la Littérature.
Denières publications:
Poètes, chenilles, les chênes sont rongés, Ed. Tipaza, Cannes, 2008
Blanc aux murs rouges, Ed. Encres Vives, Colomiers, 2009
Les Amants de glaise, Ed. Rhubarbe, 2009
Pension des oracles à l’auvent de bambou, Ed. Encres Vives, Colomiers, 2011
La mer intérieure, entre les îles, Ed. Mémoire Vivante, en projet pour 2012
L’ancêtre sans visage, Ed. Collodion, en projet pour 2013
Anthologies:
Et si le rouge n’existait pas, le Temps des cerises, 2010
Pour Haïti, Desnel, 2010
Les poètes en Val d’hiver, Anthologie par un collectif international, Corps Puce, 2011
Anthologie de la poésie érotique féminine contemporaine de Giovanni Dotoli, Hermann Lettres éditions, 2011
*
Récits
du
Feu
D 554
Brûlée. Rien ne bouge dans cette partie de la colline. Là. Une éternité. Et cette table d’orientation.
Pas seulement la colline. Brûlés. Les pins, les fleurs d’arbres. Le grand pluriel d’adret : chênes verts, bruissements, noms de plantes et d’oiseaux. Les arbustes passés au noir blanchissent. Blanchissent les rochers comme champ de neige. Neige, éternelle, chantante.
Les arbustes ? Une conscience. Le versant argileux. Sans prise sur le réel. Jour gris. Sa limpidité doucement. Passe. Aucune ombre. Ne danse. Ne frétille
D 25
Une certitude. On ne jette pas les couleurs. Comme les brindilles dans le feu. Autre certitude : la neige. Accumulation. Pellicule. Objets hétéroclites. Clairs-obscurs.
Terre. Révolue terre. De minuscules architectures. De grotesques jardins. Maçons, bâtisseurs et. Charpentiers, couvreurs, peintres. Pas plus hauts que soldats de plomb. Ils disent : gagner du terrain. L’été vient. Ni eau. Ni feu. Ni tremblement
N 7
Deux maçons et un peintre. Happés par la fourmilière. Charpentier enterré. Dans taupinière. Petite cueillant des fleurs. Ils chantent : Ah ! Mon beau château, ma tant’tire lire lire !
Rançon. Et les corps. Portant collier, bracelet. Couronnes de fleurs, boucles. Voici la mort. Formes et stupeurs. Perfection
A 57
Une forêt. Noire. Monte. A travers les arbres. Plus claire-colline. Le jour aux branches. Laisse voir. Par transparence : les baies rouges. Gros levant. Ou gros couchant. Le désespoir. Des brumes de chaleur. Amorce et délitement. Avec nuits successives. Nombreuses. Rapprochées. Espaces menés à saturation. Des écharpes : feuillages. Confins, toitures. Qui flottent
Extraits inédits - © Chantal Danjou
21:08 Publié dans Mes ami(e)s, mes invité(e)s | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, chantal danjou
20/11/2011
Bernard Mazo - Testament
 Né à Paris en 1939, poète, critique et essayiste, Bernard Mazo a publié une dizaine de recueils dont La cendre des jours (Voix d’encre, 2009), Prix Max Jacob 2010, Cette absence infinie (L’Idée bleue, 2004), La vie foudroyée (Le Dé bleu, 1999) et un essai : Sur les sentiers de la poésie (Melis Ed., 2008).
Né à Paris en 1939, poète, critique et essayiste, Bernard Mazo a publié une dizaine de recueils dont La cendre des jours (Voix d’encre, 2009), Prix Max Jacob 2010, Cette absence infinie (L’Idée bleue, 2004), La vie foudroyée (Le Dé bleu, 1999) et un essai : Sur les sentiers de la poésie (Melis Ed., 2008).
Il figure dans plusieurs anthologies dont Poésie de langue française, 144 poètes d’aujourd’hui (Seghers, 2008), L’Anthologie de la poésie française (Larousse, 2007), La Poésie française contemporaine (Le Cherche-Midi, 2004), Pour Jean Orizet, c’est un poète qui « élève sa désespérance à la hauteur d’une morale avec du Cioran chez lui ».Dans Le Monde, Alain Bosquet souligne que « Lapidaire parmi les lapidaires, Bernard Mazo arrive à une densité lumineuse que peuvent lui envier bien des poètes célèbres. » Monique Petillon dans le mêm e journal écrit, à propos de La vie foudroyée : « Voici une poésie magnifique que traverse une lucidité lumineuse, une tension constante entre parole et mutisme.»
e journal écrit, à propos de La vie foudroyée : « Voici une poésie magnifique que traverse une lucidité lumineuse, une tension constante entre parole et mutisme.»
La nouvelle revue de poésie Phoenix (Marseille) vient de lui consacrer un dossier dans son N°3.
*
TESTAMENT
Soleil plus altier
plus brûlant
que le plus brûlant des étés
O saisons
de toutes mes douleurs !
Incendie mes jours
consume ma vie
que je m’endorme enfin
dans l’oubli secourable !
J’aurai alors ce regard vide
des insectes sur la pierre
la mémoire vraiment saccagée
le corps bien froid
Ah ! Recouvrez-moi de cendres
ensevelissez-moi !
Je ne suis d’ici ni d’ailleurs
ni poussière dans le vent
ma terre est plus lointaine
que le plus lointain des confins
et mes mains
ne sont plus habitables…
Gassin, été 2010
22:07 Publié dans Inédits, Mes ami(e)s, mes invité(e)s | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, bernard mazo, phoenix
Lu 72 - Mon beau navire ô ma mémoire, Un siècle de poésie française - Gallimard 1911-2011
 Encore une anthologie ? Une anthologie consacrée à la poésie d’expression française du siècle dernier dans toute sa diversité et sa richesse ? Ici, nul axe de rencontre n'est privilégié - tous les choix formels et esthétiques, tous les tons se côtoient - le seul critère est éditorial: en effet, tous les poètes – 100 poètes, 100 poèmes pour 100 ans de poésie! – appartiennent au fonds poétique Gallimard, Antoine Gallimard se chargeant d’ailleurs lui-même de la préface.
Encore une anthologie ? Une anthologie consacrée à la poésie d’expression française du siècle dernier dans toute sa diversité et sa richesse ? Ici, nul axe de rencontre n'est privilégié - tous les choix formels et esthétiques, tous les tons se côtoient - le seul critère est éditorial: en effet, tous les poètes – 100 poètes, 100 poèmes pour 100 ans de poésie! – appartiennent au fonds poétique Gallimard, Antoine Gallimard se chargeant d’ailleurs lui-même de la préface.
Insistons sur le fait qu’ à l’exception de quelques noms toutes les grandes voix d’encre de ce temps sont là suivant un ordre alphabétique aussi simple qu’efficace.
Le vers d’Apollinaire qui fait titre invite à une odyssée: retour à quelques grands textes comme à quelques autres oubliés. Poésie, fille de mémoire !
Cet ouvrage témoigne de la présence importante, essentielle de la poésie dans la fondation et le développement des éditions Gallimard qui fêtent leur centenaire et de cette belle vitalité de la poésie, si l'on entend par là cette écriture acharnée à travailler la langue pour lui arracher une parole qui, sur fond d'abîme, tente de dire le présent, cette question.
21:56 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anthologie, nrfgallimard, poésie
Balise 69 -
"Nous aimons cette seconde si chargée qui brûle encore après que ce qui nous emporte a fui."
René Char
21:50 Publié dans Balises | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rené char, poésie
Lu 71- Vladimir Maïakovski, L’amour, la poésie, la révolution, Collages d’Alexandre Rodtchenko,Traduction d’Henry Deluy
 Henri Deluy, le poète fondateur de la toujours jeune revue Action Poétique – On fêtait l’été dernier à Lodève la parution de son N°200 ! – et de la manifestation La Poésie en Val-de-Marne, récidive. Il nous redonne le grand poème de Maïakovski De ça (1923) qu’il avait publié aux éditions Inventaire / Invention, précédé de La flûte des vertèbres (1915), poème d’amour dédié à Lili Brik ; de J’aime (1921-1922) où l’amour brûle sans consumer le désir et son Lénine (1924) commencé avant la mort de celui-ci et achevé peu après où son attachement à la révolution bolchevique va de pair avec son refus d’un culte de la personnalité qui se met pourtant déjà en place .
Henri Deluy, le poète fondateur de la toujours jeune revue Action Poétique – On fêtait l’été dernier à Lodève la parution de son N°200 ! – et de la manifestation La Poésie en Val-de-Marne, récidive. Il nous redonne le grand poème de Maïakovski De ça (1923) qu’il avait publié aux éditions Inventaire / Invention, précédé de La flûte des vertèbres (1915), poème d’amour dédié à Lili Brik ; de J’aime (1921-1922) où l’amour brûle sans consumer le désir et son Lénine (1924) commencé avant la mort de celui-ci et achevé peu après où son attachement à la révolution bolchevique va de pair avec son refus d’un culte de la personnalité qui se met pourtant déjà en place .
Quatre grands poèmes que Le temps des cerises réunit dans la collection commun'art, accompagnés d’une riche iconographie : reproductions de collages du constructiviste Rodtchenko et de couvertures d’éditions originales des poèmes de Maïakovski.
Rien n’y fera : le vers de Maïakovski, comme il l’avait prévu, déchire encore « la masse des ans » et c’est une « arme ancienne / mais terrible » que, lecteurs, nous découvrons – lire et fouiller entretiennent bien des rapports ! Cette arme est celle des questions. De celles que l’homme ne pose pas mais qui ben plutôt le posent comme homme dans son humanité même. Ces questions sont celles par lesquelles Henri Deluy clôt son « adresse à Vladimir (II), Lettre ouverte à V.I Lénine aux bons soins de V.Maïakovski ». Ces questions perdurent par delà les statues, les momies, une révolution « qui va devenir le panier percé de la mort / ce que découvrent (les) archives » , pour celui qui dans une « adresse à Vladimir (I) », au mépris de toute chronologie, met son cœur à nu, laissant percer une tendresse que les années, les coups de l’histoire, ont quelque peu crispées ; après les déceptions, après « Marina l’autre poète », ces questions pour celui qui continue à écrire, qui signe Henri Deluy, sont toujours celles du poème et du communisme. Ces questions ne sont toujours pas réglées pour lui.
Ces questions demeurent à l’avant de toute écriture. Ces questions ne sont pas de celles que posent une « commande pratique » mais relèvent bien de cette « commande sociale » qui est liée à l’existence « dans la société d’un problème dont la solution n’est imaginable que par une œuvre poétique ». L’enjeu alors n’est pas celui de l’actuel mais du présent qui se laisse entrevoir et difficilement nommer, présent qui ne trouve plus sa mesure dans le temps comme il va. C’est dans cette mesure là qu’il y a encore à interroger les vers de cet homme déchiré de poésie qui en appelait à une langue nouvelle, Vladimir Maïakovski. Oui, « c’est dur le futur » ! Surtout quand on a décidé, une fois pour toutes, que la vie devait triompher de la mort, qu’il fallait pour cela l’accélérer toujours – « camarade la vie / au trot / plus vite » - voire sauter dans l’avenir d’un bond, instaurer par là origine nouvelle. Où ? Sinon dans le poème. Là où la poésie existe. Se met à exister. Ce poème qu’Henri Deluy interroge dans sa traduction, matière verbale qu’il arpente fort de ce savoir qui lui faisait écrire que « la frappe du vers est une frappe de sens ».
Oui, il y a encore à lire ces « quatre grands poèmes épiques et lyriques » de Maïakovski, on y entend mugir encore « les coursiers / haletants / du temps ». Ils nous mordent la nuque !
21:45 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : deluy, maïakovski, poésie
20/06/2011
Lu 66 - Pierre Reverdy, oeuvres complètes , Tome I et II, Flammarion
Ça y est, nous les avons les Œuvres Complètes de Pierre Reverdy ! Deux volumes chez 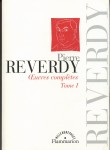 Flammarion! En lieu et place des 14 tomes de l’ancienne édition Flammarion – Poésie / Gallimard assurant la présence de ses principaux titres dans l’horizon éditorial de ce temps : La plupart du temps, Sources du vent, Main d’œuvre plus récemment…Deux tomes, soit quelques 3000 pages comme autant de chemins dans l’œuvre et la vie de Pierre Reverdy au fil des jours et des ans : le tome I, c’est Paris jusqu’au retrait à Solesmes ; le tome II, celui de la maturité poétique.
Flammarion! En lieu et place des 14 tomes de l’ancienne édition Flammarion – Poésie / Gallimard assurant la présence de ses principaux titres dans l’horizon éditorial de ce temps : La plupart du temps, Sources du vent, Main d’œuvre plus récemment…Deux tomes, soit quelques 3000 pages comme autant de chemins dans l’œuvre et la vie de Pierre Reverdy au fil des jours et des ans : le tome I, c’est Paris jusqu’au retrait à Solesmes ; le tome II, celui de la maturité poétique.
Nous les avons ces « pièces détachées », ces notes – si importantes aux yeux de Pierre Reverdy qui disait : « je ne pense pas, je note » - ces articles, ces récits, ces recueils, tous ces poèmes.
Nous les avons avec un appareil critique discret mais d’une rigueur et d’une précision magnifiques. Merveilleux travail d’Etienne-Alain Hubert qui a assuré la mise au net de cette édition.
Nous les avons et pouvons prendre la mesure de l’importance, de la richesse et de la place de cette œuvre dans la première moitié du XX siècle par rapport aux avant-gardes picturales et poétiques : cubisme et surréalisme.
« Comme Phrynis de Mitylène qui ajouta deux cordes à la cithare grecque, Pierre Reverdy sera loué plus tard d’en avoir ajusté une à la lyre française », nous étions alors en 1918, Louis Aragon signait un court article sur Les ardoises sur le toit dans la revue Sic. On peut aujourd’hui avec ces deux tomes louer le poète qui a fait de l’image la chair et le sang du poème, image qui n’est pas, à ses yeux, « moyen de quitter le réel » mais au contraire d’ « en retrouver la saveur profonde, âcre », image creusant de tout son air la réalité, ce que nous croyons savoir du monde et qui ne le rend lisible que parce qu’il l’obscurcit et l’opacifie. Louer, l’analyste de cette émotion appelée poésie qui ébranle la sensibilité et l’esprit plaçant au lieu où se fomentent les grandes révélations qui précèdent toujours les grandes transformations. Louer, l’homme à la vie traversée de passions, soleils et orages mêlés, d’une fidélité à soi-même aussi rugueuse dans la vie que dans le poème conformément à cette sentence selon laquelle « l’éthique est l’esthétique du dedans » qui sut être à la hauteur de ce signe ascendant du désir qui toujours se dégage, se désentrave, se désembourbe, émerge tout ruisselant encore des terres où « l’on aligne les cadavres ». Et avec lui cette saveur du réel qui nous porte à « aimer le poids qui nous fait tomber ». Et plus qu’accepter, aimer notre finitude. Aimer la saveur mortelle de notre condition humaine. Déchirures comprises. Tragique porté à bout de langue comme à bout de formes par un « art de création et non de reproduction ».
Il faut garder près de soi ces deux pierres levées. Il faut lire les poèmes de Pierre Reverdy comme ceux d’un qui n’hésitait pas à affirmer « ce n’est que la vie qui m’intéresse », vous y trouverez toujours sur les devants ce « parti pris de la vie » dont parle Jacques Ancet dans ce Vingt-trois poètes et Reverdy vivants qu’ont publié les éditions Tarabuste en 2007 sous la direction d’Antoine Emaz, et entre les mots, les images, les vers, vous y verrez venir la lumière depuis ce « noir derrière les étoiles », ce vide où le vent tient sources et réserve.
15:36 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : pierre reverdy, poésie, flammarion, oeuvres complètes
Claude Vercey - Ode au président S

Après quelques années d'enseignement, administre de 1974 à 1984 le Théâtre de Saône-et-Loire, où il est pleinement associé à la vie théâtrale (comédien, assistant metteur en scène, dramaturge) et écrit une dizaine de pièces.
Crée en 1984 un poste de permanent dans l'association de poésie du collectif Impulsions (Chalon-sur-Saône). De la poésie il fait ainsi pendant plus de vingt-cinq ans son métier, œuvrant à la défense et illustration de la poésie contemporaine à travers lectures ou spectacles, en Bourgogne et dans toute la France. Conseiller artistique pour le Festival Temps de Paroles (Dijon).
Appartient au comité de rédaction de la revue Décharge. Responsable de la collection Polder. Chronique sur internet : les I.D sur www.dechargelarevue.com .
Dernier livre publié : Mes escaliers, Le Carnet du dessert de lune éd.)
*
A l'École Nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, l'artiste chinoise Siu-Lan Ko a été censurée pour une installation jugée provocatrice à l'encontre du Président S, installation qui a été retirée avant l'ouverture de l'exposition. L'œuvre avait été mise en place sur le façade, et était composée de quatre banderoles géantes, chacune portant un des mots suivants : travailler, gagner, plus, moins.
(Selon Libération du 12 février 2010)
Une jurisprudence semble donc s'établir selon laquelle un mot ou une expression utilisés par le président (pov' con par exemple) doit être à la suite retiré du langage courant ou n'être utilisé qu'après autorisation préalable. Nous laisserons-nous ainsi confisquer des mots qui nous appartiennent ?
Ode au président S.
Je travaille moins
car je ne travaille plus
mais je gagne un peu
un peu chaque mois je gagne un peu
un peu un peu moins chaque mois.
Alors je travaille un peu
de loin en loin
pour gagner un peu
un peu plus que le peu que je gagne.
Et en effet miracle
plus je travaille plus je gagne, oui.
*
Travailler pour gagner sa vie
plus ou moins
Traverser la vie tout en travaillant
Gagner sa vie en travaillant
Ne pas perdre sa vie à travailler
Travailler moins pour travailler mieux
Travailler plus aujourd'hui pour
ne plus travailler demain
ou travailler moins
au moins
Pour ce qu'on gagne autant ne pas
se tuer au travail
travailler plus ou moins pour
s'en sortir
Mais qui vous travaille
qu'est-ce qui vous gagne ?
Être travaillé par le travail
être gagné par la gagne
Travailler plus
pour plus ou moins gagner plus, vous raillez ?
Ne déraillez-vous pas un peu
plus ou moins ?
*
A travailler plus on
gagne plus et
qu'est-ce qu'on gagne ?
Qu'est-ce qu'en plus on gagne quand on gagne ?
Et quand on gagne ce qu'on gagne
qu'est-ce qu'au final on a gagné ?
La considération d'une foule émue,
celle de son patron, les embrassades de ses
collègues, ou gagne-t-on
la sortie ? La berge opposée ?
La vie ? A-t-on gagné sa vie au moins
ou aurait-on gagné du temps ?
Et qu'est-ce qui te travaille là
tout d'un coup puisque tu as gagné ?
*
Ceux qui travaillent plus
et ceux qui gagnent plus
sont-ce les mêmes ?
Ceux qui travaillent encore plus
et ceux qui gagnent toujours plus
sont-ce les mêmes
comme il était indiqué dans la notice ?
Un soupçon plus ou moins
me gagne
me travaille
plus ou moins.
*
Ce qu'on gagne
à travailler plus
c'est
ce qui se goûte à plein
dans les moments où on ne travaille pas
*
Travailler moins
pour goûter davantage
De temps en temps s'y mettre
selon l'humeur et le temps
partager la tâche
assurer sa partie
travailler juste
juste ce qu'il faut
Travailler en douce
Aller piano aller son train
Ne pas travailler
Ne pas gagner gros gagner son pain
travailler à mi-temps pour casser la croute
Bosser pour le plaisir
travailler selon ses moyens son âge
ses besoins prendre congés
donner de son temps
prendre son temps
battre le fer pendant qu'il est chaud
et le dimanche s'en aller tranquillou
rouler sa bosse à la campagne
s'en foutre
toujours plus ou moins
et de plus en plus
joyeusement reprendre la main
Claude Vercey
Dernière minute : Sur intervention du ministre de la culture, les Quatre mots incriminés ont été rendus à la liberté, et l'œuvre de Siu-Lan Ko réinstallée sur la façade de l'Ecole des Beaux-Arts.
15:31 Publié dans Mes ami(e)s, mes invité(e)s | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : poésie, claude vercey, revue décharge
Lu 65 - André Velter, Paseo Grande, Gallimard
 On sait que la belle querelle d’André Velter depuis Poésie sur parole émission créée en 1987 sur France Culture avant de rendre l’antenne quelque 20 ans après a été et est toujours de réconcilier musique et poésie, qu’il n’est pour lui de poésie qu’orale, qu’ « un poème qui ne peut se dire, qui n’engage ni le souffle ni le corps ressemble à un violon dont l’âme a été volée ou faussée », qu’il est « pour la parole haute et vive, pas pour le papier mâché ».
On sait que la belle querelle d’André Velter depuis Poésie sur parole émission créée en 1987 sur France Culture avant de rendre l’antenne quelque 20 ans après a été et est toujours de réconcilier musique et poésie, qu’il n’est pour lui de poésie qu’orale, qu’ « un poème qui ne peut se dire, qui n’engage ni le souffle ni le corps ressemble à un violon dont l’âme a été volée ou faussée », qu’il est « pour la parole haute et vive, pas pour le papier mâché ».
On se souvient du premier livre des éditions Alphabet de l’espace (Annecy, 2007) Tant de soleils dans le sang d’André Velter, livre-récital composé dans la résonance de la guitarra flamenca de Pedro Soler. On se souvient qu’il y avait là un beau livre avec les dessins d’Ernest Pignon Ernest et le DVD du récital intégré en 3ème de couverture.
Tant de soleils dans le sang, quelle belle traduction pour ce mot espagnol que l’on doit à Federico Garcia Lorca, ce duende que toujours tente de rejoindre et d’éveiller André Velter dans son écriture.
C’est lui que l’on retrouve dans ce Paseo grande qui vient de paraître aux éditions Gallimard. Nouveau livre-récital avec Olivier Deck augmenté de 7 poèmes-talismans avec Antonio Segui, 7 quatrains qui « (relèvent) le défi / d’être toujours vivant ». C’est un livre-conséquence d’un acte, d’un événement artistique : le mano a mano – ce tête à tête qui dit le polemos, cette harmonie des contraires comme contraires dans la tension du face à face – entre André Velter et Olivier Deck lors du festival de jazz d’ Orthez. C’est un livre-passerelle qui invite à se rendre sur internet pour entendre le chant d ‘Olivier Deck et visionner quelques séquences filmées sur le site www.gallimard.fr/paseogrande.
Furieusement espagnol, son titre qui renvoie à l’entrée des toreros à las cinco de la tarde, heure de vérité où l’inconnu entame son creusement avec la sortie des toros, « heure exacte / où l’ombre et la lumière / s’en vont d’un même pas » jusqu’à « tutoyer les anges ou les dieux / et la mort les yeux ouverts », le montre. Toutefois, ce Paseo est Grande de courir les horizons et les arènes de la terre « sur les chemins de grand vent », sur les versants des montagnes afghanes, du côté du Pamir et du Taklamakan d’asie centrale, vers Samyé, sur la rive gauche du Tsang-Po. Avec l’arène, ces lieux fournissent tous l’occasion d’une part, de se trouver « au centre, le plus vif, le plus vivant / dans la distance la plus gale / de la blessure à la beauté » ; d’autre part, d’être point de passage « au bord du précipice / où la mort est fugace / où le souffle est lumière » comme entre les cornes du toro avant l’estocade et enfin, d’être comme autant d’instants suspendus, hors du monde comme hors du temps, possibilité de « s’en sortir sans sortir » selon les mots de Gherasim Luca.
L’écriture d’André Velter est toujours de main légère, d’enjambée allègre. Elle cite. Citar- je me permets d’ajouter ce mot à ceux que mobilise André Velter : Sitio, llamada, temple –c’est appeler le toro suite à un infime mouvement du pied vers la gauche et qui amène le torero à se présenter de frente, face au toro et non de profil. C’est le moment du risque maximun. Peu visible, il fait le silence sur la faena comme sur le poème images et rythme s’approchent par saccades, alternant lenteur et vitesse, délicatesse et violence. Citer ainsi, c’est appeler l’indicible à se montrer dans le dire comme indicible. C’est là comme un instant d’éternité, un moment suspendu, hors du temps des horloges. C’est le moment du duende qui selon la définition de Lorca dans Théorie et jeu du duende ne vient pas du dehors comme la muse ou l’ange mais s’éveille depuis « les ultimes demeures du sang ». Par ouches fragiles mais aussi parfois violentes, André Velter sait dans ses poèmes le réveiller. C’est lui qui blesse le poème t y fait lever un soleil qui ne se couche jamais . Là est l’originalité de la poésie d’André Velter, là se trouve sa capacité à renouer et élargir la mélodie de notre âme, là la vie trouve ses ressorts secrets pour toujours partir, toujours aller, « pour rester en partance » et « vivre sur le qui-vive / et dans un cri d’amour / comme un amour perdu ».
15:25 Publié dans Du côté de mes publications | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : velter, paseo grande, duende, poésie
Balise 66 - Ah! le sentiment du oui...
« Il n'y a pas, il n'y a sans doute jamais eu de grand poète (et c’est pourquoi les religions du salut au fond ne lesaiment guère), de poète si sombre, si désespéré qu'il soit, sans qu'on trouve au fond de lui, tout au fond, le sentiment de la merveille, de la merveille unique que c'est d'avoir vécu dans ce monde et dans nul autre. La poésie vibre par excellence dans ce sentiment du oui« porté au sommet d'un instant que traversent frissons, battement d'ailes*- et c'est un sentiment dont notreépoque, nous l'avons vu, est plus avare que d'autres. »
*Jules Monnerot
Julien Gracq, extrait de Préférences
15:21 Publié dans Balises | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : oui, julien gracq, poésie
10/04/2011
Lu 64 - Les poètes de la méditerranée, Anthologie - Poésie / Gallimard
 Cette Anthologie établie par Eglal Errera regroupe 4 générations de poètes contemporains tous « amarrés à leur langue » ; 17 langues, 5 alphabets – Notons , et c’est là la première originalité de cette édition, que figurent, face à face, le poème en sa langue originelle en regard de sa traduction française ; 24 pays : des villes, des ports, des îles… ; un traitement égal de 5 pages est réservé aux 101 poètes comme on dit les « mille et une nuits », histoire de faire signe vers cet inachevable caractéristique de l’entreprise.
Cette Anthologie établie par Eglal Errera regroupe 4 générations de poètes contemporains tous « amarrés à leur langue » ; 17 langues, 5 alphabets – Notons , et c’est là la première originalité de cette édition, que figurent, face à face, le poème en sa langue originelle en regard de sa traduction française ; 24 pays : des villes, des ports, des îles… ; un traitement égal de 5 pages est réservé aux 101 poètes comme on dit les « mille et une nuits », histoire de faire signe vers cet inachevable caractéristique de l’entreprise.
C’est à un voyage que nous convie Eglal Errera en accord en cela avec le titre même de la belle préface d’Yves Bonnefoy : « moins une mer que des rives ». Ainsi on part d’Athènes vers l’est : Turquie, Israël , monde arabe avant de remonter via l’Espagne, la France, l’Italie vers la Macédoine, ouest où le soleil décline.
On parcourt des terres, plus qu’on ne navigue. C’est l’autre originalité de cette anthologie que d’avoir choisi non la mer et ses appels répétés vers l’ailleurs ; non l’ivresse poétique de l’au-delà des Colonnes d’Hercule aimantée par cette « île des bienheureux » dont parlait Pindare et qu’évoque Yves Bonnefoy lorsqu’il nous rappelle comment l’Ulysse de Dante finira par naufrager et se perdre lors de son second voyage en atlantique, mais bien la Méditerranée comme creuset de rencontres, chaudron d’échanges, lieu de comptoirs où le langage, les langues qu’on parle sur ces rives se trouve mis au centre et donc, en sa pointe, la poésie, « expérience fondatrice » écrit Yves Bonnefoy, pour la Méditerranée : la poésie comme mémoire de l’être, comme ce qui entend défendre l’idée que s’il y a certes encore de l’attrait pour l’Eurydice noire, perdue, il y a aussi, ici et là, sous le ciel, des choses, des êtres et leurs infinies relations à préserver des ravages du discours des médias comme de la pensée conceptuelle.
On ne trouvera pas dans cet ouvrage quelque pâle et mauvais accord de circonstance sous prétexte d’une Mare Nostrum et d’une lumière que l’on pourrait croire celle des premiers matins du monde . Ici, chaque poète dit à sa manière et dans sa langue cette terre de contrastes, cette réalité déchirée où pourtant chacun ancre son identité irremplaçable avant de dire ce que Salah Stétié appelle « la prodigieuse nuance séparée ».
La Méditerranée comme une chambre d’échos, une caisse de résonance. Résonance ? ce qui importe en poésie, non ?
Alain Freixe
16:09 Publié dans Du côté de mes interventions | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : méditerranée, anthologie, poésie, yves bonnefoy




